Entrée de carnet
L’oeil qui pulse
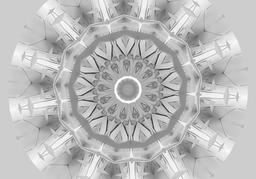
Dans le cadre du Groupe de recherche: L’Observatoire de l’imaginaire contemporain 4 (OIC- 4) «Une folie du voir: images et écrans dans l’extrême contemporain» sous la direction de Bertrand Gervais et Vincent Lavoie (études littéraires et sémiologie).
![Lunney, Karen. 2013. «Entering the Inferno» [Photographie] Source: http://karenlunneyphoto.com](/wp-content/uploads/2014/03/bp3.jpg)
Lunney, Karen. 2013. «Entering the Inferno» [Photographie]
Source: http://karenlunneyphoto.com
(Credit : Lunney, Karen)
«Entering the Inferno», se traduisant comme l’entrée en enfer, est la photographie que Karen Lunney a soumise au concours du National Geographic en 2013. Prise au vif lors de la migration saisonnière des gnous au Kenya, cette photo donne à voir des bêtes soudainement surprises par un courant violent. Le chaos que leurs cornes dessinent dans l’eau, virevoltant en toutes directions, laisse deviner la confusion dans laquelle elles s’engouffrent. Si elles veulent survivre au déchainement de la rivière Mara, elles doivent trouver une terre ferme où poser pied.
Au milieu de la scène, un détail tout simple en apparence monopolise le regard: l’œil ouvert d’un gnou. Véritable punctum au sens où l’entend Barthes, la blancheur de cet œil accorde une force inéluctable au cliché. Nul besoin de l’étudier longuement pour savoir qu’on peut en être affecté. La détresse se devine dès lors qu’on est y confronté, rendant par le fait même ces bêtes terriblement humaines. Et l’anthropomorphisme que provoque cette image est sans doute ce qui me déstabilise le plus.
D’emblée, le titre de la photographie contribue à cet anthropomorphisme. En faisant du déchainement de la rivière l’indice de leur damnation éternelle, «Entering the Inferno» annonce qu’elles s’apprêtent à traverser vers l’au-delà. Ce qui sous-entend nécessairement que ces bêtes sont munies d’une âme, sans quoi elles n’auraient pas accès à l’enfer. Et c’est grâce à cet œil, qu’on retrouve au cœur de l’image, qu’elles en acquièrent une.
Cet anthropomorphisme me fascine d’autant plus que, si ce n’était de la présence d’un regard, on n’en discuterait pas. De fait, en observant n’importe quelle photo de la série d’où ce cliché est tiré, nulle autre ne produit un tel effet. La puissance de cette image ne relève donc pas tant du drame de la scène présentée, ou de ses propriétés esthétiques, mais d’une expérience particulière du regard. Une expérience qui, saisissant le spectateur, assure le passage de ces bêtes vers l’au-delà. Difficile ici de ne pas penser à l’ouvrage de Georges Didi-Huberman Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Le raisonnement qu’il y mène est en quelque sorte mis en abime dans l’œil qui me regarde alors que je m’y projette.
Selon les logiques du symptôme, on pourrait dire que l’anthropomorphisme qui accompagne cette image est la révélation d’autre chose, d’une manifestation latente: «Cet “anthropomorphisme” est subliminal, ou presque, il ne tient qu’à un fil…» De fait, rien ne se manifeste comme tel dans cette image. Je veux dire, ce qui m’interpelle devant le blanc de cet œil n’est pas donné à voir par l’image. Pourtant, il y a quelque chose qui m’affecte dès lors que je l’aperçois. Quelque chose qui déborde largement les possibilités d’un «ça a été», puisqu’il émane de l’image: ça pulse.
L’œil qui me pointe, c’est là où s’émane une dialectique complexe entre moi et le l’image. Cette émanation lui confère ainsi ce que Didi-Huberman, reprenant à son compte les théories de Benjamin, appelle l’aura: «L’aura serait donc comme un espacement œuvré et originaire du regardant et du regardé, du regardant par le regardé.» À partir du moment où je constate ce détail, une ambiance étrange surcharge ma lecture de l’image, quelque chose la trouble, l’inquiète. L’image s’abime, au sens où elle déploie sa profondeur.
Le regard du gnou dévoile en fait la distance qui m’en rapproche. Il ouvre un espace où je m’investis, et c’est précisément là, dans cet investissement entre regardant et regardé, dans l’espace sémiotique qui m’unit à la bête, dans ce jeu entre humanité et animalité où je suis confronté à la mort, à l’angoisse d’être emporté à mon tour par un flot violent (et dont l’image me donne un avant-goût en me déstabilisant – me chavirant – dès que je l’aperçois); c’est dans cet espace, dis-je, où mon destin se lie à celui des gnous, que se déploie la puissance propre à «Entering the Inferno».
Saisi par l’image, je lui donne vie, l’actualise. L’image est plus qu’un indice, et devient le support pour autre chose. L’approche psychanalytique parlerait ici d’une pulsion, de la projection de contenus inconscients. Mais emprunter cette voie, c’est s’aventurer dans un registre subjectif. Celui des expériences personnelles, de l’enfance, des désirs. Au-delà de ces complexes, de la structure inconsciente du désir, quelque chose m’unit plus viscéralement au gnou: l’angoisse de la mort. Cette angoisse, qui prend forme dans la blancheur de l’œil, est l’indice que ce dernier est bien grand ouvert, que la bête cherche désespérément un lieu où s’accrocher. Et c’est peut-être en cela que l’image m’affecte autant: elle m’expose à mes propres turbulences, là où mon regard s’accroche.
