Entrée de carnet
La lettre et le corps, oppositions et correspondances dans «Splendeurs et misères des courtisanes» d’Honoré de Balzac

En travaillant à partir de la notion de raison graphique, telle que pensée par l’anthropologue Jack Goody, la visée de cet essai est de saisir la complexité avec laquelle les rapports du corps et de l’écrit sont présentés dans le roman et quel est l’imaginaire qui s’en dégage.
En observant les romans français du 19e siècle, l’omniprésence d’un imaginaire axé sur l’écrit semble répondre à la place considérable que l’écriture vient à occuper ; qu’il s’agisse du domaine de la loi, de l’écrit administratif, de l’apparition de la presse ou de la montée du roman, l’écriture devient un pilier essentiel de la structure sociale. L’écriture fictionnelle est sensible à cette nouvelle importance de la culture littératienne, qui transforme les rapports sociaux ainsi que la relation entre la lettre et le corps. Apparaissent alors des héros de roman qui choisissent la plume comme outil d’avancement social. Pensons à Julien Sorel qui enfile sa robe noire et qui entreprend de s’intégrer aux hautes sphères sociales grâce à son éducation, ou encore à George Duroy dans Bel-Ami qui passe par le journal. Puis il y a une foule de personnages littératiens qui trouvent une place dans les récits ; des journalistes tels que Lousteau ou Blondet, qui côtoient des ministres, des libraires comme Dauriat dans Illusions perdues. Il y a des écrivains, comme Pierre Sandoz ou Daniel d’Arthez, des hommes de loi, tel que Camusot, juge d’instruction, des hommes d’affaires peuplant toute la série des Rougon-Macquart et La Comédie humaine.
Dans la fiction, l’écriture prend corps à travers des personnages qui : «se posent et se pensent dans leur rapport à elle[1]» et parcourent habilement ou non les voies dorénavant écrites du pouvoir. Cet imaginaire de l’écrit est également relancé dans les récits par la présence massive d’un vocabulaire et de formes écrites propres à d’autres domaines que l’écriture romanesque, tels que des articles de journaux et des contrats, des lettres et des procès-verbaux qui se mêlent à la prose, en sorte que l’écriture envahit l’écriture, et plus qu’un accessoire, elle devient un moteur pour l’action, elle se pose en obstacle ou en alliée selon les situations. En écrivant sur elle, les auteurs du 19e siècle dévoilent l’importance de la «raison graphique», telle que pensée par Jack Goody[2], qui encadre et influence le savoir humain, au sens où l’écriture comme forme graphique et comme dispositif de connaissance: «“objective” le discours, elle en permet une perception visuelle et non plus seulement auditive. Du côté du récepteur, on passe de l’oreille à l’œil ; du côté du producteur, on passe de la voix à la main»[3]. Suivant cette réorganisation de l’usage du corps, l’écriture représente un outil qui, s’il est manipulé par l’être humain, le conditionne en retour :
Lorsque je parle de l’écriture en tant que technologie de l’intellect, en particulier, je ne pense pas seulement aux plumes et au papier […] mais aussi à la formation requise, l’acquisition de nouvelles compétences motrices, l’utilisation différente de la vue, ainsi qu’aux produits eux-mêmes, les livres qui sont rangés sur les étagères des bibliothèques, objets que l’on consulte et dont on apprend et qu’on peut aussi, le moment venu, composer[4].
Cette évolution du mode de pensée se fait simultanément à l’évolution d’une technologie de l’intellect qui requiert une matérialité spécifique, une pensée entraînée ainsi que ses propres acteurs. Dans la mesure où la présence de l’écriture : «déclenche aussitôt un remodelage des pratiques essentielles. Relations à la nature, aux autres, à l’invisible, construction sociale de la personne, fondement et emblématique des pouvoirs[5] », elle alimente un imaginaire ambigu. En effet, l’écriture est puissante dans les mains des autorités, il n’y a: « rien désormais qui n’échappe à son empreinte[6]», mais elle est également contestable, à l’aide de lettres anonymes ou contrefaites, à l’aide de la presse et des pamphlets : comme outil, l’écriture peut aussi briser ce qu’elle construit. Dès lors, elle s’inscrit comme un système d’ordre et une menace à ce même système[7]. Or, il n’y a pas qu’une écriture subversive qui puisse défier l’ordre établi, et dans le roman, cette opposition est soulignée par la tension qu’entretiennent le corps et l’écrit. Car Julien Sorel et George Durois, ou encore Lucien de Rubempré, bien qu’ils usent de leur savoir littératien pour accéder au pouvoir, sont d’abord tous doués d’un physique attrayant qui leur a valu une femme grâce à laquelle faire un premier pas dans l’univers mondain. Dès lors, le corps représente un outil qui peut, jumelé à l’écrit, propulser un personnage dans les hautes sphères sociales. Encore faut-il savoir le contrôler parfaitement, car un sourire suffit à mettre en péril un secret bien gardé.
En considérant l’œuvre d’Honoré de Balzac, il est évident que l’imaginaire de l’écrit est un élément fondamental de sa prose. En nous penchant plus spécifiquement sur Splendeurs et misères des Courtisanes[8], nous constatons que l’intrigue du roman se situe d’emblée du côté de la littératie. Pour Jacques Collin (ancien forçat évadé ayant pris le costume d’un abbé espagnol) et Lucien (jeune journaliste et poète), il s’agit de faire de ce dernier un homme officiellement noble, c’est-à-dire de revendiquer son titre de noblesse du côté maternel, tout en lui construisant une identité écrite respectable pour le monde parisien. C’est par le biais d’un mariage avec Clotilde de Grandlieu, une femme qui permettrait au jeune homme d’obtenir son titre de marquis, que les deux hommes tentent de placer Lucien. Pour gagner la main de Clotilde, Lucien n’a pas à tuer un dragon, conquérir un pays, ou encore, faire un duel avec un autre prétendant. Sa quête consiste plutôt à déposer, devant la famille de Grandlieu, une preuve écrite de son acquisition de terres. Nous sommes bien loin des contes et des récits chevaleresques, bien loin d’un imaginaire du corps combattant :
L’écrit balzacien témoigne d’un moment historique bien particulier, le début du XIXe siècle, qui voit l’alphabétisation des populations occidentales s’élargir et la culture de l’écrit valorisée, non plus tant dans sa référence sacrée que dans son efficace social et politique[9].
Dans le roman, c’est un imaginaire de l’écrit présenté dans sa puissance qui remplace le motif du combat et de la bravoure. L’écriture tend à remplacer le corps, ou plutôt elle en devient l’extension ; le corps est toujours en jeu, il est désiré, il est en révolte, il s’affiche, mais c’est lorsque la plume se lève, les initiales encrées, qu’il gagne ou perd. Car qu’il s’agisse de signer un article de journal, d’écrire un billet doux peut-être compromettant, ou d’avoir en sa possession un contrat de mariage ou un testament, le corps existe socialement quand il est écrit. Dans le récit, une nouvelle anatomie est visible, d’encre et de papier, elle répond aux documents qui gouvernent, qui prévalent sur le vivant[10]. Pourtant, même si Lucien n’a pas à prouver sa valeur grâce à des exploits physiques, car «seul l‘écrit fait preuve[11]», il doit performer autrement devant les gens importants, soit que pour se mêler à eux, il doit montrer, physiquement, sa maîtrise des codes sociaux liés au savoir écrit : «à cette situation de contrôle de l’écriture par un groupe spécialisé correspondent non seulement des formes écrites particulières, mais aussi des formes orales[12]». Dans ce cas, l’écrit fait preuve, oui, mais cette preuve doit aussi s’inscrire corporellement. En effet, les héros de Balzac, qu’il s’agisse de Rastignac ou de Lucien, doivent en passer par un apprentissage des manières spécifiques au monde parisien pour en être accepté, un «savoir écrire» et un «savoir lire» se traduisant corporellement : «au bal de l’Opéra, les différents cercles dont se compose la société parisienne se retrouvent, se reconnaissaient et s’observent. Il y a des notions si précises pour quelques initiés que ce grimoire d’intérêts est lisible comme un roman» (SPLEN, p. 19). Pour Lucien, il s’agit alors d’obtenir une fortune et un titre, qui avec le corps conditionné, attestent du statut de lettré nécessaire pour obtenir l’approbation du quartier Saint-Germain.
Dans Splendeur et misère des courtisanes, Jacques Collin emploie l’écriture, tout comme il use du corps de Lucien pour rejoindre les ambitions qu’il partage avec son protégé : «les vieillards chez qui l’action de la vie s’est déplacée et s’est transportée dans la sphère des intérêts, sentent souvent le besoin d’une jolie machine, d’un acteur jeune et passionné pour accomplir leurs projets» (SPLEN, p. 69). Toutefois, lui qui connaît un grand nombre de moyens pour parvenir à son but, choisit ultimement de baser sa réussite sur deux corps et une fortune, c’est-à-dire, sur les désirs de M. de Nucingen quant à Esther et le prix qu’il sera prêt à payer pour rencontrer la jeune femme. Par conséquent, le roman donne à lire la relation qu’entretiennent un personnage littératien, avec un corps hautement conditionné par l’écrit, et une courtisane qui ne parvient pas à accéder au monde lettré. Il sera donc question d’étudier de quelle nature est la relation de ces deux personnages, selon que l’imaginaire du corps et de l’écrit qui s’élabore dans le roman semble séparer Esther et Nucingen (ils n’appartiennent pas au même monde), mais aussi montrer, dans une correspondance troublante, l’emprisonnement qu’ils partagent face à l’écriture.
Le corps, espace de résistance et d’enfermement
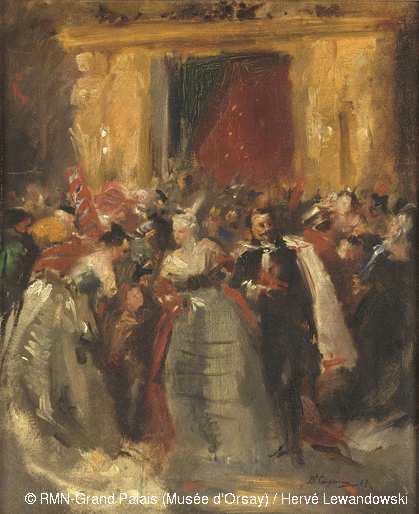
Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), Bal costumé au palais des Tuileries, 1867
Huile sur toile, H. 56 ; L. 46 cm, Paris, musée d’Orsay
© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
(Credit : https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=116520)
Bien que la quête de Lucien et de Collin soit de papier, dès les premières pages du roman, nous sommes invités dans l’univers mondain de la performance. En effet, l’incipit introduit le lecteur au bal de l’Opéra, chargé de gens lettrés de différents milieux, alors qu’Esther, une courtisane illettrée ayant été reconnue par les anciens compères de Lucien, fuit. Dans un événement tout corps et parole, où les parures se frôlent, où les voix s’envolent, où les manières sont observées, il semblerait pourtant que ce soit le masque qui permette à Esther de se présenter au bal, comme elle n’appartient pas à ce public. Elle qui, selon Blondet: «est la seule fille de joie en qui s’est rencontrée l’étoffe d’une belle courtisane ; l’instruction ne l’avait pas gâtée» (SPLEN, p. 30), surnommée «la Torpille», elle qui représente le corps féminin dans sa sensuelle puissance: «elle tient comme une baguette magique avec laquelle elle déchaîne les appétits brutaux si violemment comprimés chez les hommes qui ont encore du cœur en s’occupant de politique ou de science, de littérature ou d’art» (SPLEN, p. 31), élevée comme rat (SPLEN, p.33), c’est-à-dire comme enfant formée au plaisir et à la dépravation, puis très clairement décrite comme «attrayante pantomime» (SPLEN, p.42), n’est pourtant pas en mesure de se tailler une place avec son corps.
Au bal, moment où une femme bien mise peut briller, lieu parfait pour Esther dont la beauté est louée, c’est le corps qui trahit celle qui tente d’appartenir au monde de Lucien, alors qu’elle est devinée avant même que Bixiou la compromette: «eux et quelques habitués du bal de l’Opéra savaient seuls reconnaître, sous le long linceul du domino noir, sous le capuchon, sous le collet tombant qui rendent les femmes méconnaissables, la rondeur des formes, les particularités du maintien et de la démarche» (SPLEN, p. 34). Car le corps est conditionné par l’éducation, et dans le cas d’Esther, il dévoile son imposture, il avoue l’illettrisme de la courtisane :
La bonne réalisation des écritures repose sur un apprentissage du geste et une maîtrise technique précis. Apprendre à écrire relève avant tout d’un dressage du corps. La position du buste, la façon d’être assis, de tenir la plume ou de disposer les mains sont des questions essentielles[13].

Plume à la main.
(Credit : http://imaginaire76.i.m.pic.centerblog.net/zmdbim7f.gif)
Après tout, on ne tient pas une baguette magique comme une plume, et la courtisane, loin de discipliner son corps dans la droite ligne de la logique graphique, avive les désirs : «il n’y a pas de femme dans Paris qui puisse dire comme à l’Animal : Sors!… Et l’Animal quitte sa loge» (SPLEN, p. 32). Reconnue par ses «allures» (SPLEN, p. 492), la courtisane éveille un imaginaire corporel lié à l’animal, au désordre : «sortie de cette “forêt vierge pour les animaux féroces” que sont les bas-fonds de Paris, la prostituée, présence anarchique et occulte dans un pays ennemi [vit] en marge d’une société qu’elle menace et par laquelle elle est menacée[14]». Aussi éloignée du domaine littératien, elle n’en demeure pas moins un sujet important, dans la loi comme dans l’art : «la femme vénale, foncièrement instable, est capable d’être sans formes tout en participant aux formes supérieures et stylées de l’art»[15], et Lousteau poursuit : «cette femme est le sel chanté par Rabelais et qui, jeté sur la matière, l’anime et l’élève jusqu’aux merveilleuses régions de l’Art : sa robe déploie des magnificences inouïes […] elle a le secret des onomatopées les mieux colorées» (SPLEN, p. 32). Tout, jusque dans le langage de la courtisane (les onomatopées) est un produit du corporel qui, s’il enchante possiblement les artistes, n’en demeure pas moins un obstacle qui marque Esther comme une intruse dans l’univers littératien.
Contrairement à la courtisane, confinée dans le corporel, les lettrés avec lesquels discutent Lucien au bal passent de la rédaction de leurs articles de journaux à la conversation en utilisant les mêmes techniques de communication : «il me semble que tu n’avais pas besoin d’employer l’hyperbole et la parabole avec un ancien ami, comme si c’était un niais» (SPLEN, p. 29), ou encore, animent un imaginaire du journal : «Blondet, parlant de Démétrius dans le foyer de l’Opéra, me semble un peu trop Débats, dit Bixiou à l’oreille de son voisin» (SPLEN, p. 30). Eux, dont le «continuum dans les modes de communication est parfois à ce point incorporé que l’orateur peut “parler comme un livre”[16]», relancent l’écrit oralement : «l’écriture a une influence intérieure d’une espèce particulière, car elle change non seulement notre manière de communiquer, mais la nature de ce que nous communiquons[17]». Dans le récit, les journalistes «parlent comme des journaux» dans la mesure où les sujets qui les inspirent ainsi que l’organisation de leurs paroles, comme lorsque Bixiou dit à Lousteau, emporté : «tu perds cent sous de feuilleton» (SPLEN, p. 32), reproduisent la structure du journal. Ils ont tant intégré l’écrit que celui-ci oriente leur discours et leur capacité à reconnaître celle qui ne partage pas leur monde.
Esther, qui dans le roman, pourrait donner l’impression d’être une figure d’opposition totale à la loi écrite, elle qui jusque dans le quartier qu’elle habite, vit dans le domaine du corporel et semble échapper à la structure sociale: «le Conseil municipal n’a pu rien faire encore pour laver cette grande léproserie, car la prostitution a depuis longtemps établi là son quartier général» où vivent des «êtres bizarres qui ne sont d’aucun monde» (SPLEN p. 37), est cependant soumise à la lettre : «c’est par l’inscription qu’une femme pénètre dans le monde clos de la prostitution officiellement tolérée ; elle devient, par le fait même, une fille soumise[18]». Pour se rendre digne de Lucien et atteindre la sphère sociale à laquelle le jeune homme aspire, Esther tente de retrouver un statut d’honnête femme sans y parvenir puisqu’il faut en passer par la structure contraignante de la loi : «il y avait tant de formalités à remplir, tant de monde devait être appelé à attester, à garantir la résipiscence, que le retour à une conduite régulière était presque impossible[19]», ce qu’elle explique à l’abbé Carlos Herrera (Jacques Collin):
L’amour était entré dans mon cœur, et m’avait si bien changée qu’en revenant du théâtre, je ne me reconnaissais plus moi-même […] j’ai fait ma déclaration en forme à la police, pour reprendre mes droits et je suis soumise à deux ans de surveillance. Eux qui sont si faciles pour vous inscrire sur les registres d’infamie, deviennent d’une excessive difficulté pour vous en rayer (SPLEN, p. 44).
Même si le secteur où réside Esther se soustrait à la raison graphique: «le caissier le plus mathématique n’y trouve rien de réel après avoir repassé les détroits qui mènent aux rues honnêtes» (SPLEN p. 38), et forme plutôt : «un lieu multifonctionnel et très «vivant», dé-linéarisé et comme dé-régulé […] où s’entrecroisent le libre jeu des lignes et des corps[20]», une certaine forme d’ordre, d’organisation écrite, prévaut encore sur le corps. Car Esther jure à l’abbé qu’elle a été sage, mais c’est la rayure de son nom sur le registre, qui peut seule convaincre autrui et vraisemblablement la jeune femme elle-même de son retour dans le droit chemin. Pour protéger Lucien, Jacques Collin propose alors un marché à Esther, à qui il demande de lui remettre son corps, ses manières de courtisane et son désir de Lucien, contre une identité écrite et neuve, puis sa soumission à une stricte éducation (la soumission se poursuit):
Cette libération civile et politique, si difficile à obtenir, que la Police a raison de tant retarder dans l’intérêt de la Société même, et que je vous ai entendue souhaiter avec l’ardeur des vrais repentirs, la voici, dit le prêtre en tirant de sa ceinture un papier de forme administrative (SPLEN, p. 50).
Dans l’univers du roman, il est nécessaire de s’inscrire positivement dans l’écriture sociale (après tout, il s’agit de la quête de Lucien et de Jacques Collin) et la réaction d’Esther montre combien l’écrit fait figure d’autorité, lui qui a le pouvoir de prolonger le corps sur papier avec un nom et un statut, mais aussi de l’écarter, de lui attribuer un numéro:
La participation à la culture écrite de ceux qui ne savent ni écrire ni lire suppose des médiateurs de plume ou de lecture, mais elle renvoie plus fondamentalement à la soumission inquiète devant le texte écrit, le plus émané d’une autorité lointaine et redoutée, et qui garantit une propriété, un droit, une identité[21].
Selon le prêtre, Esther est: «dans les cartons de la Police, un chiffre en dehors des êtres sociaux» (SPLEN, p. 53). Elle est donc loin de pouvoir rejoindre Lucien, ce pourquoi elle est complètement saisie quand le «papier libérateur» apparaît devant elle, au point où son corps devient d’abord incontrôlable: «à la vue de ce papier, les tremblements convulsifs que cause un bonheur inespéré agitèrent si ingénument Esther, qu’elle eut sur les lèvres un sourire fixe qui ressemblait à celui des insensés» (SPLEN, p. 51). Or, n’ayant que son corps comme moyen d’obtenir ce qu’elle désire, Esther use de ses charmes, elle répond à l’écrit avec ce qu’elle connaît:
Elle saisit cet homme, lui couvrit les mains de baisers; elle employa, mais dans une sainte effusion de reconnaissance, les chatteries de ses caresses, lui dit, au travers de ses phrases sucrées, mille et mille fois: Donnez-le-moi! […] le prête, honteux d’avoir cédé à cette tendresse, repoussa vivement Esther […] il remit froidement la lettre dans sa ceinture (SPLEN, p. 51 – 52).
Dans cet extrait, une lutte entre le corps et la lettre est à l’œuvre, au point où même Jacques Collin a un moment de faiblesse. Seulement, en gardant possession du document, il demeure le plus fort. Il impose à la jeune femme une instruction catholique grâce à laquelle elle devrait pouvoir abandonner son surnom, ce à quoi Esther s’exclame: «ah! s’il était possible de verser ici tout mon sang et d’en prendre un nouveau» (SPLEN, p. 53), un sang d’encre, certes, qui lui permettrait d’intégrer la société de manière respectable. Pour cela, la jeune femme doit opérer une sortie du corps : «elle avait autant à désapprendre qu’à apprendre» (SPLEN, p. 61), et se défaire de : «cette perfection de l’animal chez une créature à qui la volupté tenait lieu de la pensée» (SPLEN, p. 57). Pourtant, les premières pages suivant l’entrée de la jeune femme à l’institut sont vouées à la description de son visage. C’est-à-dire que son entrée dans la littératie est faussée, car la lettre, loin de faire une place à son éducation, ne relance que son corps, comme Blondet et Lousteau qui considèrent la courtisane en sujet à écrire plutôt qu’en actrice de l’écrit qui pourrait le maîtriser. Objet de création, plutôt que créatrice (elle est d’ailleurs la création de Collin qui lui attribue plus tard un rôle), Esther ne parvient jamais à incorporer complètement la nouvelle culture à laquelle elle doit soumettre ses souvenirs charnels: «un désir plus violent chez elle qui savait tout» (SPLEN, p. 61). Capable d’imiter les manières de ses compagnes, de s’attirer les compliments de la supérieure, elle ne peut pourtant pas oublier Lucien, ce qui lui cause d’être malade: «elle pâlit, changea, maigrit […] ses camarades regardaient avec intérêt sa pâleur d’herbe flétrie, ses yeux de gazelle mourante, sa pose mélancolique» (SPLEN, p. 64-65). Encore une fois rapprochée de la nature, le texte refuse à Esther sa sortie de l’animalité. La jeune femme est blême, et son sang, coulant au rythme des passions, perd sa vitalité. À l’institut, un double mouvement d’intégration des enseignements et leur rejet montre que le corps peut résister au conditionnement de l’écrit, mais au prix de la vie. C’est finalement la promesse d’une réunion avec Lucien qui sauve la jeune femme en lui redonnant la possibilité d’habiter son corps. Dans un entremêlement complexe, le texte donne à lire une double défaite du corps qui, s’il se rebelle contre la «lente domestication de la main[22]» indispensable à l’inclusion dans le domaine de la littératie, il résiste inutilement, car ni le texte, ni Jacques Collin, ni les journalistes du bal ne souhaitent qu’Esther les rejoignent.
Si plusieurs scènes dans le roman tendent à montrer le pouvoir de l’écrit sur le corps et la domination de ce dernier sur lui, le contraire est aussi visible, malgré que les dynamiques ne soient pas les mêmes. C’est-à-dire que le corps a le pouvoir de protester, il peut même dominer un temps, mais ne pouvant s’inscrire dans la société que lorsqu’il a été assimilé à un certain conditionnement littératien, il n’est pas une arme durable, lui qui par sa nature même est appelé à dépérir, contrairement à l’écrit. De son côté, Esther rate son initiation au monde lettré en demeurant dans le domaine du corporel, ce qui l’empêche de prendre part à l’univers convoité. En effet, le texte suggère que la conséquence d’une mauvaise intégration des principes participant à la logique de l’écrit serait d’être dominé par celui-ci, donc par ceux qui le manipulent. Car Esther, qui se défendait par le corps, qui selon les hommes au bal de l’Opéra, pouvait engourdir les meilleurs esprits, n’a pourtant pas un pouvoir suffisant pour trouver la liberté. Par Jacques Collin, elle est maintenue dans son corps, dans une coquette cellule: «le monde doit ignorer que vous vivez […] cet appartement sera votre prison» (SPLEN, p.78). Le forçat sait que la courtisane pourra lui être utile dans le futur, ce qui prouve être vrai alors qu’il vend sa beauté à Nucingen. Le prêtre espagnol pousse effectivement Esther dans les bras du vieux banquier: «que vous avais-je demandé?… de reprendre la jupe de la Torpille pour six mois, pour six semaines, et de vous en servir pour pincer un million […] soyez gaie, soyez folle! soyez irrésistible et… insatiable» (SPLEN, p.235). Puis, une fois en relation avec le baron, Esther est à nouveau confinée dans le corporel, l’animal : «vous avez construit une cage magnifique pour un perroquet qui vous plaît» (SPLEN, p. 274). Esther, en oiseau d’apparat, montrée, écoutée avec plaisir en perroquet qui «jacasse», qui «raconte bien dans ses mots» (SPLEN, p. 274), est, même dans la parole (comme avec la mention des onomatopées), coincée dans une oralité qui n’est bonne qu’à divertir et qui ne trouve pas d’inscription dans la littératie.
Il est vrai que suite à ses observations des prostituées, Alexandre Parent-Duchâtelet relève l’expressivité particulière de ces femmes : «c’est un flux de paroles qui, par leur nature et l’originalité de leurs expressions, forment une éloquence qui n’est propre qu’à cette classe et qui diffère de celle des halles et des autres classes du peuple[23]». Dans le roman, un imaginaire semblable est suggéré, alors qu’Esther reprend ses manières de courtisane auprès de ses anciennes amies. À l’opéra, elles parlent, elles amusent : «le baron riait de toutes ces niaiseries au gros sel, mais il ne les comprenait pas toujours sur-le-champ, en sorte que son rire ressemblait à ces fusées oubliées qui partent après un feu d’artifice» (SPLEN, p. 246). Comme l’extrait l’indique, une séparation demeure entre le baron, représentant de l’écrit, et ces femmes, toutes de corps et d’oralité, alors que leur manière de s’exprimer signale à quelle classe elles appartiennent. Dans ce cas, malgré son éducation nouvelle, qui ne sera pas complétée jusqu’au bout (le corps résiste, et la lettre refuse de l’accueillir), Esther ne parvient pas à sauver la pureté qu’elle a regagnée avec son baptême. En se suicidant, elle signe la dernière tentative du corps de se rebeller face à un monde auquel elle n’aura jamais réussi à appartenir. En effet, Esther ne laisse ni lettre ni testament.
Dès lors, la relation qu’entretiennent le corps et l’écrit se pose comme un enjeu essentiel du roman. Pour Esther, cette relation prend l’aspect d’une lutte impossible à gagner, mais pour les nombreux personnages lettrés qui œuvrent dans le récit, d’autres rapports sont également évoqués. Plutôt que de faire l’histoire d’un combat net entre le corps et l’écrit, le récit dévoile, à travers des personnages agissant dans différents milieux de la littératie, l’ambiguïté de son pouvoir. S’il y a un déplacement des valeurs et des moyens, bref une structuration du pouvoir et de l’organisation sociale qui se recentre sur l’écrit, celui-ci prend plusieurs formes dont l’influence et l’autorité varient. Et pourtant, le corps tient une place fondamentale dans le récit, ne serait-ce que par les nombreuses et vastes descriptions physiques (le corps occupe le texte, à savoir qu’il préoccupe l’écriture) ou la présence d’une oralité transcrite parfois phonétiquement dans les dialogues de Peyrade déguisé en Anglais, de Nucingen et des forçats. Il y a encore le drame entourant Esther, cette Cendrillon sans éducation[24], en fuite au bal, et qui n’échappe pas une pantoufle de verre, mais un regard, ce qui suffit pour la compromettre. Son prince charmant, Lucien, est aussi prêt à la remplacer par une femme ayant ce qui manque à la courtisane : un titre s’appuyant sur l’appartenance au monde littératien. Ce qui est curieux, est que Lucien lui-même cherche en Clotilde ce qui lui manque, c’est-à-dire que, comme Esther, il a d’abord son corps pour le servir. Effectivement, sans la beauté du jeune homme, si souvent soulignée et sans laquelle aucune des femmes, à commencer par Mme Bargeton, Mme de Sérizy, Mme de Maufrigneuse, Coralie et Esther ne l’auraient désiré, le dandy n’aurait pas eu d’introduction auprès des personnages d’importance auxquels il veut s’allier. Dans ce cas, l’élévation sociale de Lucien n’aurait sans doute eu lieu que s’il avait réellement poursuivi son ambition d’écrivain. Alors qu’en est-il des personnages littératiens n’ayant pas de grandes qualités physiques? De ceux qui s’en remettent complètement à l’écriture? Où se positionnent-ils, quel est leur pouvoir et quelle relation entretiennent-ils avec le corps?
Du côté de la littératie
Suivant Clotilde de Granlieu, elle dont le statut, comme l’accoutrement et le maintien indiquent sa position et font d’elle un mariage avantageux – «malgré sa prestance de planche, elle tenait de son éducation et de sa race un air de grandeur, une contenance fière […] qui signalait en elle une fille de bonne maison» (SPLEN, p. 114-115) – la relation au corps est très problématique. En effet, si son corps, parfaitement dompté par la lettre, atteste de son instruction, il coupe cependant la jeune femme de ses désirs charnels : «il [Lucien] écrivait à Clotilde des lettres qui certes étaient des chefs-d’œuvre littéraires du premier ordre et Clotilde y répondait en luttant de génie dans l’expression de cet amour furieux sur le papier, car elle ne pouvait aimer que de cette façon (SPLEN, p. 110). Alors qu’Esther n’est pas en mesure de changer de sang, de s’inscrire positivement à l’encre dans la société, Clotilde, qui n’a que peu d’attributs corporels, n’a que son adhésion au système graphique de son époque pour la rendre visible. Elle se fie d’ailleurs à la notoriété de sa famille pour se rapprocher de Lucien : «Clotilde, qui se savait de suffisants avantages dans son nom, loin de prendre la peine de déguiser ce défaut [corsage plat], le faisait héroïquement ressortir» (SPLEN, p. 114). Dans le roman, le personnage de Clotilde permet de souligner la puissance de la culture littératienne (c’est pour cette raison qu’elle s’attire les faveurs de Lucien), mais aussi son caractère envahissant. En effet, en déplaçant le corporel sur la feuille de papier, l’écriture pousse les personnages littératiens à négliger un savoir du corps qui peut prouver être essentiel dans des situations échappant à l’écrit: par exemple, s’ils rencontrent des individus échappant à leur sphère sociale. Car le roman met aussi en scène des personnages de la marge, ceux qui marchent entre les lignes (entre autres, de la loi, comme Peyrade et sa troupe, ou Collin), alors que la blancheur laissée là est un espace de création, de riposte : «cet espace constitue de facto un lieu matériel disponible et tentant pour toute espèce d’insertion linéaire[25]».
Pour le baron de Nucingen, Esther, est celle qui passe entre les mots, qui, jusqu’au dernier moment, se soustrait à l’autorité du banquier. À en croire la relation de la jeune femme et M. de Nucingen, exceller dans les affaires ne garantit pas la supériorité, malgré la valorisation de ce savoir dans le roman. En effet, Esther qui connaît bien les hommes, leurs désirs, est en mesure de rivaliser avec le baron à cause de son savoir du corps, cet acquis qui manque au vieil homme. Pourtant, Nucingen est un individu respecté, il détient une expertise bancaire qui fait de lui un homme puissant, bougeant avec son temps :
Loin de suivre le mouvement des affaires, l’écriture en devient, à proprement parler une condition de possibilité, un outil essentiel. Activité transversale, pratique qui irrigue d’autres pratiques, le redimensionnement des conditions de production des écritures accompagne et entraîne d’autres transformations. L’écriture – et les écritures comptables et chiffrées – devient aussi un produit en propre de l’activité économique, ce dont témoigne l’essor considérable des services publics et privés, tels que la poste, la banque ou l’assurance[26]».
En ce sens, Nucingen connaît la force de l’écriture. Cette conscience fait de lui un adversaire redoutable pour les hommes d’affaires. Lui qui a bâti son empire grâce à des combines qui profitent du système écrit, de sa régularité comme des injustices qui s’y glissent et font de l’écriture un matériel interprétable, règne à la bourse:
Forcer les États européens à emprunter à vingt ou dix pour cent, gagner ces dix ou vingt pour cent avec les capitaux du public, rançonner en grand les industries en s’emparant des matières premières, tendre au fondateur d’une affaire une corde pour le soutenir hors de l’eau jusqu’à ce qu’on ait repêché son entreprise asphyxiée, enfin toutes ces batailles d’écus gagnées constituent la haute politique de l’argent […] ces grandes choses se passent entre bergers (SPLEN, p. 208).
Si dans le monde boursier, le baron est un «berger», qu’il mène, le contraire se produit avec la courtisane. En croisant Esther, le vieil homme est confronté pour la première fois au corps, devant lequel il perd sa froide raison de banquier. Mené par le bout du nez, esclave de passions qu’il n’a jamais dû apprendre à contrôler, Nucingen représente l’antithèse d’Esther.
Ayant d’abord un corps de chiffres et de lettres, il lui est impossible de séduire la jeune femme qui réussit à l’étourdir sans rien lui donner. Elle, qui «apporte du désordre dans ses idées» (SLPEN, p. 186), bouleverse le baron en l’incitant à quitter sa raison et à suivre ses désirs. Sachant qu’il est sans pouvoir devant elle : «che ne suis bas le maidre» (SPLEN, p. 219, le vieil homme est facilement déjoué par la courtisane qui fait de lui son chien : «“Ici, Nucingen!…” fit Esther en le rappelant par un geste hautain. Le baron se pencha avec une servilité canine» (SPLEN, p. 275). En effet, ce n’est que lorsqu’il s’éloigne : «il reprenait en sortant sa peau de Loup-cervier» (SPLEN, p. 218) que le baron retrouve la raison et sors de sa fourrure d’animal dompté, comme à la mort d’Esther : «le Loup-cervier s’arracha le faux toupet qu’il mêlait à ses cheveux gris depuis trois mois» (SPLEN, p. 329). Il recouvre alors sa vision de lynx[27], sa froideur de prédateur qui, plutôt que de le placer dans l’animalité, le retourne au commerce, à l’écriture. Effectivement, le nom de cet animal est utilisé pour signifier la violence des hommes d’affaires[28], alors que le lynx est considéré comme: «une véritable bête féroce, faisant de grands dégâts dans les troupeaux de moutons», étant donc « bien connu et redouté des bergers[29]». Dans ce cas, l’association au loup-cervier suggère l’habileté et la brutalité du baron, qui en plus de chasser les moutons (les petites entreprises), est également réputé comme dangereux pour les meneurs de la Bourse, les bergers. Dès lors, l’animalité du baron, loin de le rapprocher d’Esther et de lui fournir un savoir du corps, relance à nouveau le motif de la lettre. Animal de l’écrit, dans l’écrit, il ne chasse que sur le papier. Pour cette raison, lorsque Nucingen en a assez de se faire avoir par la courtisane, il utilise les seules armes qu’il possède:
Toujours battu pas la Torpille, il se résolut à traiter l’affaire de son mariage par correspondance, afin d’obtenir d’elle un engagement chirographaire. Les banquiers ne croient qu’aux lettres de change. Donc, le Loup-cervier se leva, dans un des premiers jours de cette année, de bonne heure, s’enferma dans son cabinet et se mit à composer la lettre suivante, écrite en bon français; car, s’il le prononçait mal, il l’orthographiait très bien (SPLEN, p. 220).
Dans le roman, tout indique que l’expérience et la maîtrise du corps sont manquantes chez le baron. Vieux, souffrant d’indigestions, prononçant mal le français, se faisant berner par les charmes d’Esther, il est pourtant parfaitement froid dans sa missive, il écrit un français sans faute, bref, il est à l’aise dans son domaine de papier. Résolu, il demande à Esther une preuve (écrite et donc officielle) de sa participation à la transaction précédemment sous-entendue. Comme l’indique Goody, l’écriture permet de : «rendre explicite ce qui autrement est implicite[30]». Il est vrai que plus tôt, Esther pensait pouvoir échapper à Nucingen en le maintenant dans une position de père au lieu d’amant : «elle crut à une transaction impossible […] elle ensorcela le vieillard qui promit de rester père pendant quarante jours» (SPLEN, p. 218), cependant, cette fois Nucingen opère à distance, et par écrit, il est alors en mesure de formuler ce qu’il attend d’elle: «dites-moi que le jour où vous prendrez possession de votre maison, vous accepterez le cœur et la servitude de celui qui se dit […] votre esclave» (SPLEN, p. 222). L’écrit est ici utilisé pour clarifier les attentes de Nucingen et apporter une certaine formalité à la relation qu’il entretient avec Esther, pour tenter de reprendre le contrôle. Quel contraste alors, quand Esther lui répond en enfreignant plusieurs codes de l’écrit ; elle utilise un papier inadéquat, le remplit sans laisser de marge, et ce, d’une seule phrase répétée ayant pour référence le vaudeville: «“eh! Il m’ennuie, ce pot à millions!” s’écria Esther redevenue courtisane. Elle prit du papier à poulet et écrivit, tant que le papier put la contenir, la célèbre phrase, devenue proverbe à la gloire de Scribe: Prenez mon ours[31]» (SPLEN, p. 222). À la réception de cette lettre, puis des deux autres, dans lesquelles la courtisane se repend, le baron demeure perplexe. Sa femme lui reproche de vouloir acheter l’amour d’Esther, mais le baron, ne sachant pas comment utiliser le conseil de Mme de Nucingen (de faire savoir à Esther qu’il souffre d’amour pour elle par la bouche de quelqu’un d’autre), s’en remet encore à son argent, étant: «confiant dans le magnétisme de sa caisse» (SPLEN, p. 226). Confondant don de soi et transaction, Nucingen représente ici un contre-exemple à la toute-puissance de l’écrit.
Pétri comme banquier, devant ruser, devant lire le monde avec des yeux d’acheteur, le baron ne sait pas reconnaître qu’il est l’objet d’une double fraude. En effet, la transaction entre Esther et lui se révèle être une tromperie puisque Esther est prête à faire l’amante une nuit, mais refuse de l’aimer, et que Collin, muni d’Europe et d’Asie, s’empresse de soutirer le plus d’argent possible au vieil homme. Plus étonnant encore est le fait que Nucingen désire tant Esther qu’il se laisse parfois avoir en toute connaissance de cause. C’est le cas du marchandage entre le banquier et Europe, alors qu’il est conscient de payer trop cher les services de la femme de chambre : «di auras pien des ogassions te me garodder…. nis verons gonnaissance» (SPLEN, p. 164), mais accepte ses termes. Il ne se doute pas, par contre, qu’il paye pour une autre femme, une Anglaise placée dans l’appartement d’Esther afin de l’obliger à payer de nouveau lorsque la courtisane lui sera réellement présentée.
Dès lors, les développements entourant Nucingen, qui a réussi à bâtir son empire avec des outils propres à son siècle, des techniques qui fonctionnent grâce à une certaine fragilité de l’écriture comme moyen d’organiser et de contrôler le commerce et la loi, suggèrent que l’écrit est à la fois un instrument d’ordre et de désordre, comme le propose cette comparaison: «un banquier s’habitue à combiner les affaires, à les étudier, à faire mouvoir les intérêts, comme un vaudevilliste se dresse à combiner des situations, à étudier des sujets, à faire mouvoir des personnages» (SPLEN, p. 225). Comme le vaudeville est un joyeux manège, comique et dynamique, il est révélateur que le travail du banquier, qui évoque un imaginaire raisonnable, soit mêlé aux combines rocambolesques du théâtre: le vieil homme, dangereux en affaires, est lui-même un personnage dans la grande comédie de Jacques Collin, dans ce « vaudeville des fausses dettes» (SPLEN, p. 180) auquel il se fait prendre. Tout compte fait, Nucingen se fait facilement manipuler par des gens dont les procédés s’écartent de la logique inhérente au système bancaire, par ceux qui ont des moyens extérieurs. Ayant pour adversaire un homme inconnu, qui, caché dans les coulisses, est capable de monter une histoire de dettes pour Esther (dans laquelle le baron joue un personnage crédule), Nucingen se fait entraîner dans des combinaisons douteuses, des affaires dont les termes lui sont inconnus. En dehors de la Bourse, le banquier est victime des manœuvres de comédiennes d’Europe, qui joue la femme de chambre, et d’Asie en «madame La Ressource» (SPLEN, p. 181), usurière pour les courtisanes.

James-Jacques-Joseph Tissot (1836–1902), L’Ambitieuse, circa 1883–1885. Huile sur toile, 142 x 101 cm. Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York. Gift of William M. Chase, 1909.
(Credit : https://www.incollect.com/articles/paris-the-countryside-modern-life-in-late-19th-century-france)
Il apparaît ainsi que Nucingen, loin de pouvoir profiter de son savoir littératien pour gérer sa relation avec Esther, est plutôt embarrassé par celui-ci. Plus encore, il en est réellement prisonnier, puisqu’à chaque nouveau problème, il trouve en l’écriture son unique ressource, mais que celle-ci ne lui est d’aucune utilité pour se faire aimer par la jeune femme ou pour comprendre le jeu de Collin. Nucingen, comme Esther, n’est donc pas en mesure de se libérer du pouvoir de l’écrit, qui conditionne si gravement les deux personnages, en excluant la courtisane de la lettre et le vieil homme du corporel, qu’ils se retrouvent tous deux dans une situation similaire, c’est-à-dire qu’ils sont deux acteurs dans le drame que Jacques Collin met en place, et ce, précisément à cause des savoirs qui manquent à chacun d’eux. En effet, comme il a été mentionné plus tôt, l’ancien forçat a choisi de garder Esther auprès de lui, car il croyait qu’elle serait utile dans le futur. Collin voit en Esther une ressource fiable: «vous êtes fille, vous resterez fille, vous mourrez fille ; car, malgré les séduisantes théories des éleveurs de bêtes, on ne peut devenir ici-bas, que ce qu’on est» (SPLEN, p. 85). Certain de la maintenir dans le corps (l’animalité), en apprenant que le baron a vu la courtisane et qu’il la cherche, Collin profite du savoir corporel d’Esther pour «ensorceler» le banquier, tout en étant assuré que la jeune femme lui demeure fidèle, par amour pour Lucien, oui, mais aussi parce qu’il est convaincu qu’elle ne saurait se rebeller contre lui, n’étant pas suffisamment familiarisée avec l’univers littératien pour justifier à Lucien de la suivre. En fait, même si elle le voulait (ce qu’elle n’essaye pas), Esther ne pourrait pas donner à Lucien le statut qu’il souhaite.
Pour ce qui est de Nucingen, il fait exactement ce que Collin attend de lui ; il se laisse soutirer son argent, tout en se préoccupant uniquement de se rapprocher d’Esther et de toucher son «dû». Il n’y a donc par de sortie de l’emprise de la lettre par le personnage hautement littératien, ni par celle qui pourrait faussement passer pour une figure d’opposition face à la loi de l’écrit. Le couple d’Esther et de Nucingen, mais aussi celui de Lucien et de Clotilde, soulignent comment, dans le roman, l’imaginaire amoureux est miné par la lettre : Clotilde et le baron (qui aiment) se font jouer par ceux qui ont un savoir du corps, mais ils sont également en mesure de les retenir avec un contrat ou un mariage. De leur côté, Lucien et Esther sont définitivement séparés par la lettre.
Selon ces trois couples de personnages, mais plutôt selon l’ensemble des rapports qu’entretiennent les personnages entre eux, ce qui semble se dessiner dans le roman est l’incroyable efficacité qu’à l’écriture pour se glisser dans chaque relation, dans chaque espace [32], pour en modifier les termes. Suivant ce que relève Goody comme conséquence de l’emploi massif de l’écriture, celle-ci devient essentielle pour gérer la société, et ce, dans chaque domaine. Elle se coule alors inévitablement: «dans tous les aspects de la vie domestique, fournissant un instrument de contrôle redoutable de la vie familiale[33]». Par conséquent, celui qui sait reconnaître et utiliser ce dispositif est en mesure de manipuler l’écriture en sa faveur. C’est exactement ce que fait Jacques Collin qui profite du contrat formulé entre Esther et Nucingen pour se procurer l’argent qu’il lui faut, puisque Esther sait qu’elle ne peut pas refuser le banquier et continue donc à jouer son rôle de courtisane en se vengeant de son mieux: «Esther avait résolu de faire payer bien cher au pauvre millionnaire ce que le millionnaire appelait son chour te driomphe» (SPLEN, p. 270). Collin s’arme également des lettres d’amour de Mme de Maufrigneuse, Mme de Sérizy et de Clotilde. Si ces lettres n’ont pas le caractère officiel d’autres types de documents, elles n’en demeurent pas moins des preuves des relations qu’ont entretenues ces femmes avec Lucien (et ainsi ont une valeur juridique), en plus de fournir une matière idéale de chantage : «regardons comme certain que Jacques Collin a mis en lieu sûr, selon l’habitude de ces misérables, les lettres les plus compromettantes de la correspondance du beau jeune homme» (SPLEN, p. 462). Parce que le brigand comprend que l’écrit fait preuve, il sait à quel point il peut s’avérer dommageable. Muni des lettres, il s’organise alors pour contaminer les esprits les plus attachés à la loi. Par exemple, M. de Grandville, trop conscient du malheur qui suivrait le nom de M. Sérizy si Paris savait que la passion de sa femme pour Lucien liait ainsi sa famille à une histoire criminelle, est prêt à déroger de ses fonctions pour taire l’affaire, qui autrement se trouverait à être archivée :
Pouvons-nous tuer le comte, la comtesse de Sérizy, Lucien, pour un vol de sept cent cinquante mille francs, encore hypothétique et commis d’ailleurs au préjudice de Lucien? ne vaut-il pas mieux lui laisser perdre cette somme que de le perdre de réputation?… surtout quand il entraîne dans sa chute un ministre d’État, sa femme et la duchesse de Maufrigneuse (SPLEN, p. 440).
De cette façon, le papier se pose entre les corps et ce, qu’il s’agisse de billets doux ou de contrats, mais aussi de procès-verbaux qui, à la fois dans les mains de Mme de Sérizy et de Camusot, sont brûlés : «elle saisit les interrogatoires et les lança dans le feu ; mais Camusot les y reprit, la comtesse s’élança sur le juge et ressaisit les papiers enflammés» (SPLEN, p. 438). L’importance de cette scène dans le récit, souligne comment, malgré les preuves innombrables de l’autorité de la lettre, sa puissance est pourtant relativisée : si sa présence modifie les termes des relations et des situations que vivent les personnages dans le roman, sa suppression aussi. Exactement comme les femmes qui retrouvent leur assurance, du fait que leurs correspondances avec Lucien soient recouvrées, c’est l’effacement du procès-verbal du jeune homme qui donne la possibilité à M. de Grandville de se saisir de l’affaire et de sauver le nom de son ami. Dans ce cas, le roman se refuse à diviser complètement l’écrit et le corporel, la raison graphique et son conditionnement littératien, d’avec les désirs et les moyens du corps : l’ambiguïté de l’écriture demeure, elle est interprétable. Seuls les personnages possédant un savoir du corps et un savoir de la lettre sont alors en mesure d’utiliser ce qui est écrit et ce qui ne l’est pas.
Savoir de comédien, interpréter et improviser
Dès lors, ceux qui ont les moyens de se révolter contre la loi écrite ou encore, qui peuvent la contrôler, sont des comédiens, des metteurs en scène, c’est-à-dire des personnages qui maîtrisent le corps et la lettre, qui savent les lire et en ruser. Ces personnages interprètent l’écrit et improvisent là où il manque, comme Collin qui, ayant confiance en ses habiletés, invite Camusot à étudier son procès-verbal en réaffirmant sa position d’innocence : «si vous avez fidèlement écrit l’explication que je vous ai donnée en commençant, vous pouvez la relire, répondit Jacques Collin, je ne puis varier» (SPLEN, p. 403). Camusot lui-même, qui navigue sans peine sur un «océan de renseignements» (SPLEN, p. 370), est placé en position de pouvoir puisque: «la police a […] des dossiers, presque toujours exacts, sur toutes les familles et tous les individus dont la vie est suspecte […] elle n’ignore rien de toutes les déviations» (SPLEN, p. 369) et «quelque haut placée que soit une famille elle ne saurait se garantir de cette providence sociale» (SPLEN, p. 370). D’abord porteur d’un savoir de l’écrit, il est à la fois attentif aux mots et au corps, ce qui est exigé par son métier de juge. Par exemple, ceci est souligné lorsque Jacques Collin fait le malade: «je ne vais croire à cette maladie que pour étudier le jeu de mon homme, dit en souriant M. Camusot» (SPLEN, p.375), puis dans cette scène du procès-verbal, qu’il contrôle:
– il est dans votre intérêt et surtout dans celui de Lucien de Rubempré de tout dire, répondit le juge. – Eh bien, c’est… ô mon Dieu!… c’est mon fils […] “n’écrivez pas cela, Coquart”, dit Camusot tout bas […] “si c’est Jacques Collin, c’est un bien grand comédien!… pensait Camusot […] il faut lui enlever sa perruque (SPLEN, p. 397).
De plus, l’homme de loi doit jouer le juge stoïque tout en lisant les moindres signes de culpabilité des détenus. Cette double posture d’acteur et de lecteur lui permet de circuler dans le domaine de l’écrit et du corporel sans se perdre (comme Nucingen). Camusot, qui est en constant contact avec des individus de la marge (comme les détenus), Corentin et sa bande, puis Collin, qui rodent eux-mêmes dans plusieurs sphères, sont des personnages qui réussissent à se positionner avec avantage dans la société, telle que présentée dans le roman. Parce qu’ils maîtrisent la logique littératienne de leur époque ainsi qu’un certain savoir du corps, de son langage : «il n’y a que vous autres femmes qui puissiez, comme nous et les prévenus, lancer dans une œillade échangée, des scènes entières où se révèlent des tromperies compliquées comme des serrures de sûreté. On se dit, vois-tu, des volumes de soupçons en une seconde» (SPLEN, p. 462), en lecteurs polyvalents, ils ne sont pas soumis à la puissance de l’écrit. De leur côté, les personnages dont un trop grand conditionnement à l’écrit les éloigne du corps, ou encore, les personnages comme Esther et Lucien (sa position est ambivalente : il maîtrise certains codes dans les deux cas, mais pas suffisamment pour réussir seul) qui sont constamment ramenés au corporel, constituent alors des cartes à jouer. Il s’agit de l’expression qu’utilisent à la fois Corentin : «nous, pour qui les hommes sont des cartes, nous ne devons jamais être joués par eux» (SPLEN, p. 174) et Jacques Collin : «aujourd’hui, dit Carlos à sa créature, nous jouons le tout pour le tout ; mais heureusement les cartes sont biseautées et les pontes sont très jeunes» (SPLEN, p.174). Collin, en joueur expérimenté, a marqué ses cartes, il sait à qui il a affaire. Pour lui, mais aussi pour les autres personnages aux habiletés de comédien et de metteur en scène, la page blanche ou noircie d’écriture, tout comme le corps assujetti ou délinquant face à la loi, ne sont que des données de jeu, des éléments à lire, interpréter et utiliser en leur faveur.
Finalement, Splendeurs et misères des courtisanes, est un récit qui donne à lire la relation problématique du corps et de l’écrit dans une société qui valorise de plus en plus la lettre : celle-ci se transforme en redoutable arme d’avancement social et de justice. À la manière d’un aimant, elle attire, du fait que le pouvoir se trouve à son contact, mais une fois conditionné à sa logique, il devient impossible de s’en dégager, d’où l’effet d’emprisonnement dont souffrent des personnages comme Nucingen. De son côté, le corporel est présenté, non pas comme une voie possible de révolte contre l’écriture, le cas d’Esther prouve le contraire, mais plutôt comme un second médium pour lire le monde, qui lié à un savoir de l’écrit, permet aux personnages comme Collin de maîtriser l’absence d’écriture, d’improviser quand ils se retrouvent en dehors de la logique propre à la littératie. En ce sens, l’imaginaire représenté dans le roman permet de saisir l’importance de l’écriture en tant que «technologie de l’intellect». Comme l’indique Jack Goody : «lorsque nous tenons un stylo en main, nous ne sommes pas les mêmes que lorsque nous portons une épée […] nous avons des rôles différents qui structurent nos perceptions »[34]. Inévitablement, les personnages qui savent se glisser dans plus d’un rôle ont une vision plus large, ils peuvent profiter de la mobilité de leur position pour parcourir la feuille comme les rues de Paris, comme les différentes sphères sociales.
Bibliographie
[1]Daniel Fabre, « Lettrés et illettrés. Perspective anthropologiques », dans B. Fraenkel (dir.), Illettrismes. Variations historiques et anthropologiques. Écritures IV, Paris, Centre Georges Pompidou, Bibliothèque publique d’information, coll. « Études et Recherches », 1993, p. 173.
[2] Selon les travaux de l’anthropologue Jack Goody, dans La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, Éditions de Minuit, 1979, 274 p.
[3] Jack Goody, op. cit., p. 97.
[4] Jack Goody, Pouvoirs et savoirs de l’écrit, Paris, La Dispute, 2007, p. 194.
[5] Daniel Fabre, op. cit., p. 173.
[6] Ibidem.
[7] Comme le stipule Roger Chartier: «l’écriture n’est pas toute entière du côté de l’ordre imposé, des stratégies des puissants, de la coercition et de la discipline. Elle peut être aussi, en dehors des autorités ou contre elles», «Culture écrite et littérature à l’âge moderne», Annales. Histoire, Sciences sociales, 56e année, no. 4-5, 2001, p. 793.
[8] Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des Courtisanes, Paris, Le livre de poche, coll. «Classique», 1963, 639 p. Dans le corps de texte, les extraits provenant de ce roman seront maintenant référés par la mention (SPLEN, p. ).
[9] Marie Scarpa et Jean-Marie Privat, « Le colonel Chabert ou le roman de la littératie », Horizons ethnocritiques. Sous la direction de Jean-Marie Privat et Marie Scarpa, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2010, p. 141.
[10] Consulter l’article de Marie Scarpa et Jean-Marie Privat précédemment cité pour approfondir le problème de l’autorité de l’écrit sur le statut vivant non-vivant du colonel Chabert.
[11] Ibid., p. 165.
[12] Jack Goody, op. cit., p. 254.
[13]Delphine Gardey, « Écrire: de l’administration aux affaires » dans Écrire, calculer, classer. Comment une révolution de papier a transformé les sociétés contemporaines (1800-1940), Paris, Éditions La Découverte, coll. « Textes à l’appui/antrhopologie des sciences et des techniques » 2008, p. 76.
[14] W. H, Van Der Gun, La courtisane romantique et son rôle dans la Comédie Humaine de Balzac, Assen, Van Gorcum, 1963, p. 80.
[15] Ibid., p. 81.
[16] Jean-Marie Privat, « Cartes et autres objets variés et multiples. Un habitus littératien? », Pratiques: linguistique, littérature, didactique, no. 131-132, 2006, p. 127.
[17]Jack Goody, Pouvoirs et savoirs de l’écrit, op. cit., p. 198.
[18] Alain Corbin, Les filles de noce. Misère sexuelles et prostitution au XIXe siècle, Paris, Flammarion, coll. « Champs histoire », 1982, p. 55.
[19] Eugène François Vidocq, dans W. H, Van Der Gun, La courtisane romantique et son rôle dans la Comédie Humaine de Balzac. op. cit., p. 20.
[20] Jean-Marie-Privat, op. cit., p. 130.
[21] Roger Cartier, op. cit., p. 789.
[22] Delphine Gardey, op. cit., p. 76.
[23]Alexandre Parent-Duchâtelet, La prostitution à Paris au XIXe siècle, Paris, Éditions du Seuil, 1981, p. 116.
[24] Contrairement à Cendrillon, qui dans ses habits magiques, n’est pas reconnue, elle qui danse «avec tant de grâce» et fait «mille civilités» (Charles Perrault, Contes en vers et en prose, Genève, Éditions d’art Albert Skira, coll. « Les trésors de la littérature française », 1944, p. 149-150) à ses sœurs, et atteste d’un savoir mondain, d’un apprentissage du corps civilisé, Esther est reconnue malgré l’habit qui la masque, et ce à cause de son comportement et des formes de son corps. Au lieu d’un prince retournant le royaume pour la retrouver, elle aura à ses trousses la police secrète de Corentin, Contenson et Peyrade, engagée par le baron de Nucingen pour identifier la femme aperçue un soir au bois.
[25] Jean-Marie Privat, « Entre les lignes », Captures, vol. 2, no. 2, 2017, dossier « Imaginaire de la ligne », p. 4.
[26] Delphine Gardey, op. cit., p. 74.
[27] Le loup-cervier (lupus cervarius, loup qui chasse le cerf), est un second nom pour le lynx d’Eurasie et d’Amérique boréale, selon la définition du Larousse, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/loup-cervier , consulté le 2018-12-09.
[28] Voir https://www.le-tresor-de-la-langue.fr/definition/loup-cervier, consulté le 2018-12-09.
[29] Annales de la Société d’histoire naturelle de Toulon, Toulon, siège social: Museum d’histoire naturelle, 1911, p. 138.
[30] Jack Goody, La logique de l’écriture. Aux origines des sociétés humaines, Paris, Armand Colin, 1986, p. 164.
[31] Dans le vaudeville L’ours et le pacha, écrit par Eugène Scribe et Joseph-Xavier Boniface, et joué pour la première fois, le 10 février 1820, la phrase «prenez mon ours» est prononcée par le personnage de Lagingeole qui tente de vendre les services de son ours avec empressement (il s’agira en réalité de son camarade revêtant la peau d’un ours). Dans ce cas, en utilisant cette phrase, Esther peut signifier que si le baron veut conclure la transaction, que ce soit fait, et vite, que la jeune femme puisse s’en débarrasser. Cependant, comme Lagingeole, elle vend quelque chose de faux, c’est-à-dire qu’elle se déguise en amante pour Nucingen, sans lui donner ce qu’il croit acheter : son amour. Pièce consultée en ligne sur : Théâtre-documentation.com, http://xn--thtre-documentation-cvb0m.com/content/l%E2%80%99ours-et-le-pacha-eug%C3%A8ne-scribe-xavier-boniface-saintine, consultée le 2018-12-05.
[32] Il suffit de repenser au bal, où les anciens camarades de Lucien se définissent entre eux selon leur manière de s’exprimer (qui rappelle le type d’articles qu’ils écrivent), pour s’apercevoir que l’écrit s’immisce entre les êtres sans nécessairement représenter un document officiel, mais que sa seule présence, peu importe sa forme, altère les rapports de force. Par exemple, du fait que Lucien correspond avec Clotilde, il connaît les sentiments de la jeune femme et est en mesure de jouer son rôle d’amant et de s’assurer de la volonté de celle-ci de l’épouser.
[33] Jack Goody, La logique de l’écriture. Aux origines des sociétés humaines, op. cit., p. 160.
[34] Jack Goody, Pouvoirs et savoirs de l’écrit, op. cit., p. 198.
