Hors collection, 01/01/2009
Le son du trombone qui tombe. Lecture et imaginaire

À quoi ressemble un événement en lecture? Quand sait-on avoir aperçu quelque chose? À quel moment une perception devient-elle un fait, une présence? Un fait sur lequel se construit une interprétation et ultimement une lecture?
La lecture est une expérience, tout aussi dense que notre expérience du monde. Elle engage tous nos sens et notre capacité à percevoir, à imaginer et à rendre signifiant ces signes par lesquels un texte se laisse connaître. Elle implique que nous ayons la capacité à nous figurer des choses, à transformer l’absence en signe, en des entités complexes qui s’imposent à notre esprit. Comme le dit Richard Kearney, dans Poétique du possible, «Exister, c’est figurer. Tout ce qui existe pour nous dans notre monde, que ce soit une chose ou une personne que l’on perçoit/imagine/signifie ou une œuvre ou une action que l’on fait, tout ceci est figuré par nous.» (Kearney, 1984: 48)
Un fait de lecture, comme un événement dans le monde, c’est donc toujours un fait que nous avons figuré, un fait dont nous avons établi la présence et la forme, à partir de nos filtres et de nos interprétants, et que nous avons projeté sur la scène de nos propres croyances et convictions.
Un texte, nous dit Michel Charles, n’existe que par la lecture. Il n’y a pas de texte en soi, comme il n’y a pas de fait en soi, il n’y a que des constructions (Charles, 1995). Le texte n’offre que des mots, et c’est au lecteur de les saisir, d’en prendre possession et d’en imaginer la forme. C’est au lecteur d’animer cette matière inerte et d’y insuffler une vie, qui ne sera jamais qu’une vue de l’esprit, qu’un objet de pensée.
Or, qu’est-ce qui ponctue ce travail de figuration du texte? Comment le décrire? À quels processus est liée la figuration? Pour Kearney, dont je suivrai quelque peu ici la pensée ici, «La figuration se divise en trois modalités principales de conscience: perception, imagination et signification.» (Kearney, 1984: 53) Figurer, c’est donc percevoir, imaginer et manipuler une forme. Par ces trois gestes, nous nous donnons des figures, ces signes qui deviennent aisément des vecteurs de signification et qui permettent d’ouvrir des espaces sémiotiques, des imaginaires où nous nous projetons et où nous projetons des scènes qui sont celles, possibles, de notre rapport au monde.
Pour Kearney, le verbe figurer, dans ses multiples usages, rend compte de ce travail de la pensée imaginante qui seule parvient à saisir le monde et à le construire. Comme il le dit, «Le monde et le soi ne sont pas des présences données. L’homme crée son monde, c’est-à-dire le sens fondamental des personnes, choses ou œuvres qui l’entourent, tout en se créant lui-même […]». (Kearney, 1984: 45) Or, cette double création – «L’homme est la création qui se crée.»– se révèle présente à même les usages du verbe figurer:
On peut figurer le monde (dans le sens de le percevoir ou de le former); on peut se figurer le monde (dans le sens de l’imaginer ou de le figurer); ou on peut figurer dans le monde (dans le sens d’y agir ou d’y jouer un rôle, c’est-à-dire dans le sens d’exister comme figurant-acteur-agent). Dans tous ces sens […], la figuration désigne une transcendance temporalisante par laquelle l’homme s’absente de tout ce qui est présent afin de se diriger vers ce qui est absent (possible) et le présenter ensuite comme monde. Le possible est le sens du monde; et la figuration donne sens au monde en réalisant le possible, c’est-à-dire en présentant et en présentifiant ce qui est absent. (Kearney, 1984: 48)
Si la figure est un événement de lecture, c’est dire que son apparition tient moins à un dispositif textuel qu’à un travail de perception et d’imagination du lecteur qui, s’emparant de ce dispositif, rend présent ce qui initialement se donnait comme absent. Figurer, construire des figures, c’est percevoir, au-delà de l’absence, ce qui était malgré tout présent et qui s’impose alors, et indéniablement, comme fait.
Figurer, c’est percevoir, imaginer et manipuler une forme signifiante (Gervais, 2007: 31 et passim). Regardons comment ces trois gestes se réalisent. Et faisons-le en fonction de trois exemples.
Percevoir
Comment un fait se révèle-t-il à nous? Comment une figure s’impose-t-elle comme présence? Georges Didi-Huberman illustre ce fait à l’aide de la poussière en suspens. «La poussière, dit-il, nous montre qu’existe la lumière.» Et il continue en précisant que:
Dans le rai qui tombe au sol, du haut d’un oculus, la poussière semble nous montrer l’idéale existence d’une lumière qui serait épurée des objets qu’elle rend visible: entre un vent d’éther et la fluidité sans but d’infimes particules. Il ne s’agit que d’une fiction, bien sûr, car l’objet, loin d’être épuré, est bien là et c’est la poussière elle-même. Mais il s’agit d’une fiction tangible, ou presque, insaisissable précisément, quoique tactile. (Didi-Huberman, 1998: 57)
La poussière en suspens permet de saisir ce moment élusif où une présence est révélée. Dans une logique qui n’est pas sans rappeler l’aura qui se greffe aux œuvres d’art, notion exploitée par Walter Benjamin, ce n’est pas la poussière ni la lumière, mais la relation subtile et éphémère entre les deux qui crée l’effet de présence. Il faut le contact de la lumière et de la poussière, une lumière segmentée par le cadre d’une fenêtre et de la poussière en suspension dans l’air presque stagnant d’une pièce, pour que quelque chose apparaisse, pour que l’événement de cette apparition survienne. «Ce qui nous obsède ou nous menace, »dit encore Didi-Huberman, «peut tout aussi bien exister, et même souverainement, dans la poussière qui danse au-dessus, autour de nous, la poussière en suspens tout à coup rendue visible dans un rai de lumière, cette poussière que nous respirons même.» (Didi-Huberman, 1998: 57)
Cette situation somme toute familière met en lumière certaines caractéristiques de ce moment où une figure ou une présence s’imposent aux sens: la singularité du moment et l’immédiateté du sentiment qu’il engage, l’événementialité de l’apparition et l’impression ressentie d’y être plongé, la discontinuité requise aussi pour que cette présence se fasse sentir. Car il ne peut y avoir de présence que sur fond d’absence. Il ne peut y avoir apparition que si, dans un premier temps, il n’y avait rien.
La présence n’implique nullement la permanence, mais le dynamisme. Un corps inanimé n’est pas présent, il est à la limite de la disparition. Il se dissout sous nos yeux, comme ces textes lisses dont nous parle Michel Charles et qui disparaissent aussitôt leur lecture complétée. C’est que la figuration ne se comprend que dans le discontinu, l’interruption ou le déséquilibre. Elle ne se réalise que par une perception qui en même temps saisit une chose et l’échappe, l’échappant du fait même de la saisir, comme cette poussière baignée de lumière, qui se laisser percevoir dans son évanescence même.
Imaginer
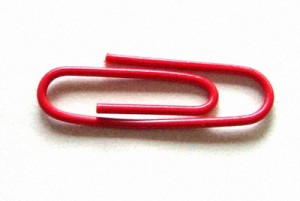
Fig. 1: Trombone rouge
Figurer, c’est percevoir, mais surtout imaginer une forme. Don DeLillo, dans Body Art, roman de 2001, donne un exemple éloquent des liens qui unissent perception et imagination, liens qui, pour être nécessaires, ne garantissent nullement l’authenticité des perceptions qui ont servi de fondements. Comme l’exemple le laissera voir, ce n’est pas parce qu’on peut, à partir d’une perception, figurer un fait ou une présence, que la figure générée implique une présence réelle de ce fait ou une authenticité de cette perception.
L’extrait en question survient en début de chapitre. Il est énoncé à la deuxième personne du singulier, c’est donc qu’il s’adresse à nous en quelque sorte, puisque nous pouvons par la magie de l’identification nous sentir interpellés par ce pronom et concernés par la scène décrite. Or, cet exemple permet à la fois de dévoiler comment se construit un fait de lecture et de montrer à quelles tensions est soumis l’acte d’imagination.
Tu es devant la table en train de déplacer des papiers et tu fais tomber quelque chose. Sauf que tu ne le sais pas. Il te faut une ou deux secondes pour en prendre conscience et même à ce moment-là tu ne le perçois que comme une distorsion informe de l’espace qui grouille autour de ton corps. Mais une fois que tu sais que tu as fait tomber quelque chose tu l’entends heurter le sol, avec un temps de retard. Le son fait son chemin à travers un immense réseau de distances. Tu entends le truc tomber et tu sais ce que c’est au même instant, plus ou moins, et c’est un trombone. Tu le sais au son que ça produit en heurtant le sol et d’après le souvenir retrouvé de la chute elle-même, le truc qui te tombe de la main ou qui glisse du bord de la page à laquelle il était fixé. Il a glissé du bord d’une page. Maintenant que tu sais que tu l’as fait tomber, tu te rappelles comment ça s’est passé, ou tu te rappelles à demi, ou tu le vois plus ou moins peut-être, ou autre chose. Le trombone tombe par terre avec un rebond, infime et immatériel, un son pour lequel il n’existe aucun mot évocateur, le son d’un trombone qui tombe, mais quand tu te penches pour le ramasser, il n’est pas là. (DeLillo, 2001: 91)
Certaines perceptions sont immédiates, on sait au moment même où elles ont lieu qu’elles se produisent. D’autres prennent plus de temps à s’imposer à l’esprit. Elles requièrent d’être interprétées, d’être reconstruites de toutes pièces pour enfin se révéler pour ce qu’elles sont. Toute perception requiert un horizon d’attente, toute figure requiert une préfiguration. Ne peut être perçu que ce qui est attendu, ce qui répond globalement à nos attentes. Richard Kearney le souligne: «Une chose n’est pas perçue en soi mais à travers un horizon d’aperçus. Figurer une chose perceptivement, c’est pré-figurer le ‘tout’ de la chose à partir d’une de ses parties aperçues.» (Kearney, 1984: 56)
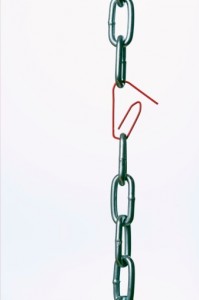
Fig. 2: Chaîne de trombones
Il y a eu un événement, nous dit DeLillo, quelque chose est tombé. Reprenons: il semble y avoir eu événement, quelque chose serait peut-être tombé. Ce n’est pas encore un événement attesté, plutôt «comme une distorsion informe de l’espace». Un mouvement, comme le passage d’une fine poussière dans un rai de lumière. C’est l’intuition d’une discontinuité. Or, cette intuition a la force d’imposer son propre ordre, d’amener le monde à correspondre à ce qui a été intuitivement appréhendé. Il s’est passé quelque chose et, de cette hypothèse, maquillée en constatation, découle une perception. Une perception rétroactivement ressentie: une fois qu’on sait avoir fait tomber quelque chose, écrit DeLillo, on l’entend heurter le sol. La perception s’impose comme un fait, tandis qu’elle n’est véritablement qu’une hypothèse accompagnant un pressentiment. L’ordre causal a été interverti –normalement c’est parce qu’on a entendu un objet heurter le sol qu’on en conclut avoir fait tomber quelque chose, et non le contraire comme ici–, mais l’imagination n’a que faire de la logique et la perception peut bien venir a posteriori confirmer une intuition fondée sur un vague pressentiment.
Mais, dès l’instant où le fait a été établi, l’imagination d’emblée s’emballe et complète la scène. On sait qu’un trombone est tombé et on se figure l’événement. La chute du trombone implique une mise en récit somme toute banale qu’on peut aisément reconstruire, jusqu’à la voir avec les yeux de la pensée. On peut même rejouer la scène au complet, se figurant dans ce monde au même titre qu’on peut y figurer des objets et des incidents. Spontanément, et par notre expérience de telles situations, on interprète les événements et construit une séquence ou un micro-récit qui en justifient et, en quelque sorte, en accréditent la réalité.
D’une perception indistincte, on passe sans heurts à l’établissement d’un événement et à la reconnaissance d’une présence, même si celle-ci n’est qu’une illusion, ce que la première vérification permet de montrer. Le trombone n’est pas là où on l’attend. Mais l’acte d’imagination, la figuration ne se soucie pas que les perceptions sur lesquelles elles se déploient ne soient pas fondées.
L’exemple nous permet de comprendre, par l’absurde, que le fait de lecture, comme la chute d’un objet, ne doit pas seulement être construit, mais qu’il doit encore être attesté pour ne pas être un simple fait de l’imagination, la chute d’un trombone imaginaire.
Manipuler une forme
Figurer, c’est percevoir et imaginer, mais c’est aussi manipuler une forme, jouer avec des significations et les développer, au sens d’un déploiement symbolique, bien entendu, mais aussi, au sens du processus photographique, qui transforme l’absence en présence et le présent en son contraire.
Dans «Images de mon père en pleurs», une nouvelle de l’écrivain américain Donald Barthelme, le texte nous invite à jouer avec une figure sans cesse réitérée, jusqu’à ce que nous comprenions, lors d’une épiphanie qui a tout de l’événement de lecture, qu’il y avait là d’abord et avant tout une figure écran. La figure, il faut le dire, est souvent une énigme. Elle en cache autant qu’elle en montre et son sens véritable, même si elle apparaît d’emblée pour le sujet comme une vérité, comme sa vérité, ne surgit qu’après une longue fréquentation et un acte d’interprétation.
La nouvelle se donne comme un ensemble de trente-six fragments, certains composés d’une seule phrase, voire d’un seul mot. Ces fragments constituent un espace qui est celui du deuil et du ressassement. Un fils y apprend, dès l’incipit, la mort de son père, renversé par un carrosse, et il cherchera, tout au long du texte, à s’imprégner de la vérité de cet événement. La nouvelle n’est pas linéaire, elle trace des cercles où sont répétées les images du père renversé, auxquelles répondent celles sous-jacentes du fils contemplant le mystère de cette mort, incapable d’en comprendre la vérité et inapte à exprimer ses émotions.
Un aristocrate dévalait la rue dans son carrosse. Il écrasa mon père.
*
Après la cérémonie, je rentrai en ville à pieds. J’essayai de penser à la raison pour laquelle mon père était mort. Puis je me souvins: il avait été écrasé par un carrosse. (Barthelme, 1978: 7)
Le deuil du fils passe par la dénégation, par le refus de la peine qu’un tel événement occasionne. Cette réalité, il ne parvient pas à l’accepter; son faux détachement le montre par l’absurde. Il y a là un réel qui ne peut être admis, auquel le narrateur résiste, en se cachant derrière un écran neutre, une émotion ramenée à son degré zéro. Et ce tiraillement du fils est marqué par une figure qui réapparaît à sept reprises dans le texte. C’est la figure du père en pleurs.
Cette figure est ambiguë. Dès sa première apparition, elle se révèle avec un arrière-plan qui en perturbe les traits. C’est que la figure du pleureur est l’objet d’une identification incertaine:
Oui il est possible que ce ne soit pas mon père qui soit assis là, au milieu du lit, en train de pleurer. Ce peut être quelqu’un d’autre, le facteur, le livreur de l’épicerie, un courtier en assurances ou un percepteur, qui sait. Cependant, je dois dire, cela ressemble à mon père. La ressemblance est très forte. (Barthelme, 1978: 7-8).
La figure est à la fois affirmée et contestée. C’est et ce n’est pas le père du narrateur. La ressemblance est frappante, mais l’identité est incertaine. Clairement, ce refus de reconnaître son père dans cette figure en pleurs apparaît comme un symptôme du déni du fils. C’est le refus initial du deuil.
La même scène revient sans cesse, dans des états de diffraction divers:
L’homme assis au milieu du lit ressemble beaucoup à mon père. Il pleure, le larmes coulent le long de ses joues. On peut voir qu’il est bouleversé par quelque chose. (Barthelme, 1978: 9)
C’est le père de quelqu’un. Cela au moins est clair. Il est paternel. Le gris des cheveux. La bouffissure du visage. La voussure du dos. La brioche du ventre. Des larmes qui coulent. Des larmes qui coulent. Des larmes qui coulent. Des larmes, encore. Il semble avoir l’intention de vouloir aller plus loin sur ce sentier de sel. Les faits suggèrent que son programme consiste à pleurer. Il a quelque chose en tête, des pleurs encore. Ô Seigneur, Seigneur! (Barthelme, 1978: 12)
Tiens!… Voilà mon père!… assis sur le lit là-bas!… et il pleure!… comme s’il avait le cœur trop gros!… Père!… comment se fait-il?… qui vous a blessé!… Nommez l’homme!… Tiens, je… je… ici, Père, prenez ce mouchoir!… (Barthelme, 1978: 17)
Voilà le lit de mon père. Dedans, mon père. Attitude de découragement. Gracieux comme un daim, les même grandes oreilles. Un rien de sourire durant un rien de temps. Est-il en train de me faire marcher? (Barthelme, 1978: 20)

Fig. 3: Pleurs à la Pollock
Le mouvement, on le comprend sans peine, se veut insistant. La figure a un noyau, une image souche réitérée avec insistance: celle d’un père qui pleure seul sur un lit, aperçu par son fils. Ces cinq traits sont réaffirmés, fragment après fragment, et ils servent de base à des mises en récit multiples, où le fils se remémore des scènes de famille. Ainsi, quand le père n’est pas sur son lit en train de pleurer, il est en train de jouer. Il écrit sur un mur avec ses crayons pastel (1978: 14); il s’amuse avec la salière, la poivrière et le sucrier, mélangeant leurs contenus (1978: 17); il saute sur le dos d’un gros chien, à califourchon, en criant «hue dia!» (1978: 14); il joue avec une maison de poupée (1978: 17), il écrase son pouce dans les petits fours (1978: 10) ou il joue aux Cowboys et aux indiens (1978: 13).
Le fils partage son temps entre son enquête sur les circonstances de la mort de son père et ces souvenirs d’un père tantôt pleurant sans discontinuer, tantôt agissant comme un enfant. Ces fragments d’un père enfant présentent en fait une image dissonante, amusante par moments, mais inquiétante. Quel est ce père qui est tout sauf un père? À quoi renvoie ce père mort? Sa figure, on le conçoit, entraîne projections et mises en récit. Elle se déploie sur une absence, mais elle s’en sert comme d’un mur contre lequel elle vient buter. «L’absence est fondatrice du temps de la narration», dit Pierre Fédida (1978:72). Et le psychanalyste distingue clairement l’absence du vide, qui est «l’incapacité de constituer l’espace en un temps de l’absence.» (Fédida, 1978: 72) La figure, celle immédiate du mort, vient remplir ce vide, elle le transforme en signe, c’est-à-dire ce qui peut être manipulé, compris et interprété.
Ce signe apparaît bien souvent comme une énigme. Que dit-il de l’absent? Par quelle opération le vide laissé par sa disparition s’est-il transfiguré en une forme? La figure est, en ce sens, un mystère. Si elle s’impose spontanément comme une vérité pour le fils, elle se révèle essentiellement opaque. Elle doit encore être interprétée. Elle attire et, en même temps, résiste à celui qui se l’approprie. Elle dit quelque chose qui ne peut être entendu, du moins initialement. Mais elle permet qu’il y ait du sens.
Ainsi l’accumulation des images de la nouvelle ne devient cohérente qu’en regard d’une image en creux, d’une image absente, qui ne cesse d’être reconduite. Si, comme se demande le fils, «ce n’est pas [son] père qui est assis là sur le lit en pleurs »(Barthelme, 1978: 16), qui s’y trouve alors? Qui? Sinon justement le fils lui-même. C’est le fils qui est sur ce lit, à accumuler les larmes. C’est lui qui pleure. Le père a pris sur lui la peine du fils, il en est devenu le signe, le seul signe possible. Motivé, nécessaire. Cela explique pourquoi l’image de ce père est insupportable. «Mais pourquoi rester?», se demande justement le fils, «Pourquoi regarder? Pourquoi s’attarder? Pourquoi ne pas s’enfuir? Pourquoi s’exposer? Je pourrais être quelque part ailleurs, en train de lire un livre, de regarder la télé, d’introduire un grand bateau dans une petite bouteille, de danser le Pig» (Barthelme, 1978: 12). Pourquoi? Bien simplement parce qu’on ne peut quitter une scène dont on est le seul acteur. Le masque est devenu transparent, malgré les efforts démesurés du fils pour n’en rien laisser paraître. «Images de mon père en pleurs », le titre de la nouvelle, doit se lire en fait «Images d’un fils pleurant son père»… Images insupportables, inacceptables et par conséquent refusées, niées, projetées en négatif sur la surface du texte. Et c’est au lecteur de les développer et de remettre leurs couleurs dans le bon ordre. Il y a un enfant qui pleure et il se cache dans ce père en larmes.
Mais l’image rectifiée n’est nulle part exhibée dans le texte, seule la figure qui lui sert d’écran est proposée. Le lecteur doit la récupérer et en inférer sa présence depuis les indices éparpillés tout au long du récit. L’événement en lecture, il est là, dans cette compréhension soudaine que le père n’est qu’une image inversée du fils. Rien ne peut prouver, texte à l’appui, que l’image est un masque. Mais, dès l’instant où l’hypothèse surgit, notre esprit critique d’emblée s’active et nous complétons le portrait. Il ne peut en être autrement, comme un trombone dont on sait bien qu’il est tombé, même si rien ne nous en confirme définitivement le fait.
*
L’événement en lecture survient quand une figure s’impose, malgré tout, et entraîne la représentation dans son sillage. Elle surgit, et c’est l’ordre de ce texte qui est mis sens dessus dessous. «Figurer quelque chose perceptuellement, dit Kearney, […] c’est le figurer comme un tout absent à partir d’un aperçu présent.» (Kearney, 1984: 60) Et c’est le manipuler, jusqu’à ce que sa forme se révèle, et son sens par la même occasion.
Un tel événement advient en contexte. Si le texte apparaît comme un dispositif au cœur duquel peut se lover une énigme, c’est au lecteur, par ses filtres et son écoute, à en trouver la clé. La figure, comme toute signification complexe, n’apparaît qu’à la suite d’un travail d’appropriation du texte et d’interprétation. Comme le dit Christian Vandendorpe, «[un] élément saisi par nos sens et offert à la compréhension ne peut être compris que dans la mesure où il est pris en charge et interprété». (Vandendorpe, 1999: 73) Ce travail se déploie sur la base de nos expériences et de nos savoirs. S’il est initié par une perception quelconque, de quelque nature que ce soit, il implique avant tout un acte d’imagination qui parvient à identifier une forme, à l’isoler et à l’appréhender afin, ultimement, de la manipuler et de la rendre signifiante. La lecture est ouverture sur le monde, elle est un processus dynamique et implique un travail qui, une fois entamé, ne cesse de se développer et de se complexifier. Car il ne faut pas en rester, comme le montrent les trois exemples abordés ici, à la seule identification d’un fait; il faut se servir de cette perception initiale comme point de départ d’une exploration des formes que peuvent prendre l’imaginaire et ses figures.
Bibliographie
Barthelme, Donald. 1978. La Ville est triste. Paris: Gallimard.
Barthelme, Donald. 1980. Le Père Mort. Paris: Seuil.
Charles, Michel. 1995. Introduction à l’étude des textes. Paris: Seuil, «Poétique», 388 p.
DeLillo, Don. 2001. Body art. Arles: Actes sud, 128 p.
Didi-Huberman, Georges. 1998. Phasmes. Essais sur l’apparition. Paris: Minuit.
Fédida, Pierre. 1978. L’absence. Paris: Gallimard.
Gervais, Bertrand. 2007. Figures, lectures. Logiques de l’imaginaire, tome I. Montréal: Le Quartanier.
Kearney, Richard. 1984. Poétique du possible. Phénoménologie de la figuration. Paris: Beauschesne.
Vanderdorpe, Christian. 1999. Du papyrus à l’Hypertexte. Montréal: Boréal, 271 p.
* * *
Cet article a d’abord été publié dans Lecture, rêve, hypertexte. Liber amirocum Christian Vandendorpe aux Éditions David en 2009.
