Hors collection, 01/01/2009
Être auprès des choses. L’écrivain flâneur tel qu’engagé dans la quotidienneté
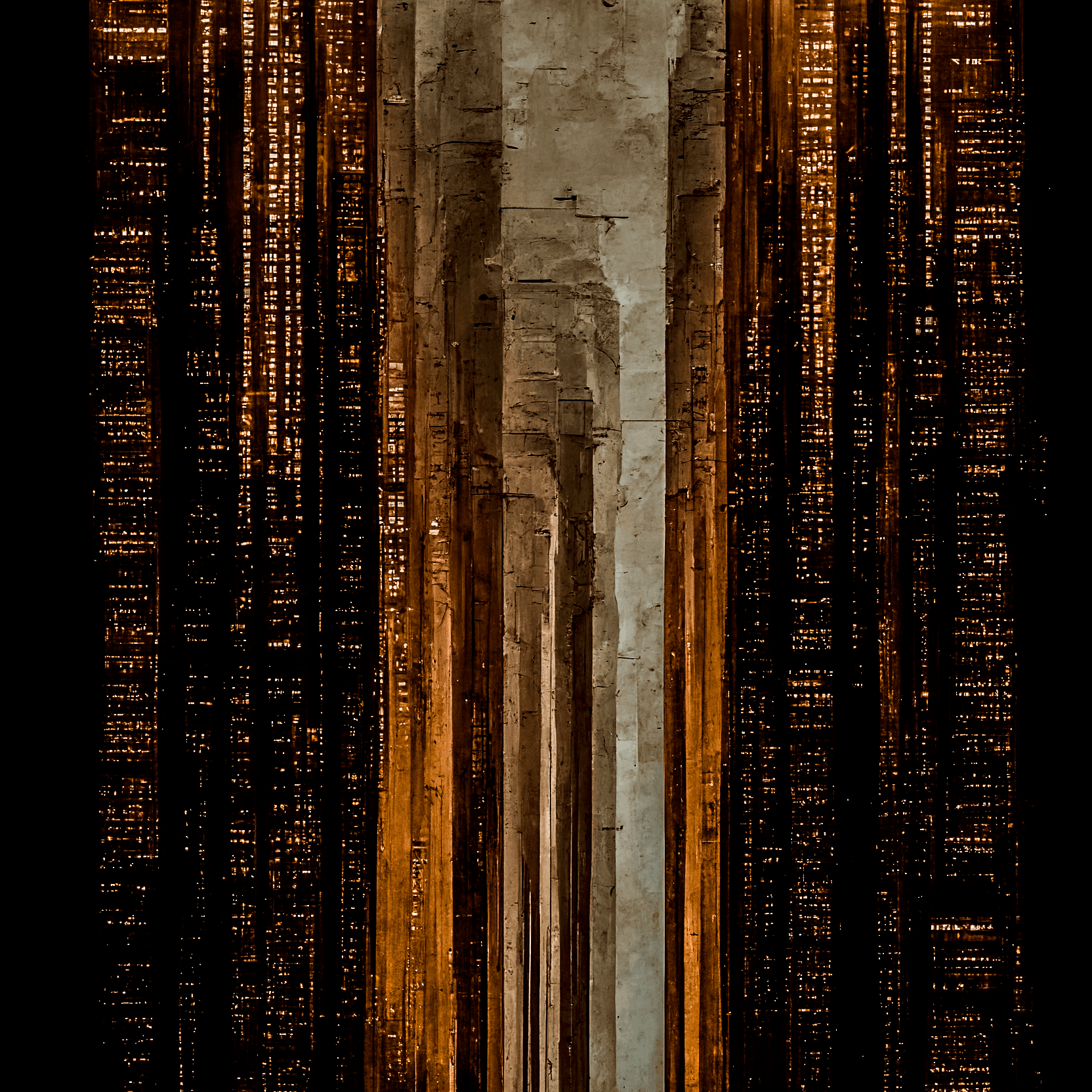
Être au monde, c’est être auprès des choses dans l’habitude et la familiarité […].
Christian Dubois (2000, p. 61)
J’ai rassemblé ici, sur le double mode du témoignage et de l’essai, quelques fragments réflexifs offrant des liens d’insistance autour de la double question du flâneur et de la quotidienneté[1]. Je pars du principe, hérité des sciences, que quiconque entreprend d’expliquer, voire seulement de décrire un phénomène doit d’abord dévoiler son mode de spéculation. En littérature, on appelle cela une posture d’écrivain –et dans certains cas, un manifeste.
L’idée de quotidienneté –ou ses différentes déclinaisons, l’ordinaire quotidien, la banalité, etc.–, renvoie à deux sens distincts; l’un, assez neutre, référant à ce qui constitue la réalité sociale et personnelle dans sa dimension courante, «ce que nous sommes en premier lieu et le plus souvent», dit Blanchot (1969, p. 355), «l’air le mieux connu de mon existence», dit Bruce Bégout (2005, p. 18); et l’autre, le péjoratif du premier, qui se rapporte au lieu commun et à la routine fastidieuse qui avilissent les individus dans la répétition, dans la monotonie, dans l’inertie, et qui les assignent à la similitude et à la substituabilité. Or, sans prétendre que la seconde acception soit sans intérêt pour la littérature, j’ai choisi d’explorer la première, qui renvoie à un mode d’appropriation de l’existence sans la charge dépréciative contenue dans la seconde, qui semble abréger l’individu à une vie sans qualités. Et cela dans la perspective de la relation du flâneur à cette quotidienneté.
On retiendra donc qu’au long de ces quelques fragments, le terme quotidienneté n’est pas utilisé dans le sens dépréciatif que lui accorde Henri Lefebvre (1968) pour condenser les divers procès d’aliénation à l’œuvre dans le quotidien. Lui est plutôt attribué, dans un premier temps, le sens usuel de ce qui appartient tout simplement à la vie de tous les jours. Ce dont on a l’expérience habituelle, ce qui est rendu familier à force de présence suivie. Le coutumier, qui se produit sans cesse de nouveau. La toile de fond de la vie de tous les jours. Ces choses familières plus prévues que vraiment perçues ou consignées, qui font partie des événements personnels ou mondains routiniers. Ce qui se fait presque sans nous —l’idée de vie quotidienne renvoyant à la surprésence de faits et de choses toujours déjà là, qui à première vue ne semblent pas mériter qu’on s’y attarde.
La quotidienneté
Commençons par commenter la quotidienneté dans son aspect de processus, c’est-à-dire comme une succession d’opérations allant vers un résultat, qui entraîne la quotidianisation de choses, de lieux, de personnes, de scènes, d’actions, de comportements… Nous pouvons imaginer que ce processus, outre qu’il suscite une adhésion au monde, dissimule, voire réprime en partie ou temporairement l’inquiétude inspirée par le horsquotidien et en tempère l’effet d’inquiétante étrangeté. La répétition semble avoir ce pouvoir de nivellement.
Nous ressentons que la quotidienneté, sous divers aspects récurrents qui en marquent l’insistance dans nos vies, dissimule sa capacité à nous asservir à l’autorité de son principe agissant. Pour le formuler autrement, disons que nous nous trouvons, jour après jour et parmi tant d’autres, aux prises avec la tyrannie discrète de la vie ordinaire, apanage du quotidien dans sa dimension répétitive. Ce n’est cependant pas là la seule dimension du quotidien. En effet, tout n’est pas banal dans la vie quotidienne, tout n’y est pas confiné à des stéréotypes répétitifs, tout ne s’y appauvrit pas en routine. La banalité n’est qu’un cas du quotidien; elle surgit lorsque le banal est surprésent, au point de voiler les autres aspects du quotidien. Car la quotidienneté donne aussi lieu à des actions réjouissantes, motivantes, gratifiantes; elle ouvre même, à l’occasion, à de l’infamilier, à de l’inconnu, à de l’étonnant.
On ne niera pas, cependant, que le quotidien se compose en grande partie de ce qui arrive tous les jours, comme le suggère l’étymologie (quotidianus: de tous les jours; de quotidie: chaque jour). Bruce Bégout définit le quotidien comme «tout ce qui, dans notre entourage, nous est immédiatement accessible, compréhensible et familier en vertu de sa présence régulière» (2005, p. 37-38). Dans cette perspective, la quotidienneté constitue la toile de fond de notre existence. Elle assure le cours régulier des choses, à la fois toujours plutôt prédictible et porteur de son potentiel de nouveauté. Car la quotidienneté maintient son équilibre sur le fil qui relie l’habituel et l’inédit. C’est dire que différence et répétition constituent des éléments fondamentaux de sa définition. Différence et répétition qui sont des énoncés de la durée.
Précisons que différence et répétition assument, dans la vie quotidienne, des rôles aussi contradictoires que complémentaires, au même titre que l’exceptionnel et le trivial. Sans doute même faudrait-il parler d’une confrontation permanente entre la régularité de l’ordinaire et la variabilité induite par le fortuit, l’inopiné. La trame du quotidien est porteuse de cette tension, que Claude Javeau résume par cette formule: «le quotidien est le lieu du changement sur fond de continuité et en même temps le lieu de la continuité sur fond de changemen» (2003, p. 42).
On gardera donc à l’esprit que le menu quotidien des jours, qui semble répéter l’ordinaire des choses familières, est continûment tenu en tension, dans le champ événementiel, par l’éventualité de l’inattendu. Et cela, chez certains, jusqu’à flétrir la paix intérieure. Par ailleurs, la routine répétitive peut elle-même compromettre la quiétude. Car la quotidienneté étouffe autant qu’elle protège, ou sans doute devrais-je dire qu’elle asphyxie les uns et protège les autres, ou mieux : qu’elle nous étouffe et protège tous, mais dans des proportions qui varient. C’est son paradoxe. D’ailleurs, n’est-ce pas dans le monde quotidien que l’incertitude face à la vie surgit au grand jour?
Au doute, à la peur, à la méfiance universelle à l’égard des maux du vaste monde, les individus répondent isolément et collectivement par des petites certitudes terre-à-terre. Comme si la quotidienneté pouvait compenser la déroute de l’Histoire! Mais la quotidienneté ne calme que partiellement l’inquiétude. Et même, elle peut constituer une construction répressive de la réalité. À moins qu’elle instaure une conciliation entre soi et le reste du monde, et sa menace potentielle.
Par ailleurs, la vie quotidienne accueille positivement certaines sollicitations potentiellement libératrices. Michel de Certeau a bien mis en relief l’irréductible créativité sociale du quotidien, son inventivité souvent émancipatrice (1980). Michel Maffesoli, pour sa part, a largement commenté la réceptivité du quotidien: «La vie quotidienne dans toute sa grisaille et dans son aspect le plus banal est (toujours) riche d’imprévu et ouverte à de multiples potentialités» (1979, p. 31). La quotidienneté est bien avenante pour certains faits inespérés ou inattendus. Elle recèle même des germes de résistance au pouvoir[2]. C’est que la quotidienneté engage à un élan vers l’appropriation de l’existence sur le double mode de la résistance et de l’adaptation. Cette aspiration à l’adaptation insinue une ambition d’harmonie relative entre l’individu et la société qui le norme, une harmonie qui se déploie à coups de conventions, d’accommodements, de rapports de force, chacun y allant de son ingéniosité et de ses ruses pour survivre sans trop de peine.
Le flâneur, qui fréquente la quotidienneté en fureteur, postule que la perceptibilité apparemment sans entrave de l’ordinaire quotidien, son omniprésence, disons la surprésence de ses signes usuels et répétitifs, crée l’impression mensongère que toute sa signification se dévoile; qu’au contraire, cette surprésence rend relativement imperceptible l’ordinaire quotidien, qu’elle l’occulte en partie, le soustraie à l’interprétation; on dirait qu’une clarté de surface en assigne l’essentiel à l’ombre. Contre toute apparence, la quotidienneté ne se laisse pas fouiller facilement. Je voudrais donc suggérer, afin de peaufiner ce concept de quotidienneté, de lui attribuer le sens du néologisme endotique. Le préfixe endo, du latin endon, signifie: «en dedans»; le suffixe ique (le icus latin, le ikos grec): «qui se rapporte à». Le sens du mot endotique est donc: qui est relatif à ce qui est en dedans, qui se rapporte à ce qui est familier. Or, Victor Segalen définit l’exotique, son contraire, comme «[t]out ce qui est “en dehors” de l’ensemble de nos faits de conscience actuels, quotidiens, tout ce qui n’est pas notre “Tonalité mentale” coutumière» (1978, p. 38). Le terme endotique, dans une première estimation, référera donc à tout ce qui participe de nos faits actuels, quotidiens, tout ce qui relève de notre tonalité mentale coutumière. J’ajouterai cependant: des faits actuels auxquels nous n’avons qu’un accès limité à force de ne les percevoir qu’au ras de leur surface. Voilà comment j’entends ici la quotidienneté —terme auquel je pourrais substituer le néologisme endotique: une matière familière dérobée, à capter et à interpréter.
Il y a cette idée que ce qui se présente au plus proche et sur le mode le plus familier, à force de répétition et de surprésence, devient le plus lointain, le plus étrange. C’est son évidence récurrente, sa survisibilité, qui rend presque invisible le monde du quotidien, qui rend sa présence fuyante et en fait une énigme. Cette énigme s’obscurcit par le fait même que le monde quotidien ne paraît pas énigmatique: apparemment, il s’exhibe sans cesse et sans retenue dans une sorte d’assiduité aussi anonyme que commune. Je vais cependant dans le sens de ceux qui, tel Merleau-Ponty, postulent que, dès que nous interrogeons le visible, celui-ci nous interroge à son tour, car nous en sommes, de ce visible[3]. Dès que je vois, que je vois vraiment, il se produit que je suis regardé. Regardé par ce qui, dans le vu, me regarde. C’est par ces mots que Georges Didi-Huberman ouvre un de ses essais : « Ce que nous voyons ne vaut – ne vit – à nos yeux que par ce qui nous regarde » (1992, p. 9). Il faut avoir cette double dimension à l’esprit pour comprendre le flâneur dans son rapport à la quotidienneté. Le flâneur qui se demande : qu’est-ce qui se passe, dans l’ordinaire quotidien, alors qu’il semble ne rien se passer? Qui constate que le propre de la quotidienneté, c’est de s’anticiper sans cesse elle-même et de refouler une large part de son contenu vers son angle mort. Qui présume que la répétition quotidienne, sa monotonie, ses compromis, sont autant d’occasions de frôler l’énigme de la condition humaine.
Le flâneur et la quotidienneté
Au vu de l’histoire, littérature et quotidienneté ou banalité s’opposent par le fait que la littérature vise justement le dépassement de la condition banale. Et pourtant, certains écrivains, surtout du XXe siècle, en s’affrontant à l’ici-maintenant de l’espace quotidien, ont justement tenté de réconcilier la littérature et la banalité quotidienne. Ces auteurs se sont immiscés dans les quartiers populaires, dans les rues et lieux ordinaires des villes et, par leur regard insistant et par leur manière singulière, disons par leur manière artiste, ont tenté de dire ces lieux communs, leurs personnages, leurs objets, leurs scènes. Tout, dans leurs écrits, tient à la manière de l’écrivain. À son regard et à sa vision du monde. Il y a là ce que, pour le domaine de l’art, Arthur Danto a appelé une transfiguration du banal (1989). En d’autres termes, par l’approche langagière, la scène banale, surprise par le flâneur, change de statut. Je voudrais cependant éviter de voir, dans cette saisie, une forme d’élévation de l’objet banal. À mon entendement, c’est surtout l’écrivain qui change, peut-être de statut, mais surtout de vision, c’est-à-dire qu’il s’impose un nouveau mode d’appropriation de la réalité dont la banalité triviale du quotidien devient la pierre angulaire.
Certains écrivains, on pense à Léon-Paul Fargue, ont nourri leurs observations d’une forme de lyrisme transformateur; d’autres, comme Georges Perec, ont exploré, par une consignation confinant à l’inventaire, une forme proche de la neutralité. Or, les deux approches semblent relever du même constat d’inaptitude à décrire pleinement le monde; elles constituent des manières opposées mais complémentaires d’affronter le même problème: comment construire sa présence langagière à la banalité quotidienne? Comment soumettre la quotidienneté à sa perception?
Ces flâneurs auxquels je fais référence ont en commun de ne pas concevoir la quotidienneté comme médiocrité, comme insignifiance subie, comme signification saturée par la répétition oppressante. Ils recherchent plutôt de la signification dans les choses communes, au double sens de ce qui est de peu d’intérêt et de ce que nous avons en commun.
Il est des lieux publics, des lieux communs, où la vie quotidienne s’expose, au moins partiellement, des rues, des ruelles, des cafés, des gares, des parcs, tous lieux qui intéressent le flâneur, car s’y multiplient les exemples les plus variés d’une recherche d’harmonie relative, avec les résistances, les renoncements, les engagements que cela suggère, les tiraillements, les distractions… Car chacun déploie son propre mode d’adaptation, et les critères qui déterminent ce mode sont sans cesse à renégocier, à réaffirmer dans le quotidien. Et chacun agit dans sa propre et relative clandestinité. Or, le flâneur, tel que je le comprends, ou devrais-je dire tel que je suis engagé à l’être, postule qu’une rumeur témoigne de cette clandestinité individuelle. Il en recherche l’écho et l’aspect tragique – postmodernité oblige. Ses glanures prennent la forme d’un bricolage d’impressions, de descriptions, de micro-récits. La configuration fragmentaire typique des notes de terrain est sa façon initiale de composer avec la multiplicité et avec la disparité. Le flâneur écrit en évocation plus ou moins directe ou différée, en une forme de récit plus ou moins immédiate ou rétrospective, tiraillé entre l’événement vécu et l’événement de l’écriture. La vision fracassée qui en résulte inscrit de la rupture dans la continuité perceptive et crée de la pensée interrompue. Cette forme tout à la fois rend compte de la diversité et témoigne de l’impuissance du flâneur à tout saisir d’un bloc, et même de son refus de synthèse et d’illusion de complétude.
Le flâneur témoigne d’un imaginaire propre, entendu comme modalité d’après laquelle se fonde le rapport au monde, et comme conscience imaginante et imageante. Un imaginaire comme expression de résistance individuelle et sociale face au pouvoir, qui permet une esthétisation de la vie sociale. Un imaginaire qui se donne entre autres pour fonction de maintenir vivants les faits et gestes d’individus croisés lors de flâneries. Un imaginaire qui s’occupe à décrire, tels qu’ils sont perçus et interprétés, des êtres épars chez lesquels il devine des signes d’une ressemblance. Un imaginaire qui joue son rôle de lieu d’accueil d’une multiplicité d’identités. Un imaginaire guidé par une forme de sympathie et de souci de maintien du lien social. Je mentionne cela pour contrebalancer l’image du flâneur asocial, insensible et narcissique.
À partir de scènes plus ou moins fortuites, captées dans des réseaux spatiaux aussi communs que chargés de signes, le flâneur œuvre à consigner des fractions et des miettes de la vie courante. Les lieux publics sont le théâtre de signes extérieurs de la vie quotidienne, souvent des signes discrets, mais des signes quand même, dotés de leur potentiel de signification. Pour y accéder ne serait-ce que partiellement, le flâneur abandonne ses visées et ses mobiles et choisit de se laisser surprendre par l’ordinaire des jours. À la source de la démarche du flâneur, et qui peut-être en allume la première étincelle, se trouve l’aptitude à déceler la différence dans la répétition. Or, cela peut être compris de deux manières. Comme la capacité à reconnaître le rapport d’altérité entre les choses, mais aussi à reconnaître, et même à vivre, le rapport d’altérité entre les choses et soi.
La différence renvoie à ce qui ne se laisse réduire ni à l’identique ni à l’unique. En ce sens, pour le flâneur, un bol sur une table de café n’est ni enfoui dans sa similitude avec tous les bols ni détaché de son contexte. Tout être, toute chose perçue, même minimaliste, surtout minimaliste, s’augmente de ce qui l’environne; cet espace circonvoisin, en même temps qu’il rétrécit la chose, la dilate. C’est dire que la quotidienneté n’est pas déchargée des tensions entre la répétition et la différence. Par ailleurs, la différence renvoie aussi à ce qui ne se laisse pas réduire à sa fonction usuelle et inquestionnable dans une structure d’ensemble. Cela permet de saisir à titre de bol le bol sur une table dans un café, avec les connotations singulières que l’observation et l’imaginaire du flâneur sont appelées à y investir.
Le flâneur, qui affirme la différence et la répétition, perçoit l’ordre accoutumé des choses dans son aspect d’espace exploratoire. Là est ce qui le lie au monde. Là est sa joie, car il bénéficie et même il jouit de cette distance liante. Il trouve là un peu de ce qui n’a pas accédé à sa parole et qui est pour lui du sens à l’état naissant. Là est son mode de résistance à ce qui cherche à le cadrer, à l’aliéner. Mais la chose n’est pas simple, car le monde sédimenté dans lequel il vit porte constamment vers lui ses perceptions et son langage, par lesquels il est plus ou moins tenu en otage. Comment s’en libérer sans cesser d’être solidaire? Voilà sa question.
Imaginons le flâneur traversant à pas lents un espace humain plein de signification, disons une gare ferroviaire, spécimen du réseau mondial des gares, dont il ne capte, diagonalement, que certains signes. Ainsi se construit son accommodation à l’espace commun. Jusqu’à ce que, soudainement, une scène, un individu, un détail de cette gare, pour lui subitement chargé d’une signification particulière et prenante, surgisse du magma indifférencié sous forme d’énigme et que s’ébranle l’événement d’une coprésence: le flâneur occupant la gare, et la gare, le flâneur. En fait, c’est rapidement l’idée de gare, plus que la gare elle-même, qui commence de le fasciner. Ce qui s’ensuit, dans l’esprit et peut-être dans le carnet du flâneur, répond à la fois à une forme de contemplation, d’interprétation et d’appropriation – le mot appropriation renvoyant au caractère pour soi et à soi d’une réalité. À partir souvent de presque rien, généralement un détail, le flâneur déploie une construction imaginaire sous forme de descriptions, de récits, de réflexions, qu’il met au service du même enjeu: avoir prise sur sa propre réception du réel immédiat. Il y a en effet, chez l’écrivain flâneur, une véritable névrose du détail. Des fragments de perception, au milieu de la prolifération, lui imposent à l’occasion des moments de suspension d’agir dans le continuum des choses du monde. Des fractions d’anodin foisonnent soudain de signification. Quelque chose lui parle à lui seul, je devrais plutôt dire qu’il fait parler des détails, il les anime au sein de sa langue étrangère. Mais le flâneur n’est pas dupe: il sait qu’il lui sera à jamais impossible de fixer définitivement le sens des choses, qui sans cesse se dérobe. Ce qu’il ressent, cependant, c’est que chez lui, le peu signifiant est indissociable d’un rapport fondamental au monde.
On aperçoit ici le flâneur par son côté obsessif, qui, fasciné, retourne sans cesse sur les lieux de sa manie pour y vivre du déjà vécu, bien que chaque fois inédit, y voir du déjà vu, y consigner des notes déjà prises. C’est que la relation de pensée au réseau spatial qui envoûte le flâneur est entretenue par une double disposition, d’une part à la reprise maniaque de leur fréquentation, d’autre part à une forme de musardise. J’aime ce mot, que j’ai inscrit au sous-titre d’un livre à paraître (titre de travail: «D’un café l’autre»; sous-titre: «Musardises en cafés montréalais») et le verbe qui lui correspond, musarder: en quelque sorte, aller le museau en l’air. Musardise et musarder me semblent connoter fortement l’idée de double flânerie, à la fois dans l’espace et dans l’esprit. Je souhaite donc conserver musardise et musarder, qui me sont devenus familiers, mais en leur ajoutant une certaine part du concept actuel de musement. Je m’appuierai sur les travaux de Bertrand Gervais, qui définit le musement, dans le sillon de C.S. Peirce (1990) et de Michel Balat (2001), comme «une errance de la pensée, une forme de flânerie de l’esprit, le jeu pur des associations qui s’engage quand un sujet se laisse aller au mouvement continu de sa pensée. C’est un flot qui nous traverse jusqu’à ce que nous nous déprenions de lui» (2007, p. 18). Je dirais jusqu’à ce que ce jeu de mobilité, d’observation quasi distraite et de pensée, ces allers et retours ludiques de soi à soi fassent place à la forme usuelle d’attention utilitaire de tous les jours, généralement inconsciente et rassurante.
Ainsi, je dirai que, dans sa relation au monde des gares –toujours à titre d’exemple–, le flâneur compte à lui seul pour la moitié. Il est cependant, dans ce tête-à-tête, hypnotisé par sa propre fascination et s’abandonne au jeu d’un double musement dans l’espace et dans la pensée. Un musement qui fusionne l’espace et la pensée. Ce que j’appelle une musardise.
Restons près des travaux de Bertrand Gervais et ajoutons que le museur se perd dans la contemplation de figures, ici la figure de la gare. «La figure, écrit Gervais, n’est jamais autre chose que cette construction imaginaire, plus ou moins motivée, qui surgit au contact des choses et des signes, et qui permet la coalescence de pensées par ailleurs divergentes» (2007, p. 18). La figure de la gare serait donc une pensée se déployant à partir d’une signification énigmatique que le flâneur éprouve avant tout par l’exigence de fréquentation et d’interprétation qu’elle lui impose. Je dirais même par l’appropriation qu’elle exige de sa part. La figure de la gare, une fois ancrée dans l’esprit du flâneur, commande un sens à construire par lui et pour lui. Gervais dit même que pour se déployer, la figure requiert d’être manipulée[4]. Or, cette figure, à force de résonance avec la pensée du flâneur, en vient à se substituer à la gare saisie en perception externe, à se superposer même à son évanescence.
Il apparaît que les signes de la vie quotidienne, qui composent le matériau brut du flâneur, renvoient à beaucoup plus qu’à leurs composantes de surface, dites réalistes. Le travail d’appropriation du flâneur se fait par intégration à un imaginaire. La Venise de Tiziano Scarpa, les banlieues parisiennes de Jacques Réda, la Lisbonne de José Cardoso Pires, mes propres ruelles montréalaises ne peuvent être considérées comme la Venise, les banlieues parisiennes, la Barcelone ou les ruelles montréalaises de tous et de chacun ni condenser en elles la Venise, les banlieues parisiennes, la Barcelone, les ruelles du réel[5]. En ce sens, je suis d’accord avec Dostoïevski qui, commentant L’idiot, écrit: «Les manifestations quotidiennes et la vision banale des choses, à mon avis, ne sont pas le réalisme, c’est même le contraire» (2000, p. 437). C’est que la banalité quotidienne, comme objet littéraire, prend des proportions qui n’ont plus à voir avec le simple, le peu, la signification voisine de zéro. Au contraire.
L’exemple de la nature morte peut nous servir, la nature morte que les Espagnols nomment bodegón, les Néerlandais, still-leven, les Allemands, stilleben, les Anglais still-life, en quelque sorte des vies silencieuses ou des vies immobiles –ce que Diderot appelait des natures inanimées (1955). Ce qui donne sens à la nature morte me semble tenir à la fusion de la représentation et d’allusions spirituelles, esthétiques, affectives, disons l’émotion poétique devant la signification du peu représenté. En quelque sorte, le peu signifie beaucoup, et par-delà la surface réaliste des choses. La nature morte témoigne d’une vision du monde. Ce qui nous intéresse, c’est d’y retrouver la vision et la manière du Caravage, de Chardin, de Cézanne, inscrite dans leur temps et dans leur mode d’appropriation pictural du réel.
Une culture de proximité
La posture de Jean Giono, guère voyageur mais bon promeneur, paraît exemplaire de la conscience du flâneur: «Je me suis efforcé de décrire le monde, non pas comme il est, mais comme il est quand je m’y ajoute, ce qui, évidemment, ne le simplifie pas» (1979, p. 57). La présence du flâneur modifie en effet l’état du lieu, des gens, des choses qu’il aborde. Voilà un autre biais qui permet de parler d’une rencontre entre soi et le monde, la présence aux choses impliquant une dualité. Un biais, aussi, qui confirme que le flâneur crée l’événement de sa coprésence.
Le flâneur doit situer son rapport à l’ordinaire des jours sur le plan du vécu personnel, alors que le monde se présente investi de personnes, d’objets, de scènes s’objectivant, c’est-à-dire se présentant dans le monde réel des choses et des corps. Le flâneur se glisse au sein de la vie quotidienne en acteur autant qu’en observateur, et sans qu’il y paraisse trop, il se laisse aller à être passant des ruelles, personnage des cafés, flâneur des parcs. En même temps qu’il vise un certain détachement et conserve une attention flottante, il se fond au creux de son objet. C’est sa manière de surprendre du sens au cœur du peu signifiant, d’«atteindre l’extraordinaire de l’ordinaire», dit Henri Lefebvre (op. cit., p. 74), de repérer des réseaux de sens sous le trivial[6].
Le flâneur est donc porté par l’idée fondamentale de gîter dans un espace humain public, au lieu de raisonner de loin et de haut. Il s’agit pour lui de se porter de corps auprès des êtres, des choses, des faits quotidiens, ce qui engage à une culture de proximité qui le mène continûment à déconstruire et à reconstruire son rapport de familiarité avec ce qui est à la portée de sa perception. En fait, je devrais parler de moments de proximité, au sens où il s’agit d’accéder à un aspect second de ce voisinage, en vue d’entrer en relation poétique avec la vie quotidienne[7].
Je propose de penser le corps et le langage par leur capacité à produire des alliances fortuites avec l’espace humain. Le flâneur est en effet destiné] à se présenter de corps et de langage dans des réseaux spatiaux, chaque fois comme une nouvelle pièce du vaste puzzle du monde, et chaque fois comme une occasion unique. Le moment y figurant alors, dans son piétinement, comme atome de durée et comme état de conscience. Ces réseaux spatiaux, le flâneur en fait, tout autant qu’un territoire rhizomatique d’observation, la place mouvante d’où prendre discrètement la parole au milieu de la foule agissante. L’approche du flâneur consiste ainsi à se présenter en être parmi les êtres tout en maintenant une vigilance flottante quant aux choses du quotidien. J’entends un genre de vigilance qui suspend la pensée programmée et qui rend le flâneur disponible au monde ambiant, généralement sans les ressources de l’analyse spécialisée, juste en se mettant en présence des choses et en laissant œuvrer la sensation. Cela exige une forme de détachement proche du lâcher prise, doublée d’une mise à nu des sens, ordinairement la vue et l’ouïe en premier. Certes, le flâneur n’est jamais parfaitement détaché de toute visée exploratoire, mais il refuse d’y sacrifier sa liberté de musarder. En fait, le flâneur hésite sans cesse entre serrer au plus près le factuel et pratiquer une forme de détachement critique, qui sont les deux pôles attractifs de sa présence sensible.
Cette présence sensible, il faut la penser dans le double sens de son action. Je la considère du même registre que ce que Merleau-Ponty appelle la chair, non pas le corps objectif ni le corps pensé comme sien, mais ce «qui est sensible au double sens de ce qu’on sent et ce qui sent» (op. cit., p. 307). Cet aspect particulier du corps, je l’appellerai le corps incorporant: le corps qui circule parmi les corps du monde, corps visible et corps agissant, corps intégré au monde des corps. Corps qui perçoit, qui même se perçoit parmi les corps, corps unique qui reçoit le monde. La présence pure qui rive le flâneur à lui-même et au monde, le lieu du sensible, du ressentir. Ce par quoi il ne peut se détacher de l’instant d’existence parmi les réalités du monde.
Or, ce qui est difficile au flâneur, c’est d’établir une nouvelle relation de présence avec ce que la quotidienneté tend à pétrifier dans l’habitude. En certaines occasions, la présence indifférente semble la meilleure voie d’accès à la sensation; d’autres fois, il lui faut planter les crocs dans le sujet, de manière à ce que le peu devienne autre chose, c’est-à-dire justement quelque chose, mais qui reste peu. Un peu qui accueille une présence. Façon de résister à la banalisation du banal.
Pas facile, devant l’apparence de peu et de presque rien des choses journalières, d’éveiller en soi le lieu intime d’où en pressentir l’énigme, sous le double mode d’une stratégies de discernement et d’affects. Car je ne peux passer sous silence la dimension affective liée à cet intérêt pour la quotidienneté, sous forme de ferveur ou d’aversion, de joie ou de tristesse, parfois sous forme d’attraction-répulsion ou de joviale tristesse. Il faut en aimer globalement les acteurs, et ce qu’ils dévoilent en creux de la condition humaine, pour entrer dans le procès descriptif de la quotidienneté. Et cela sans perdre son sens critique.
Il y a donc lieu de considérer cette fouille des arcanes de l’ordinaire quotidien par son aspect de désir d’instituer un nouveau rapport au monde de la quotidienneté; je vois là, cependant, moins une quête de savoir qu’une aspiration à une vraie proximité. Il s’agit en effet moins de comprendre que de se rapprocher et de se tenir auprès des choses dans un rapport de véritable familiarité. C’est ce qu’Emerson métaphorisait sous l’expression «j’embrasse le commun[8]». Peut-être s’agit-il aussi de favoriser une nouvelle relation à sa propre existence parmi les êtres, les choses, les événements du monde. À tout le moins, une façon de reformuler la question de son voisinage avec le monde sous l’angle de la quotidienneté. Il me semble que c’est là, dans cette conscience plus poétique que savante, que se situe l’obligation première, peut-être même la responsabilité à laquelle se soumet le flâneur; prononçons le mot: son engagement. Nous voyons là, en creux, le sens et la valeur qu’il accorde à son rapport d’écrivain au réel ambiant, et la portée de cette quête.
Or, cette quête du flâneur est sévèrement traversée par une combinaison de doute et de désarroi quant à la possibilité de vraiment approcher le monde. On dirait que la volonté de voir et de toucher éloigne l’objet. Ainsi le quotidien, bien que tout proche, et peut-être pour cette raison, apparaît fugitif à celui qui cherche à l’attraper. «Le quotidien est l’inaccessible auquel nous avons toujours eu accès», écrit Blanchot (loc. cit., p. 366). Et c’est sans compter que la proximité des choses implique la menace de leur disparition, ce que la psychanalyse associe à un phénomène d’inquiétante étrangeté. L’inquiétante étrangeté de ce qui est depuis longtemps familier.
Ma conviction, c’est que le flâneur ne peut écrire que sous les conditions de ce doute et de ce désarroi, disons de cette inaptitude consciente. Et je dirai que c’est justement parce que son entreprise est vaine et qu’il la sait dérisoire qu’il peut écrire, bien qu’éprouvant une seconde inaptitude, tout aussi fondamentale : son incapacité à fonder un rapport d’intimité entre son langage et le monde, même le monde tout proche de la quotidienneté familière. « Qu’une réalité se cache derrière les apparences, écrit Cioran, cela est, somme toute, possible; que le langage puisse la rendre, il serait ridicule de l’espérer » (1995, p. 19).
Le flâneur est donc soumis, dans sa relation à la quotidienneté, à une double fatalité et au malaise d’un double échec. Ce qu’il offre, en contrepartie, n’est autre que sa voix, comme aspiration du langage à sa propre réalisation, et que sa manière propre de s’approprier l’espace quotidien fréquenté. Il en ressort une forme de signification qui est le dénouement toujours à dénouer d’un lâcher prise dans l’ici-maintenant du moment quotidien.
L’événement de l’appropriation
Il arrive, dans un lieu aussi banal qu’un café, un terrain vague ou une rue, que, par le fait du hasard, le flâneur soit soudainement saturé d’une émotion étrange, qui fait signe vers une autre présence, bien qu’il s’agisse souvent d’une perception insistante qui semble faire retour. Une scène de jeunes gens qui éclusent des chopes de rousses artisanales sur une terrasse printanière; une ondée anguleuse de lumière matinale dans la solitude géologique d’un terrain vague; la silhouette fléchie d’une ouvrière, à un arrêt d’autobus, qui sort de se doucher dans les sueurs du travail… Le flâneur est alors interpellé par l’événement d’un donné offert à tous en même temps qu’à sa seule sensibilité, un événement sur les traces duquel il se lancera peut-être, si les mots lui viennent, à l’aide de récits, de descriptions, de comptes-rendus de sensations ou de savoirs.
Filons la métaphore et précisons, bien qu’en prenant soin de ne pas mythifier le phénomène, ni surtout l’engagement esthétique qui lui correspond, que dans de tels cas d’émotion, le visible, je devrais dire le survisible, façonné et même surfaçonné par la conformité, par la reprise d’usage, bref par la banalisation des signes, le visible, donc, paradoxalement, rend quasiment imperceptible la chose pourtant aperçue, pratiquement improbable, le passage du signe au sens. Sa proximité aveugle. La valeur objective du sujet apparemment réel engloutit le sens dont la chose se fait signe – le sens qui se perd alors sous l’équivoque de significations plus ou moins reliées entre elles.
Dans une perspective qui reconnaît sa dette envers Merleau-Ponty[9], j’entendrai ici l’imperceptible, certes comme ce qui ne se perçoit pas, mais aussi et surtout, comme la condition même de ce qui se perçoit. Disons comme ce qui rend la perception possible, car cet imperceptible tend la trame du sensible. Cet imperceptible constitue ainsi une ouverture sur la signification; et dans le rapport à la quotidienneté, il ouvre à une profondeur dont la dimension abyssale évoque le sens qui nous déserte. Ce vide est l’assise de l’écrivain flâneur. C’est là, précisément là où il n’y a rien à attendre que lui est offerte la possibilité de transfigurer la banalité quotidienne. C’est bien ce qu’écrit Georges Perec au début d’Espèces d’espaces : « […] au départ, il n’y a pas grand chose : du rien, de l’impalpable, du pratiquement immatériel : de l’étendue, de l’extérieur, ce qui est à l’extérieur de nous, ce au milieu de quoi nous nous déplaçons, le milieu ambiant, l’espace autour » (1974, p. 13). Ce vide, devrais-je ajouter, engage à une représentation pleine. Le flâneur vise à s’approprier pleinement le peu. Et pour cela, il doit sans cesse ruser, prendre ses observations à revers, car l’habitude des choses, des lieux, des événements en dévore l’essence.
À noter que je ne parle pas de vérité des choses, croyant peu à l’accord de la connaissance, surtout objective, avec son objet. Ce à quoi je crois, cependant, c’est à l’événement du sens, à l’événement des choses. Mais qu’est-ce à dire que cet événement des choses?
J’étais il y a peu dans un café, à portée de voix d’une tablée de collégiennes; les potins allaient de bouche à oreille à la vitesse du son. Cette scène banale a pour moi pris forme d’événement – peut-être parce que les mots sont venus avec elle…
Comme je le conçois, dans ce contexte de flânerie au sein de la quotidienneté, l’événement, qui se caractérise par son aspect de transition et de rupture dans le cours des choses, renvoie, par opposition à ce qui a été préparé de toutes pièces et qui est attendu, à ce qui se produit, au sens fort du terme, c’est-à-dire que la scène repérée est conduite à l’existence par une réception et par une interprétation. Par une appropriation. Il arrive alors que ce qui vient paraître aux sens entre en présence avec la sensibilité de l’observateur, et que celui-ci entre lui-même en présence en s’ouvrant à ce qui apparaît. C’est dire que, chaque fois, l’événement met en scène une perception et une coprésence. Et si cette dualité de la perception et de la coprésence nous semble un fait rare, voire exceptionnel, ce n’est que parce que la plupart des événements du quotidien sont discrets – façon de dire que nous considérons la quotidienneté peu propice à la saisie.
Si l’événement se produit, comme on l’a vu, ce n’est qu’à partir d’un point de vue et que sur la base d’une coprésence. Outre qu’il est imprévisible, l’événement apparaît aussi fermé à toute explication simple et cohérente, à la manière d’un phénomène. Le flâneur ne peut que broder autour, en tendant vers deux attitudes contraires : une façon de musement dans le sujet qui pour lui prend forme d’événement, et l’épuisement – illusoire – de ses données.
Le problème, c’est que le flâneur est cerné de perceptible. De quelque côté qu’il se tourne, ses sens sont sollicités par le tout-venant des signes : des images, des sons, des textures, des goûts, des odeurs sans fin. Pour lui, percevoir signifie résister à ce trop-plein de signes. Donc choisir. Et cadrer sa fascination. Sur la base de quel principe? C’est une autre histoire qui ne concerne peut-être que lui. Mais je ne suis pas certain qu’il en soit conscient. Par ailleurs, le flâneur sait d’expérience que rien, jamais, ne peut lui apparaître dans sa plénitude. L’ombre avale toujours une large part des signes. Pour illustrer ce phénomène, les spécialistes donnent l’exemple du cube, qui ne peut être simultanément perçu par toutes ses faces. On ne perçoit jamais une scène dans son entièreté, on doit la constituer tel le cube entier dans son esprit. Cela fait intervenir une mémoire, un savoir, un imaginaire, par lesquels s’approche l’invisible. Toute chose ou scène perçue porte sa zone d’inaperçu et sa part d’indéfinition. Toute description ou récit qu’on en tire implique que du non-présent soit comblé.
La profusion de signes et leur indistinction rendent certes l’événement incertain. D’où il suit que le flâneur ajoute sa propre présence à la présence des choses du quotidien. Car il n’est pas de rapport neutre au monde, rien de ce que décrit, raconte, évoque le flâneur n’est indépendant du sujet qui le façonne ni du langage qui l’énonce. Tout est coextensif à l’être, qui organise son chaos de données sensibles. Même la description proche de l’inventaire, de la liste, du catalogue, que pratique Georges Perec, est le fait de sensations. Cette présence du flâneur, cependant, renvoie moins à son petit fonds de commerce biographique et psychologique qu’à sa capacité d’être présent à la quotidienneté, d’entrer en intimité avec elle. Cette présence appelle le vivant plutôt que le vécu. « Je suis au monde – j’écoute, je regarde; je ne suis pas une identité, je suis un jeu d’énergies, un réseau de facultés » (White, 1994, p. 39), se donne comme consigne le poète Kenneth White, fondateur de la géopoétique. Cette atténuation de la conscience de soi, on la retrouvera, par exemple, chez Annie Dillard, comme Kenneth White peu encline à fréquenter la nature que des réseaux urbains – ce dont témoigne d’ailleurs son registre métaphorique : « La mort du moi dont parlent les grands auteurs, écrit-elle, n’est pas un acte de violence. Ce n’est rien de plus que les retrouvailles avec le grand cœur de roc de la terre qui roule » (1990, p. 375). Or, je crois possible de développer cette double posture au sein de la quotidienneté urbaine : aborder le grand cœur de la quotidienneté en se constituant en un réseau d’énergie et de facultés interprétatives. Je parle, bien sûr, d’une subjectivité qui interroge et qui témoigne, plus qu’elle sait et explique.
Voilà pour moi le pari du flâneur : faire que cette perception-interprétation, qui est son mode d’appropriation des choses du monde, l’engage à tendre vers un certain effacement de soi, bien que sans se dérober à lui-même et à son unité d’être. Sans épanchement et sans inauthenticité. J’insiste sur la locution tendre vers, car l’imaginaire, comme médiation par laquelle se fonde son rapport au monde, soit comme mode sensible de vision intérieure, n’est pas un véhicule que le flâneur peut diriger si facilement selon sa volonté. D’un point de vue éthique, il est appelé à développer une posture de flâneur; pour moi : regarder du côté où il semble y avoir peu à voir, écouter du côté du peu à entendre; ne rien rabattre au rang de la perception objective de surface; accepter l’approximation de ma perception, et justement parce que j’y consens, m’en tenir éloigné, c’est-à-dire chercher à rendre compte le plus précisément possible du perçu, de son surgissement et de la sensation qui lui correspond; ne pas mentir; chercher sa véracité, je parle de la vérité subjective de la personne – seul sens possible, pour moi, du mot vérité.
Le flâneur n’est cependant pas dupe de son aptitude à saisir, dans les scènes publiques du quotidien, ce qu’il est préalablement prompt et adroit à y percevoir. Il ne feint pas, au milieu de ses vacuités absorbantes, de ne pas être fasciné par des images récurrentes qui participent de son unité d’être. Il ne feint pas non plus de ne pas prendre plaisir à juste être là présent aux choses et à lui-même. Car il y a aussi cela, que dit Gombrowicz : « Il n’est rien de plus fantastique que d’être là, dans son moment, concret, tel qu’on est, celui qu’on est et pas un autre… » (1977, p. 154).
On sait aussi que l’événement ne se produit jamais deux fois. En fait, vu qu’il est non rééditable à l’identique, le flâneur doit chaque fois l’aborder à neuf, même s’il croit avoir assisté cent fois à une certaine scène quotidienne, disons celle des collégiennes potinières. Sauf à ne pas les voir vraiment et à tout confondre, il n’est jamais affecté ni ne vit jamais deux fois pareillement la réception d’une scène, d’un lieu, d’un objet. Chaque fois, lui advient un vécu distinct, un moment de la scène, du lieu, de l’objet. Un moment du quotidien.
J’ajoute que l’événement, comme phénomène en tant qu’il s’effectue, qui surgit du quotidien dans sa forme ordinaire et répétitive, procède à partir de cette quotidienneté même en produisant un effet de surprise – qui est un effet de rupture. Par le fait de sa perceptibilité, un détail capte soudain l’attention du flâneur et excite sa sensibilité. Ce détail prend forme d’événement parce qu’un observateur le reçoit tel, c’est-à-dire soit comme excédant l’ordinaire répétitif – un fait étonnant, un personnage singulier –, soit dans sa forme même de banalité quotidienne. Je veux dire par là que la quotidienneté elle-même fait parfois événement, quand elle frappe par sa beauté, par son ingéniosité, par son insolence, par son fonds de mélancolie, par ses multiples manières de répliquer à l’observation et de troubler le flâneur. Cela rappelle ce que l’écrivain paysagiste Gilles Clément appelle « l’art involontaire », qui « flotte à la surface des choses » (1999, p. 121). Clément surprend cet art sans auteur dans « le résultat heureux d’une combinaison imprévue de situations ou d’objets organisés entre eux selon des règles d’harmonie dictées par le hasard » (Ibid). Ce n’est pas ici le lieu de débattre les règles de l’harmonie ou d’argumenter sur ce qui distingue l’art, la nature et le paysage; je retiendrai cependant que, pour Clément, cet art involontaire repose avant tout sur un regard. « Pour qui veut bien regarder, tout fait art » (Ibid). Il s’agit, en réalité, d’un art de l’imperçu venant dans la vision. Si alors « l’œuvre est atteinte par inadvertance dans la seule et imprévisible mise en scène des circonstances de la vie » (1999, p. 122), tel que le suggère Clément, ce n’est que parce que quelqu’un accueille, construit l’événement en s’appropriant un lieu, une scène, un détail et lui accorde une valeur de connaissance sensible et de fait esthétique[10].
Une résistance à l’ordre normé
La quotidienneté se présente comme un espace-temps complexe, à la fois linéaire et cyclique, un espace-temps de contrastes, où s’opposent habitus et invention, individualité et sociabilité, ardeur et désœuvrement, aplomb et fragilité, résignation et résistance, inhibition et exhibition, violence et délicatesse, instant et éternité. En fait, la quotidienneté est porteuse d’une équivocité impossible à résoudre et qui la constitue en objet inépuisable. Nous pourrions ajouter, à cette liste incomplète de contrastes, que la quotidienneté présente à l’individu à la fois à la façon d’un ordre normé et d’un espace ouvert à une relative liberté d’agir. Ainsi, l’usage coutumier et l’improvisation s’y trouvent continuellement confrontés. L’ordinaire quotidien n’est pas totalement soumis à son principe de régulation, même si cette régulation implicite est constamment présente en toile de fond.
Or, il y a là quelque chose qui intéresse le flâneur qui est justement le plan de fêlure où s’effectuent ces contrastes. Je donnerai en exemple ces scènes presque inapparentes qui mettent en présence à la fois les mécanismes répétitifs du stéréotype et des sollicitations de variation, chacun vivant le lieu commun à sa manière propre : un couple occupé à lire dans un café; une mère et son enfant, dans une cour, au printemps, devant un jouet emboué; des adolescents dans un parc, qui se cherchent et se frôlent; la première ondée de neige dans un terrain vague traversée par un sillage de pas; toutes scènes signifiantes, dans l’esprit du flâneur, malgré et en raison même de leur peu de visibilité et de leur aspect négligeable. Je ne prétends pas que c’est là que la vie ordinaire est la plus innovatrice, loin s’en faut, mais elle y le spectacle de sa créativité et, à qui sait les recevoir et se les approprier, des abîmes de signification. Car ces scènes, et cela est au principe de la démarche du flâneur, ouvrent à une lecture contaminante du perceptif par l’imaginaire, entendu ici comme « l’interface par laquelle un sujet a accès aux éléments de la culture et se les approprie » (Gervais, 2005, p. 35). Ce principe d’appropriation, je ne cesse de le répéter, est fondamental dans la démarche du flâneur.
Il y a ce moment du flâneur que j’appelle la rencontre muette. Dans un café, dans un parc, dans une rue, se trouver à proximité d’individus, à portée de regard, mais sans la pleine médiation du regard, à portée de parole, mais sans l’entremise de la parole, sans le contact direct. En présence, mais sans l’adresse à l’autre. En fait, dans la seule dualité de la présence nue. Une rencontre presque à sens unique, par les sens et par l’intuition.
C’est dans cet esprit qu’on repère le mieux ces individus en échappée, qui, seuls ou en grappe, tendent à produire une vie humaine singulière au sein de la norme et de la vie quotidienne, qui est aussi une vie partagée. Leur paradoxe est le détournement dans l’attachement à la règle et au quotidien. Ces marginaux, ces flâneurs à temps plein dont je parle, donnent en sourdine le spectacle d’un usage de soi, dans l’ordinaire des jours, qui leur permet de créer une cohérence pour soi tout en se maintenant dans le registre des règles communes et dans le courant de la quotidienneté. Ils résistent aux usages répétitifs, à l’émiettement du quotidien, au trop peu de sens de l’agir ordinaire, par des inventions, des astuces, des ruses, des détournements, des insoumissions et autres conduites tactiques « articulées sur des “détails” du quotidien » (de Certeau, 1980, p. 14). Ces personnages donnent l’exemple d’un agir qui permet de se réapproprier l’espace organisé, ainsi que ses usages. Ils s’inventent un devenir en œuvrant à leur adaptation sans nuire à quiconque et en n’étant pareil à personne, bien qu’adhérant au contingent social. J’exagère peut-être, mais il me semble distinguer, dans l’exhibition de ce démarquage mesuré, d’infimes et négligeables traces, mais destraces quand même, d’une procédure de régénération de la vie quotidienne et des normes du vivre ensemble.
Or, plus on observe le phénomène, mieux on aperçoit que ces individus en échappée produisent une « marginalité massive », comme le suggère Certeau (1980, p. 18-19). Car c’est bien, à sa manière et dans sa mesure, ce que chaque individu cherche à faire : adapter les règles disciplinaires du vivre ensemble à son usage propre, de manière à survivre sans totalement s’inféoder; multiplier les occasions d’échapper au lieu commun et à la routine, de manière à résister tout en s’accommodant de la banalité quotidienne. Il y a cela au fond même de la vie ordinaire, une adaptation rusée à la norme et à la quotidienneté. Et peut-être un espoir de recréation du vivre ensemble. En ce sens, ne sommes-nous pas tous potentiellement ou déjà partiellement des marginaux?
En général, en raison même du principe qui les sous-tend, nous ne discernons, des choses du quotidien, que la surface des faits; nous ne distinguons pas la disposition des êtres qui les produisent. Il est cependant un biais particulier de la quotidienneté par lequel l’habitude apparaît moins comme un comportement acquis dans le temps indéfini de la répétition que comme une façon de s’arranger avec la continuité de la vie et de s’éprouver comme être-au-monde. Donc comme une disposition à vivre. Je rappelle, en simplifiant à l’excès, que la pensée aristotélicienne distingue trois types de disposition à faire les choses : la disposition stable (hexis), la disposition passagère (diathésis) et une forme de disposition que je dirais agitée et tout le contraire de saine (pathos). Certains espaces qui m’intéressent, les ruelles, les terrains vagues, les abords de voies ferrées, les rives offrent le spectacle de dispositions passagères. Mais je note que la recherche de stabilité et de dépendance n’y sont pas absentes. Il me semble en effet qu’on saisira sans trop de difficulté, dans les scènes quotidiennes répétées en ces lieux, pourvu qu’on sache voir et entendre, la tendance de la collectivité à s’harmoniser, ainsi que le penchant de l’individu à persister dans sa manière d’être, même si elle est axée sur le désir de non-conformisme ou de mutation – car nous subissons tous les effets d’une aliénation de l’inédit et du tout neuf. Mais on apercevra aussi, en ces lieux de passage, la brutale et parfois cruelle dualité de la cohérence sociale, en tant que monde commun, et de l’individualisme, dans sa forme exclusive de monde à part. C’est que nulle vie, malgré la prétention de certains, n’est disjointe ni autonome. On rencontre, dans des cafés, des parcs, de ces désœuvrés actifs et parfois hyperactifs dans le langage, plus que dans l’action directe, qui en rêvent et en pâtissent, et certains fièrement. Ce sont de beaux personnages de résistants, la plupart contre-productifs, aussi généreux de leur savoir – ils se décrivent d’ailleurs comme ceux qui savent! – que lassants à force de scepticisme et d’insolence. Leurs discours puisent à leur goût pour l’argutie et pour le paradoxe. Mais qu’on me comprenne bien : j’aime infiniment ces bonimenteurs et considère indispensables leur droit de parole et leurs discours.
En guise de clausule
Je parle depuis le début de choses présumées creuses, qui sont si courantes et si grossièrement apparentes qu’elles sont tenues en deçà du seuil d’attention des individus occupés à leurs affaires. Mais sans doute serait-il plus juste de dire que notre comportement collectif à leur égard, c’est-à-dire ce que nous en faisons et ce que nous en disons, révèle une forme de désintéressement qu’on adresse généralement aux choses peu signifiantes, voire insignifiantes. Seul le flâneur agit avec la conscience que ce peu, que ces riens sont le lieu insistant d’une médiation. La chose est compliquée par le genre d’attention que le flâneur accorde à ces choses apparemment de peu de sens. Généralement une attention flottante, plus proche de la distraction que de la vigilance, qui, sans les déliter, écarte en partie les conventions sociales, en tout cas rompt avec les généralisations commodes du quotidien et ainsi procure un lien plus intime avec l’événement du peu. Car ce peu ne peut être pris que par le revers de l’inapplication – une inapplication qui renvoie au refus du regard commun. Je dirais, à titre d’exemple, que même la description obstinée d’un espace humain, détail par détail, à l’aide d’un langage spécialisé, témoignant même du sens du problème propre au scientifique, relève aussi de cette inapplication.
La question que se pose quotidiennement le flâneur reste toujours la même, et nul ne l’a mieux formulée que Georges Perec: «Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l’évident, le commun, l’ordinaire, l’infra-ordinaire, le bruit de fond, l’habituel, comment en rendre compte, comment l’interroger, comment le décrire?» (1989, p. 11) Bref: comment être engagé en écrivain auprès des choses de la quotidienneté?
Bibliographie
Balat, Michel. 2001. Psychanalyse, logique, éveil de coma: le musement du scribe. Paris: L’Harmattan.
Bégout, Bruce. 2005. La découverte du quotidien. Paris: Allia.
Blanchot, Maurice. 1969. «La parole quotidienne». Dans L’entretien infini. Paris: Gallimard.
Carpentier, André. 2005. Ruelles, jours ouvrables. Flâneries en ruelles montréalaises. Montréal: Boréal.
de Certeau, Michel. 1980. L’invention du quotidien, tome I. Arts de faire. Coll. «10-18». Paris: Union générale d’édition.
Cioran, E. M. 1995 [1952]. Syllogismes de l’amertume. Coll. «Folio essais», no 79. Paris: Gallimard.
Clément, Gilles. 1999. «L’esthétique du “tas de bois” ou traité succinct de l’art involontaire». Dans Gilbert Pons (dir.), Le paysage : sauvegarde et création. Coll. «Pays/Paysage». Seyssel: Éditions du Champ Vallon.
Danto, Arthur. 1989. La transfiguration du banal, Coll. «Poétique». Paris : Seuil.
Diderot, Denis. 1955. « Salon de 1767 ». Dans Les Salons : 1759-1781, tome IV. Introduction, commentaires et notes explicatives de Roland Desné. Paris : Éditions Sociales. p. 98-127.
Didi-Huberman, Georges. 1992. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris: Minuit.
Dillard, Annie. 1990 [1974]. Pèlerinage à Tinker Creek. Traduit de l’anglais par Pierre Gault. Paris : Christian Bourgois éditeur.
Dostoïevski, Fedor. 2000. Correspondances, tome 2, 1865-1873. Paris : Bartillat.
Dubois, Christian. 2000. Heidegger. Introduction à une lecture. Paris : Seuil.
Emerson, Ralph Waldo. 2005. Essais. Le Trancendentaliste, L’Intellectuel américain, Le Poète, L’Art. Traduction d’Anne Wicke. Paris : Michel Houdiars Éditeur.
Gervais, Bertrand. 2007. Figures, lectures. Logiques de l’imaginaire, tome I. Coll. « Erres essais ». Montréal : Le Quartanier.
Giono, Jean. 1979 [1953]. Voyage en Italie. Coll. « Folio ». Paris : Gallimard.
Gombrowicz, Witold. 1977 [1968]. Testament. Entretiens avec Dominique de Roux. Coll. « Entretiens ». Paris : Belfond.
Javeau, Claude. 2003. La société au jour le jour. Écrits sur la vie quotidienne. Bruxelles : La Lettre Volée.
Lefevbre, Henri. 1968. La vie quotidienne dans le monde moderne. Coll. « Idées ». Paris : Gallimard.
Maffesoli, Michel. 1979. La conquête du présent. Pour une sociologie de la vie quotidienne, Paris, Presses Universitaires de France.
Merleau-Ponty, Maurice. 1979 [1964]. Le visible et l’invisible. coll. « Tel ». Paris, Gallimard.
Peirce, Charles Senders. 1990. « Un argument négligé en faveur de la réalité de Dieu ». Dans Gérard Deledalle, Lire Peirce aujourd’hui. Bruxelles : De Bœck-Wesmæl. p. 172-192.
Perec, Georges. 1974. Espèces d’espaces. Paris : Galilée
Perec, Georges. 1989. L’infra-ordinaire. Coll. « La librairie du XXIe siècle ». Paris : Seuil.
Pires, José Cardoso. 1998 [1997]. Lisbonne. Livre de bord. Voix, regards, ressouvenances. Coll. « Arcades ». Paris : Gallimard.
Réda, Jacques. 2001 [1982]. Hors les murs. Coll. « Poésie » Paris : Gallimard.
Scarpa, Tiziano. 2002. Venise est un poisson. Paris : Christian Bourgois éditeur.
Segalen, Victor. 1978. Essai sur l’exotisme. Coll. « Le Livre de poche biblio essais ». Paris : Fata Morgana.
White, Kenneth. 1994. Le Plateau de l’Albatros. Introduction à la géopoétique. Paris: Grasset.
[1] Tout au long de cet article, le mot flâneur abrégera l’expression écrivain flâneur. On notera par ailleurs que je préfère le terme quotidienneté à banalité – qui semble plus négativement connoté.
[2] Le mot pouvoir est ici entendu au sens large d’une puissance multiforme, disons d’une rationalité discrète et mouvante, et consensuelle, qui concourt à créer les règles de conduite sociale.
[3] « [C]elui qui voit, écrit Merleau-Ponty, ne peut posséder le visible que s’il en est possédé, s’il en est, si, par principe, selon ce qui est prescrit par l’articulation du regard et des choses, il est l’un des visibles, capable, par un singulier retournement, de les voir, lui qui est l’un d’eux. » (1979 p. 175-176, l’auteur souligne).
[4] « Imaginer une figure, c’est manipuler une forme. » Ibid., p. 20, l’auteur souligne.
[5] Scarpa, Tiziano. 2002. Venise est un poisson. Paris : Christian Bourgois éditeur. ; Réda, Jacques. 2001 [1982]. Hors les murs. Coll. « Poésie » Paris : Gallimard. ; Pires, José Cardoso. 1998 [1997]. Lisbonne. Livre de bord. Voix, regards, ressouvenances. Coll. « Arcades ». Paris : Gallimard. ; Carpentier, André. 2005. Ruelles, jours ouvrables. Flâneries en ruelles montréalaises. Montréal : Boréal.
[6] Évidemment, toutes ces formules, inspirées des écrivains romantiques ou surréalistes qui suggèrent des zones secrètes ou cryptées sous le réel apparent, ne sont que des métaphores pour dire la défaillance de la pensée et peut-être de la sensation dans la saisie du réel.
[7] La référence au poétique, dans ce contexte, ne renvoie pas à la poésie en tant que genre littéraire, mais à la charge émotionnelle et esthétique tirée du rapport au quotidien et possiblement investie dans l’écriture témoignant de ce rapport.
[8] « J’embrasse le commun, j’explore et je vénère le familier et le modeste. » Emerson, Ralph Waldo. 2005. Essais. Le Trancendentaliste, L’Intellectuel américain, Le Poète, L’Art. Traduction d’Anne Wicke. Paris : Michel Houdiars Éditeur. Pour la version originale en anglais de cette conférence datée de 1837 (« I embrace the common, I explore and sit at the feet of the familiar, the low. »), voir le site web « The American Scholar », American Transcendentalism Web, URL <http://www.vcu.edu/engweb/transcendentalism/authors/emerson/essays/amscholar.html>.
[9] Voir Maurice Merleau-Ponty, « Notes de travail », dans op.cit., p. 307 et sq.
[10] Rappelons que le mot grec aisthètikos signifie qui peut être perçu par les sens.
