Entrée de carnet
Le glanage dans la nature et la lecture. Parcours des «Chemins de sable» de Jean-Pierre Issenhuth

Glaner, c’est ramasser après la moisson. C’est aussi cueillir et recueillir, récolter ce qui souvent est oublié, grappiller, butiner et attraper au passage, un fruit comme une impression. Le glanage relève d’abord du geste sensible qu’il importe de découper en étapes cycliques, pour mieux les observer : celle du regard, en premier lieu, qui ne gagne rien à embrasser le champ dans son entièreté. Il ne serait alors perçu que comme immensité vide où plus aucune trace de légume ne subsiste : un horizon de terre retournée et de sillons dévastés. Ce que voient tous les regards, sauf ceux du glaneur et de la glaneuse. Le leur est précis : la tête doit être basse, les yeux posés au sol, sur le bout des bottes ou à quelques mètres tout au plus devant soi.
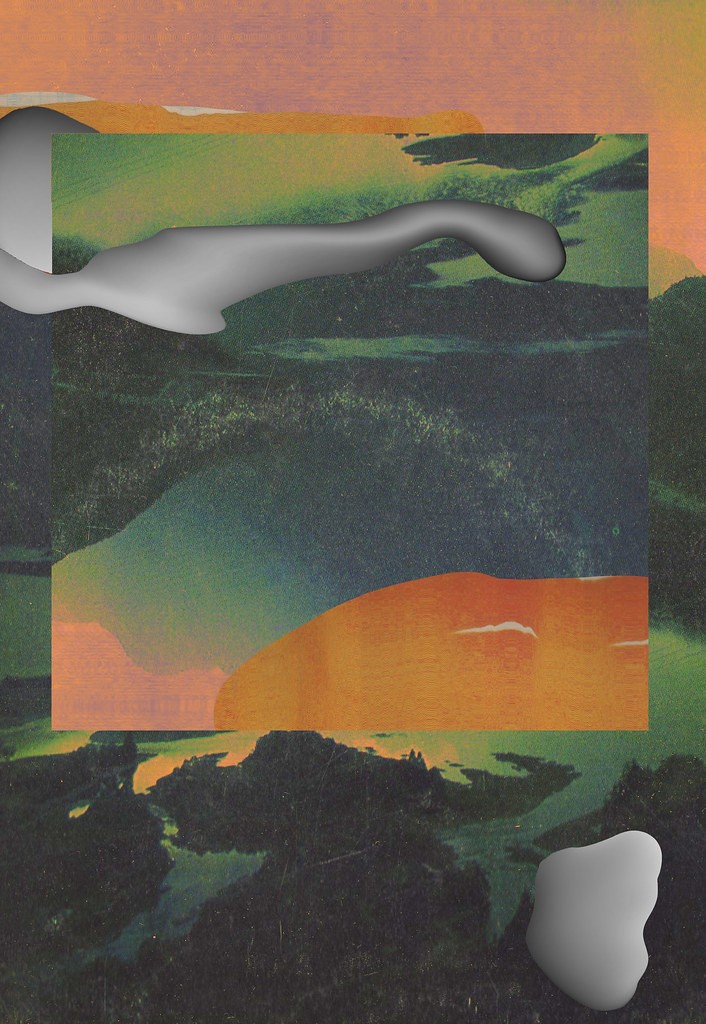
O’Neil, Ashlea. “Untitled”. Collage

(Credit : O’Neil, Ashlea. “Untitled”)
Les légumes et les fruits qui les intéressent auront peut-être été jugés trop petits ; leur taille leur aura permis d’échapper aux griffes bêcheuses, mais négligentes de la récolteuse. Ou bien s’agit-il d’une pomme de terre ou d’un navet enfoui trop profondément ? La moissonneuse n’aura fait qu’en découvrir une partie qui pointe maintenant timidement à la surface, comme un iceberg de chair, et la glaneuse devra le remarquer au milieu de toute cette terre retournée. Le regard du glaneur est individualisant, là où celui du fermier globalise. Ou peut-être, dans ce cas, la tomate est-elle mal formée : elle va rejoindre les invendables qu’on laisserait pourrir au bout du champ. Les déchets de l’un…
Et alors, lorsqu’il est remarqué et jugé acceptable, le légume déclenche l’intervention de la glaneuse: il faut se pencher pour le ramasser. Les genoux se plient, le dos se baisse, la tête se rapproche du sol, dans ce geste humble caractéristique du glanage ou de la révérence, les yeux ne quittant pas l’épi découvert dont les formes se précisent. Le bras s’allonge, la main se tend et, finalement, plonge dans la terre pour se saisir de l’oignon ou de la betterave. Le glaneur se relève, laisse tomber sa récolte dans son panier, la poche de son tablier ou le bas d’une chemise tendue d’une main, pour les moins prévoyants. Puis le cycle recommence : on avance lentement, les yeux au sol.
En plus du geste, le glanage est aussi une pratique définie, encadrée par une série de règlements. Les premières traces du glanage dans la littérature nous viennent de loin. Le Lévitique mentionne cette pratique comme une forme de droit moral du pauvre sur le riche, une maigre consolation offerte par le renversement temporaire de la pyramide économique : «Tu ne glaneras pas ta moisson. Tu ne grappilleras pas ta vigne. Tu les abandonneras au pauvre et à l’étranger.» (Lévitique, s.d.)1 Extrait du Lévitique (19, 9 et 10), recopié par un.e auteur.e anonyme, dans l’entrée «Glaner, glaneur, glanure» du Dictionnaire de l’Académie française, disponible en ligne : http://www.academie-francaise.fr/glaner-glaneur-glanure Y verrait-on aussi une miette d’élitisme ? La nécessité, pour manger, de remarquer ce qui reste, jusqu’au plus petit fruit, et le geste d’abaissement qui accompagne la récolte minutieuse, tu les laisseras aux pauvres. Plus altruiste, le Deutéronome : «Lorsque tu feras la moisson dans ton champ, si tu oublies une gerbe, ne reviens pas la chercher. Elle sera pour l’étranger, l’orphelin, la veuve.» (Deutéronome, s.d.)2 Extrait du Deutéronome (24, 19), recopié par un.e auteur.e anonyme, dans l’entrée «Glaner, glaneur, glanure» du Dictionnaire de l’Académie française, disponible en ligne : http://www.academie-francaise.fr/glaner-glaneur-glanure Le glanage est déjà une contre-pratique, ses adeptes sont anonymes ; masses indifférenciées de gens «dans le besoin», auxquelles on n’accorde un droit de subsistance qu’après que la récolte du propriétaire est assurée, sous peine de lourdes amendes. Le glanage est la dernière intervention humaine avant l’abandon, la pourriture et la décomposition.
Mais les glaneurs ont aussi été l’objet de revalorisations comme en témoigne, plus près de nous, le poème d’ouverture du premier numéro de la revue d’histoire et de littérature Le Glaneur, publié à Lévis de 1890 à 1892, par Pierre-George Roy :
Tu viens à temps, dans le fertile automne,
Charmant Glaneur, ramasser les épis.
Que sous tes pas leur richesse foisonne !
Tu viens à temps, dans le fertile automne.
Si tu n’es pas le faucheur qui moissonne,
Recueille, au moins, les brins qu’il n’a pas pris
Tu viens à temps, dans le fertile automne,
Charmant Glaneur, ramasser les épis.
[…]
Reçois mes vœux pour ta longue existence
Et mes souhaits pour tes succès croissants ! (Frid-Olin, 1890 : 3)
Écrit sous le pseudonyme de Frid-Olin, le poème agglomère, dans la figure du glaneur, non seulement les praticiens et praticiennes du glanage dans les champs, mais aussi le lectorat de la revue et la revue elle-même, à laquelle il souhaite longue vie. À la page suivante, la lettre de présentation compare la publication à «un glaneur qui ramasse sur les pas du génie ce que les autres n’ont point vu !» (Brunet, 1890 : 4)
Si les structures économiques et la gestion agroalimentaire ont bien changé depuis la parution de ce numéro, la pratique du glanage, elle, demeure, à la fois sous des formes anciennes et modernisées. Le dumpster diving – la récupération de nourriture toujours propre à la consommation dans les vidanges de supermarchés – est une réaction face à l’absurdité concrète d’une économie qui ne traite, ou ne peut concevoir, que de grands ensembles. Le dumpster diver consacre au contraire son attention à la proximité (telle poubelle est plus fertile qu’une autre) et exerce un regard individualisant au milieu de l’uniformisation des techniques industrielles de traitement et de conservation.
Plusieurs artistes ont également réactualisé cette pratique et approfondi les liens réels et métaphoriques qui l’unissent à la lecture et à la création. Parmi eux, Agnès Varda, dans le documentaire Les glaneurs et la glaneuse paru en 2000, compare sa récolte d’images, qui s’intéresse au plus près aux objets filmés, à la pratique du glanage. De même, dans Glaneurs de rêves, Patti Smith la rapproche de son activité de poétesse : «Et l’image des glaneurs de ce champ endormi me plongeait à mon tour dans le sommeil. Et je me promenais parmi eux, dans les chardons et les épines ; ma tâche n’avait rien d’exceptionnel : arracher une pensée fugace, telle une touffe de laine, au peigne du vent.» (2014 : 27-28)
Lorsqu’il écrit Chemins de sable, de 2007 à 2009, Jean-Pierre Issenhuth se fait le relais de cette métaphorisation du glanage, mais aussi de sa pratique nourricière dans les champs. Issenhuth réfléchit, en la réactualisant, à la figure du glanage, pratiquée à la fois dans les dépotoirs, les champs de fruits et de légumes, et ceux de la littérature, au fil de ses rencontres dans les livres. Dans ces derniers, il glane des passages, des phrases ou des paragraphes, qui frappent sur le coup ou demeurent enfouis quelque temps avant de ressurgir. Mais ce glanage textuel est loin de n’être qu’une métaphorisation ou une idéalisation de la pratique, sans dimension concrète. Dans les livres aussi, il faut se pencher pour ramasser.
La vie dans les Landes
Installé dans les Landes de Gascogne, dans une cabane isba à moitié trouvée, à moitié reconstruite, Issenhuth vit en solitaire. Ses carnets – Chemins de sable et celui qui le précède, Le cinquième monde –, composés de courtes entrées, sont autant un compte-rendu de ses activités journalières (fabrication de compost à partir de déchets de poulailler, travail du jardinier dans son potager, soin apporté à ses canards et à leur mare, etc.), qu’une série de commentaires et de variations sur les livres qu’il lit, le soir, et sur la musique qu’il écoute.
Ancré dans ses activités quotidiennes, le glanage qu’il pratique ne revêt pas une forme tout à fait moderne. Selon Jennifer Marshman et Steffanie Scott, «[m]odern gleaning has taken on a new form once again, […]; volunteer gleaners participate not necessarily to feed themselves, but to serve a variety of motivations from decreasing food waste to providing food to social service organizations that need it.» (2019 : 103) Alors que le glanage a été dévalorisé comme moyen nécessaire aux populations pauvres pour combattre leur propre insécurité alimentaire, les glaneurs d’aujourd’hui ne sont pas forcément ceux qui bénéficieront directement de leur moisson. Celle-ci se retrouve souvent dans les réserves des banques alimentaires. Pour Issenhuth, au contraire, le glanage est une des sources de sa propre alimentation, suppléée par ses plantations qui nourrissent le troc:
À part peut-être les topinambours, la roquette, la mâche, le fenouil, les potimarrons, les scorsonères et les aubergines blanches, je n’aurai cultivé ici qu’une quinzaine de légumes courants – chacun en assez grande quantité – par exemple : 100 laitues l’année dernière, 300 poireaux cet hiver – pour alimenter le troc qui régit les relations dans ce petit coin de forêt. (2010 : 75)
Ce coin des Landes apparaît ainsi se maintenir dans une certaine autarcie, dans la mesure où l’instanciation moderne du glanage et les formes monétaires d’échange n’ont pas entièrement remplacé les pratiques plus anciennes de subsistance. Que glane l’auteur ? Un peu de tout. Par exemple, du bois de chauffage :
Chaque année, la préparation du bois de chauffage me mobilise six ou sept semaines. Le ramassage dans la forêt dépend de la fréquence et de l’étendue des coupes d’éclaircissement et de la négligence des bûcherons. Il y a toujours à ramasser des cimes de pins, des rondelles sciées pour égaliser la base des troncs, quelquefois d’intéressants tronçons oubliés. S’il n’y avait pas le glanage, dans une maison sans isolation, je mourrais de froid. (145)
Des matériaux de construction :
Hier et ce matin du 18 janvier, j’ai percé un trou dans le toit de la petite grange pour poser une cheminée. Pendant sept ans, j’en avais cherché les éléments au dépotoir – tuyaux, solin, clé de tirage, chapeau. Le petit poêle m’a été donné. J’ai fabriqué le coffre à bois. À la fin, il ne manquait qu’un agrandisseur pour la sortie du poêle et un coude de tuyau, que j’ai achetés. (229)
De la matière pour son compost :
Ce qui serait au Québec une grande pelle à neige en aluminium est ici la pelle à fumier que je manie tous les matins dans les cabanes des poulets […] Il s’agit, chaque fois, de charger une remorqueuse que le tracteur conduit chez moi, à 2km. […] La complexité des opérations les rend peu applicables aux grands espaces, même avec un matériel adapté, et favorise la polyculture intensive, plus économe en substances toxiques que la monoculture extensive. Il y faut simplement du temps et la foi en l’issue heureuse d’une aventure un peu compliquée. (254-255)
Et, bien sûr, des légumes, dans un passage où il compare ce glanage dans les champs à sa recherche, comme lecteur, d’un «élément inspiré», émergeant soudainement du fond plus ou moins insipide de la masse de texte avalée tous les jours :
L’élément inspiré peut être un détail, une phrase, un paragraphe. L’attente de cet élément rapproche la lecture du glanage que j’aime pratiquer dans les champs de carottes, d’oignons, de navets ou de pommes de terre (pour moi), et de maïs (pour mes canards). Je trouve à glaner quand la moissonneuse ou la récolteuse sont déréglées. Et quand je trouve, en lisant, des passages inspirés, est-ce que la machine de l’écrivain est déréglée ? (57)
Lorsqu’il débusque un tel passage, Issenhuth le recopie dans son carnet, avant d’y ajouter ses impressions, ses commentaires ou d’en souligner la proximité avec la pensée d’autres auteurs et autrices. L’œuvre entière n’est jamais commentée, seulement ces éléments découverts, ce qui rapproche ses interventions du close reading pratiqué par la critique littéraire. Et l’on retrouve ici le regard du glaneur, ce regard qui lutte contre son évaporation dans la distance : «“We have been schooled in the romantic gaze into the distance of the historical realm,” Benjamin observed, and “mythology, to use Aragon’s term” also “shifts things away from us…” » (Benjamin, recopié par McCole, 1993 : 246) Regarder au loin, c’est ne voir que le champ moissonné, aucun des légumes et des fruits qui pourtant y demeurent. Benjamin appelle au contraire à une recherche du tactile nearness, en tant que «concrete, materialistic reflection on the things that are closest…» (246) Le glaneur resterait les mains vides si son regard n’était prolongé par la recherche d’une proximité tactile ; ou peut-être est-ce l’inverse : le travail de la main et l’attente de l’objet à toucher, sa matérialité pour l’instant absente, visible en négatif dans la main vide, tenue comme en suspension, est ce qui appelle la forme du regard glaneur, toujours orienté vers ce qui peut être ramassé, saisi. Pour Jo Croft, «when we move like gleaners, we follow a drift of matter.» (2018 : 3) La glaneuse se laisse conduire par une vibration de la matière qui réclame son toucher. Son regard aimanté comme un détecteur de métal sur une plage de sable.
Glaner, c’est aussi rendre présente l’absence. «According to Serenella Iovino, waste can offer an imaginative conduit to that which is otherwise culturally disavowed: “[It] is the other side of our presence in the world, our absence made visible,” […]. The idea of waste as a “visible absence” (Iovino 2009, p. 6—cited in Alaimo 2016, p. 138).» (Iovino, recopié par Alaimo, recopié par Croft : 5) Le champ a été, aux yeux de tous, déjà récolté. Ses oubliés, déjà décomposés. Puis une glaneuse en émerge, avec un sac rempli de légumes beaux et frais, qu’elle semble avoir fait apparaître par génération spontanée. De même, recopier un passage, comme le fait Issenhuth lorsqu’il débusque «l’élément inspiré», c’est me rendre présent un livre que je n’ai jamais tenu, une page que je n’ai jamais feuilletée. Je peux presque la toucher, par l’entremise d’une autre, qui lui prête sa matérialité et superpose leurs présences. Et ce sont également les auteurs convoqués qui joignent leurs voix à celle d’Issenhuth, qui font entendre leur polyphonie, dans un joyeux casse-tête d’intentionnalités rompues, d’indémêlables qui a dit quoi ?, d’où émerge un rapport au texte non pas comme présence ou absence, mais comme absent visibility, toujours déjà «cité dans» – comme je recopie Croft qui recopie Alaimo qui recopie Iovino et McCole qui recopie Benjamin qui recopie Aragon –, déjà différé, et dont la matérialité inépuisable, telle celle du champ d’un propriétaire, offre au glaneur un territoire où exercer sa main et ses droits.
Fixer les dunes
En plus de l’intimité du regard, le geste de la main rapproche le glanage des textes du glanage des champs. Pour Issenhuth,
[l]a littérature est un gigantesque dépotoir où je cherche des bouts de bois ou de la ferraille qui pourraient servir. La rouille et la pourriture ont fait leur œuvre, il n’y a plus grand-chose de bon, mais on ne sait jamais d’avance. Il m’est arrivé de ramasser des planches et des madriers non traités qui s’étaient parfaitement conservés après des années d’exposition aux intempéries. (2010: 154)
Le glaneur textuel doit encore ramasser ce qu’il trouve. Cette inclinaison du corps revêt une importance primordiale, selon Varda, car il est le plus caractéristique du glanage. Croft commente cet acte du corps dans Les glaneurs et la glaneuse:
Varda […] celebrates the action of “stooping” (“se baiser” [sic]) as a paradoxical gesture of political and aesthetic defiance. Taking on the gleaner’s peculiarly intense concern with the movement of matter, Varda reminds us that when we stoop (se baiser [sic]) we also almost kiss the ground (se baisser [sic]); we connect to the material world differently—with both sensory pleasure and with political acuity… or as Benjamin puts it, “with tactile nearness” (Benjamin 1999, p.848). (2018 : 14)
Au-delà de l’erreur de traduction, la confusion de Croft nous rappelle à quel point, chez le glaneur, se baisser et baiser la terre ne sont qu’une seule et même action. Ramasser le raisin devient alors une révérence, un baisemain : en s’inclinant, le glaneur salue ce qui a permis de produire ce qu’il récupère, nous remettant le sol en face: «Ce qui m’étonnera toujours, c’est l’ignorance que des gens parmi les meilleurs ont de la terre qui les nourrit et assure la santé.» (Issenhuth, 2010 : 153) Tel le glaneur guidé par la matière, l’attention à son geste nous guide vers une nouvelle relation sensible au monde, comme juge pertinent de le recopier Issenhuth des pages de Corps à corps de Jean-Louis Chrétien : « “Que verrions-nous sans mains ? Il n’est de monde que par elles.” “Toute œuvre humaine est manuelle: ce sont toujours et partout nos mains qui œuvrent, même quand elles ne travaillent pas.” “Les mains pensent et la pensée manie: c’est l’humanité même de l’homme.”» (2010 : 147)
Dans Chemins de sable, presque chaque page contient une citation, parfois très longue, de sorte qu’une bonne quantité du carnet est composée par les mots des autres. Les pages 242 et 243 ne sont qu’une juxtaposition de citations tirées de différents livres de William James qu’Issenhuth offre au lecteur, et qu’il interprète déjà par leur rapprochement dans l’espace textuel. Une oreille française trouvera étrange que Croft, dans sa citation précédente, ait choisi de pronominaliser «se baiser», au lieu simplement de «baiser». Mais dans les choix qu’opère la glaneuse, par un retournement vers soi, n’est-ce pas aussi son identité qui s’exprime ? Sa patience, sa résilience, ses choix de fruits à recueillir ou son seuil de tolérance aux légumes amochés. Encore davantage, dans un recueil de citations trouvées, c’est une autobiographie qui apparaît. «En littérature, glaner, c’est encore choisir…» (Viator, 1890 : 203)
Le poète Kenneth Goldsmith, fer de lance de l’écriture sans écriture (uncreative writing), ne dirait pas autrement. Dans sa pratique, Goldsmith se réapproprie les mots des autres en les recopiant textuellement, puisqu’à ses yeux il est
impossible d’éradiquer l’expression de soi-même. Même lorsqu’on fait quelque chose d’aussi mécanique que recopier quelques pages, c’est nous-mêmes que nous exprimons de façons différentes. Nos choix, nos réarrangements en disent autant sur nous-mêmes que si nous racontions l’opération du cancer de notre maman. C’est juste qu’on ne nous a jamais appris à valoriser de tels choix. (2018 : 16)
Sous le regard de Goldsmith, les questions d’originalité et d’inspiration perdent de leur légitimité, au profit du choix du matériau textuel et de la performance du geste qui révèlent alors toute leur potentialité expressive. Goldsmith se serait plu dans la forêt des Landes de Gascogne, où Issenhuth écrit ses carnets, puisque la répétition y est partout visible : le pin maritime, ou pinus pinaster, constitue presque sa seule essence.

‘Chemin dans la forêt des Landes”. http://www.650kilometres.com/2016/10/20/voyage-au-coeur-de-la-plus-grande-foret-de-france/. Photographie.
La forêt des Landes de Gascogne et un de ses chemins de sable, dominée par pinus pinaster et la fougère aigle (pteridium aquilinum) qui en tapisse le sol.
(Credit : ‘Chemin dans la forêt des Landes”. http://www.650kilometres.com/2016/10/20/voyage-au-coeur-de-la-plus-grande-foret-de-france/)
La forêt des Landes a été l’objet d’importantes interventions humaines ayant modifié considérablement sa composition au cours des derniers siècles. Ce territoire « était devenu au XVIIIe siècle, une vaste lande presque improductive, d’où émergeaient de loin en loin de petits bouquets de Pins maritimes ou de Chênes tauzins. » (Chevalier, 1925 : 605)3 Malgré son âge, l’étude de Chevalier demeure l’une des plus intéressante à consulter dans une perspective d’occupation humaine et poétique du territoire landais. Pour des recherches plus récentes (et scientifiques), voir Trichet et al. (1999) ou Jolivet et al. (2007), qui confirment les observations que Chevalier fait ici. La faible présence de végétaux capables de pousser dans ce sol capricieux entraînait le mouvement des dunes de sable du littoral vers l’intérieur des terres, contribuant ainsi à sa désertification : «La dune gagnait vers l’intérieur et le sable menaçait de tout submerger.» (605) Pinus pinaster s’avéra être une des rares essences à pouvoir supporter les contraintes locales et, à partir de la fin du XVIIIe, de grands travaux d’ensemencements de ces terres avec des graines de pin (dirigés plus tard par l’État français) eurent lieu dans le but de fixer les dunes. Issenhuth s’émerveille devant la résilience des habitants :
Tout a été extraordinaire dans l’adaptation des anciens Landais à une géographie sans pitié : marécages sans fin, sable noir, herbe rare et dure (la molinie), nappes phréatiques affleurantes, minerai de fer très pauvre (la garluche) épars dans le sable, argile à quelques endroits, plantation de pins maritimes possible à condition de creuser à la main une multitude de fossés de drainage. (2010 : 198)
Sous l’insistance des efforts de modification géologique, la forêt des Landes passa de 300 000 ha, en 1857, (Chevalier, 1925 : 605) à 632 300 ha aujourd’hui, affichant un état de «quasi mono culture du Pin maritime (présent sur 87% des surfaces boisées), dont l’origine est presque exclusivement anthropique (seconde moitié du XIXe siècle)». (Service de l’État dans les Landes, 2015) La répétition à grande échelle de la ritournelle de la tradition landaise de plantage du pin, ritournelle au sens où l’entendent Deleuze et Guattari d’assemblage territorial (1980, chap. 11), c’est-à-dire de marquage du territoire par le geste repris, dans un processus hétérogène où s’entremêlent essence d’arbre, État français, savoir-faire et terroir landais, cette «tendency for action and material to coalesce» (Croft, 2018 : 4) est visible dans un entrelacs corporel auquel se mêle le geste répété et répétitif de description du pin dans la prose d’Issenhuth, où ses fragments « take on the looping qualities of a record stuck in a groove» (4) :
«du bois de chauffage (pin ou chêne) que je fends», «les aiguilles de pin qui tapissent le sol», «ramasser des cimes de pins», «sous les pins, les chênes et dans les prairies naturelles des Landes», «plantation de pins maritimes », «la résine de pin», «Les pins de la forêt », «prises dans les pins», «la déroute des pins», «tant de propriétaires de pins », «La quantité de branches qu’un pin», «déracinés par l’ouragan (4 pins)», «sur le fond vert permanent des pins sombres», « les chênes, les pins et les bambous auraient spontanément et rapidement colonisé tout l’espace.» (2010 : 44, 45, 145, 184, 198, 199, 207, 214, 231, 232, 238, 239, 257, 308)
Les Landes sont une forêt plantée, anthropique, un sol territorialisé par la répétition d’un geste dirigé vers lui, durant des siècles. Variations constantes d’une copie sans auteur : «Ce n’est pas Brémontier qui inventa, vers 1786, le moyen de fixer les dunes ; il ne fit que continuer une ancienne tradition en amplifiant les travaux.» (Chevalier, 1925 : 605)4 Notons que Chevalier défend cette interprétation bien avant «Roger Sargos (1949) [qui] fut l’un des premiers […] à s’engager en faveur d’une réhabilitation des habitants des landes dans la “création” de cette forêt», à en croire Jolivet et al. (2007 : 13). Mais, plus encore, les pins maritimes se sont aussi plantés eux-mêmes, et ont planté les habitants landais qui n’auraient pu, sans eux, s’y installer, y demeurer, jardiner, glaner. Les Landes nous révèlent une agentivité du végétal qui s’immisce jusque dans les carnets d’Issenhuth, emprunte son geste d’écriture pour se matérialiser autrement, et qui affirme son pouvoir de fixation de la sédentarité humaine en tant que capacité du végétal à guider les actions animales, à la manière dont le fruit oublié conduit le geste du glaneur.
Pour Issenhuth, les Landes sont le pays où se vit, justement, la fécondité de ces contradictions : «Répéter sans répéter, inventer sans inventer – ainsi se conjuguent aussi les contraires dans la forêt landaise.» (2010: 329) La forêt est une répétition de chaque pin, et comme l’action de la copiste et du glaneur, nous révèle un rapport différent à l’agentivité, à l’auctorialité de nos gestes fixés par d’autres – d’autres écrivains et écrivaines, d’autres formes de vie –, comme ces dunes qui n’auraient pu se fixer sans coaction de l’humain et du végétal : leur assemblage dans la reterritorialisation, la répétition du refrain planteur. La forêt des Landes, où l’humain se laisse conduire par l’action du végétal, où la main d’Issenhuth se laissa diriger par le texte à recopier, «à l’opposé du combat pour trouver “l’inspiration”.» (Goldsmith, 2018 : 204-205)
Copier, c’est aussi fixer. Replanter dans un nouveau sol. Inventer sans inventer, oui, mais changer le même. Une page devient un champ où se transplantent les mots et ce champs, le parcours d’une nouvelle territorialité.
Chemins de sable
Après avoir demandé à ses élèves de pratiquer un travail de recopie, Goldsmith remarque que «[b]eaucoup étaient devenus attentifs au rôle que joue le corps dans l’écriture – depuis la posture jusqu’aux crampes dans les mains ou au mouvement des doigts –, et étaient devenus conscients du côté performatif de l’écriture» (205), c’est-à-dire du rôle de l’écriture sur soi, car copier, loin de ne recontextualiser que le texte, rend visible l’action des mains comme une agitation sur la page et sur nous-mêmes. Il s’agit d’un réassemblage de soi :
Walter Benjamin parle de la puissance et de l’utilité de la recopie comme geste, et lui-même était un maître de la recopie […]: “L’attraction d’une route de campagne sera différente selon qu’on la suit en marchant ou qu’on la survole en avion. De la même façon, la puissance d’attraction d’un texte est différente selon qu’on le lit ou qu’on le recopie. […] Seul le texte recopié provoque l’attraction de l’esprit de celui qui s’y livre, là où celui qui se contente de lire ne découvrira jamais les nouveaux pans intérieurs qu’ouvre en lui le texte…” (Benjamin, recopié par Goldsmith : 154)
Nous retrouvons cette proximité tactile entre soi et la matière dont parlait plus tôt Benjamin : le geste de recopier révèle le texte comme matérialité, et par là, notre proximité avec lui, nos champs d’interaction. Ce réassemblage de soi au texte ne peut se faire que par le geste que l’on pose. Pour le décrire, Goldsmith emploie le terme de «désorientation» (2018, chap. 11), qui traduit l’adoption momentanée, par l’acte créateur de la recopie, d’une posture qui n’aurait autrement jamais été la nôtre.
Le végétal s’avère lui aussi performatif, en ce qu’il mêle le geste: le légume oublié nous pousse à le ramasser. Il nous pousse, nous confère une impulsion, alors dans quelle mesure agissons-nous uniquement par nous-mêmes lorsque nos genoux se fléchissent et que notre main se tend pour le recueillir ? Il m’est impossible de passer à côté de bleuets sauvages sans en manger quelques-uns. Glaner un fruit, aussi, possède une qualité de désorientation, de réassemblage de soi auquel, peut-être, nous n’avons jamais appris à être attentifs et attentives. Les fragments de textes qu’Issenhuth recopie l’«appellent», au-delà de toutes qualités littéraires ou formelles identifiables. En cela, ils se comportent comme des chemins de sable sur lesquels l’auteur repasse sans cesse, en les approfondissant à chaque allée et venue. Je recopie un de ces passages, à mon tour, en espérant y laisser une trace:
Les chemins de sable (telle est la “rue” où j’habite) ont une vie bien particulière. Le passage des véhicules (un ou deux par jour) y creuse à la longue deux ornières parallèles qui s’approfondissent sans cesse. Le chemin réclame donc une surveillance régulière, faute de quoi, un jour ou l’autre, le châssis d’un véhicule restera collé à l’îlot central. […] Ce sont des chemins de travail, et le travail forestier est une chaîne de relais. Là où finit l’empilage des billots commence le chargement sur les grumiers. (Issenhuth : 187)
Si ces chemins ont eu une influence sur la pratique d’écriture d’Issenhuth – davantage que par un symbolisme caché, la métaphore d’un sens profond et transcendant –, c’est par le jumelage corporel de l’organisme à son environnement, la proximité tactile entre l’auteur et ces chemins, qu’Issenhuth nous invite à explorer à travers la représentation. En leur octroyant une place dans son écriture, il prend acte, du même coup, de son interaction poétique et cognitive avec leur vie particulière, interaction que Clark et Chalmers décrivent comme un «système jumelé» dans lequel:
the human organism is linked with an external entity in a two-way interaction, creating a coupled system that can be seen as a cognitive system in its own right. All the components in the system play an active causal role, and they jointly govern behaviour in the same sort of way that cognition usually does. (1998 : 8, souligné dans le texte)
Les chemins de sable sont un de ces lieux habités d’une matérialité cognitive à chaque sillon qui s’y creuse ; un lieu où se trace une géologie de l’esprit sans cesse modifiée par sa fréquentation et ses passages : opposition rendue malléable par la proximité matérielle de ses contraires, intriqués par des actions sans intention, comme lorsque la moissonneuse se dérègle. Glaner et recopier sont des actions de ce type. La main trace des lettres comme elle saisit une nonnette voilée. Et la racine qui pousse fixe la dune.
Bibliographie
- 1Extrait du Lévitique (19, 9 et 10), recopié par un.e auteur.e anonyme, dans l’entrée «Glaner, glaneur, glanure» du Dictionnaire de l’Académie française, disponible en ligne : http://www.academie-francaise.fr/glaner-glaneur-glanure
- 2Extrait du Deutéronome (24, 19), recopié par un.e auteur.e anonyme, dans l’entrée «Glaner, glaneur, glanure» du Dictionnaire de l’Académie française, disponible en ligne : http://www.academie-francaise.fr/glaner-glaneur-glanure
- 3Malgré son âge, l’étude de Chevalier demeure l’une des plus intéressante à consulter dans une perspective d’occupation humaine et poétique du territoire landais. Pour des recherches plus récentes (et scientifiques), voir Trichet et al. (1999) ou Jolivet et al. (2007), qui confirment les observations que Chevalier fait ici.
- 4Notons que Chevalier défend cette interprétation bien avant «Roger Sargos (1949) [qui] fut l’un des premiers […] à s’engager en faveur d’une réhabilitation des habitants des landes dans la “création” de cette forêt», à en croire Jolivet et al. (2007 : 13).
