Hors collection, 01/01/2008 12:00 am
Fin de partie
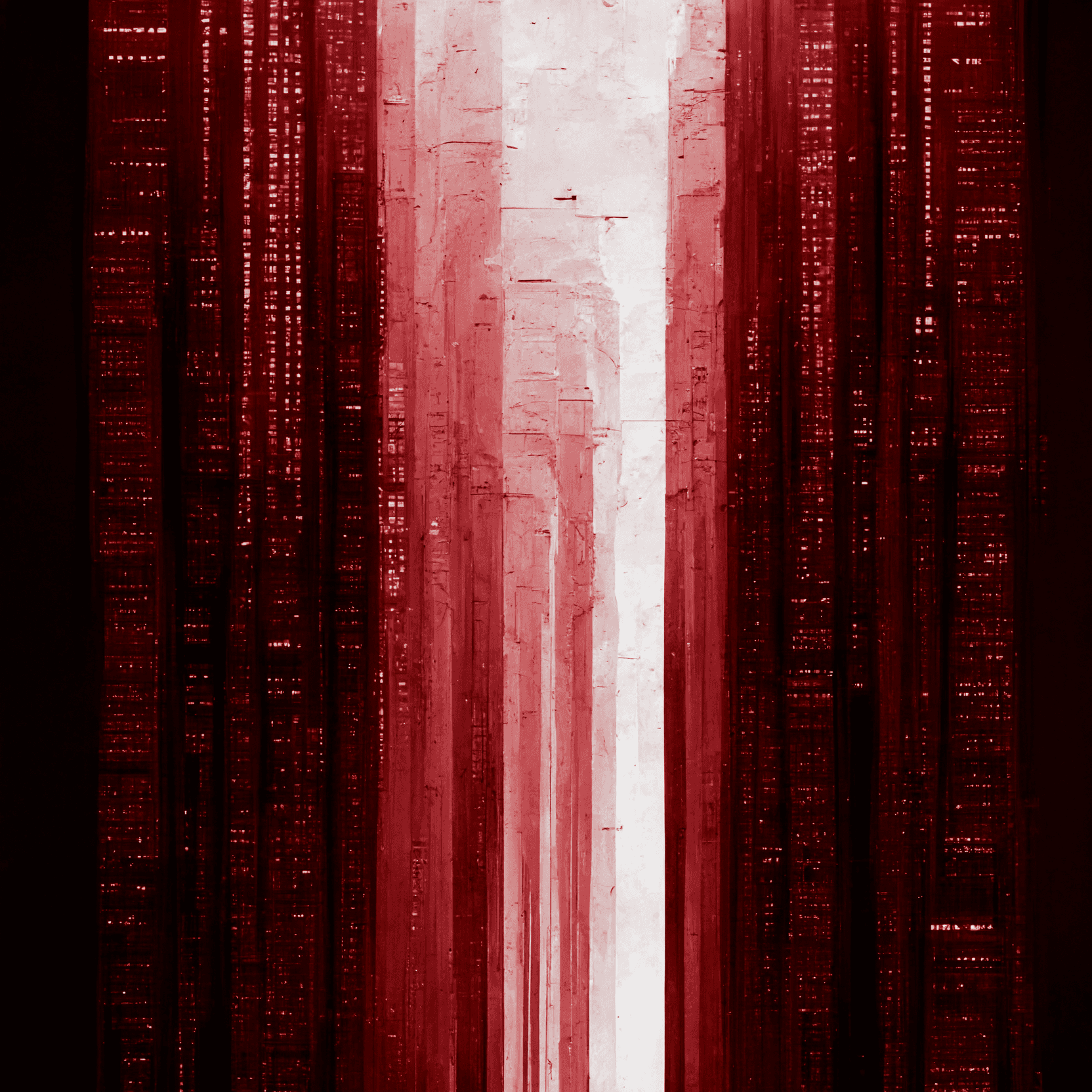
In the United States more women are battered on the day of the American football championship than on any other day of the year. […] Spectators may well get excited about these repeated demonstrations of basic masculinity. The more excited they become through passive participation, the more their own active manhood may be put into doubt. In the final analysis, a guy’s got to prove his own worth by hitting someone himself. Or it may simply be that American women are unbearably slow fetchers of beer. (John Saul, The Doubter’s Companion)
‘‘It’s only a game,’’ he said, ‘‘but it’s the only game.’’ (Don DeLillo, End Zone)
The only real joy in life is power, and there’s just not enough of it to go around. (Robert Coover, What Happened to Gloomy Gus of the Chicago Bears?)
Je ne suis pas convaincu que beaucoup de joueurs de football, professionnels ou collégiaux, se rendent compte de l’importance de la dimension sémiotique du sport qu’ils exercent. Il est rare qu’on connaisse bien la sémiotique sans être allé à l’université et les footballeurs, s’ils y sont tous passés, semblent garder un souvenir parfois confus de ce qu’ils ont appris dans leurs cours. Pensons à l’ancien quart-arrière Joe Theisman affirmant en ondes qu’on ne peut parler de génie à propos d’un joueur de football parce que ce terme est réservé à des hommes comme Norman Einstein. Ou au joueur défensif des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Andy Katzenmoyer qui a terminé ses études par la grâce d’un cours d’été intitulé «Prévention du sida» et dont le travail final consistait à aller dans une pharmacie et à écrire correctement le nom d’un certain nombre de marques de condoms.
On excusera ces remarques sarcastiques, qu’on pourrait, ceci dit, multiplier à l’envi. Elles peuvent en effet apparaître comme des signes de mépris envers des individus à qui personne ne demande de réécrire l’histoire des sciences et des arts — quoi qu’on pourrait aussi voir à l’inverse comme un signe de mépris le peu de valeur que semblent accorder certaines universités aux diplômes qu’elles décernent. Cette entrée en matière me conduit cependant à formuler trois remarques importantes qui formeront le cadre herméneutique de l’analyse que je proposerai de deux romans américains, End Zone de Don DeLillo et Whatever Happened to Gloomy Gus of the Chicago Bears? de Robert Coover, traitant explicitement de football — terme dont on notera l’étrangeté, puisque contrairement au soccer (que l’immense majorité des être humains appelle, justement, le football), cela ne se joue pas uniquement avec les pieds.
Premièrement, dans ce sport «intellectuel» dont la porte d’entrée est l’université et qu’on a souvent comparé aux échecs, l’individu est entièrement subordonné à l’équipe. L’intelligence du joueur, nécessaire dans un sport considéré comme très complexe, ne vaut rien si elle ne se fond pas entièrement dans la stratégie du groupe. Certes, les habiletés singulières comptent et les vedettes n’existent pas par hasard. Cependant, pour utiliser un syntagme figé, un joueur ne peut gagner un match à lui seul, ce qu’on a pu dire par contre pour Wayne Gretzky ou Mario Lemieux au hockey, Michael Jordan au basketball. On cherchera en vain, dans un autre sport d’équipe nord-américain, des entraîneurs sur les lignes de côtés dessiner de manière aussi compulsive des schémas pour expliquer le développement de certains jeux. Or, il s’agit de quelque chose d’essentiel au football pour rendre compte d’un mouvement d’ensemble.
Ma deuxième remarque concerne les caucus, où les joueurs s’assemblent en rond autour du quart-arrière qui annonce le déroulement du prochain jeu — signe déjà, scansion sans cesse renouvelée, de cet “esprit de corps” que doivent manifester les membres de l’équipe. Or, il n’existe sans doute rien de plus sémiotique au monde que les propos qui sont tenus à cet instant. Soit les énoncés suivants: «Blue turk right, double-slot, zero snag delay»; «Quick picket left, hook right. Twin option off modified crossbow. Re-T, chuck-and-go»; «Circus formation zebra thirty-four end left swift motion ninety-nine on one.» Comment interpréter ces signes? L’auditeur ou le lecteur peut comprendre certains mots (apparemment de langue anglaise). Mais à quoi peuvent-ils bien renvoyer? L’amateur de football aura compris que ces propos, kabbalistiques en apparence, se traduisent par trois jeux différents. Comme l’énonce Gary Harkness, le narrateur de End Zone, «All teams run the same plays, but each team uses an entirely different system of naming.» (95) C’est le seul sport «guided by language, by the word signal, the snap number, the color code, the play name.» (90)
On pourra toujours avancer que cette opacité des signes se constate également devant une formule mathématique complexe et que le néophyte ne s’y retrouve pas davantage. Mais il existe une double différence. D’une part, un individu qui ne possède pas de connaissances mathématiques de haut niveau ne s’attend pas à comprendre et trouve normal de ne pas savoir de quoi il retourne; au football, l’amateur sait très bien ce qui se passe au caucus mais, même s’il entendait, il ne pourrait pour autant deviner le jeu (pas plus que les joueurs défensifs, chaque équipe développant ses propres codes, comme la citation tirée de End Zone le laisse bien entendre). D’autre part, l’équation mathématique ne conduit pas nécessairement à un résultat concret immédiat, alors que l’appel du jeu, lui, a des effets pragmatiques instantanés. Le caucus apparaît comme une pause déterminante qui insiste sur la dimension cryptée du jeu et s’exprime dans ce rassemblement des joueurs, penchés sur le quart, qui semble, à distance, leur chuchoter un message secret.
On entend souvent des gens affirmer que le football les ennuie à cause de sa lenteur. On affirme parfois la même chose du baseball, mais avec un sens différent. Au baseball, on pourrait dire que le match a lieu hors du temps. Il pourrait durer trois, quatre, cinq heures à la limite, en accumulant les manches, mais il n’est pas déterminé par le temps des horloges. De ce point de vue, on peut considérer le baseball comme un sport postmoderne, excluant l’idée d’un progrès ou d’un déroulement temporel explicite. Au contraire, le football s’impose comme le jeu moderne par excellence, si on veut bien voir la réflexion sur le temps — pensons à une épistémologie des avant-gardes, où progrès et temps se montrent indissociables — comme un élément clé de la Modernité. Le football joue du temps, les équipes s’en servent, et il ne peut se comprendre si on ne mesure pas l’importance acquise par l’effet du cadran, parallèle au raffinement de plus en plus grand des stratégies. Conséquemment, contrairement au baseball, on voit, littéralement, le temps s’arrêter, de plus en plus souvent à mesure que le match approche de la fin. Cela produit parfois un effet d’exaspération, même chez le véritable amateur, gêné d’être installé depuis 212 minutes devant son téléviseur, incapable de s’arracher à quelque chose d’aussi insipide qu’un match opposant Arizona et Cleveland et se répétant qu’après tout peut-être que la vraie vie est ailleurs.
La critique semble donc recevable, mais on peut y répondre en revenant une fois de plus sur la dimension profondément sémiotique de ce qui se déroule dans la NFL. Je me permettrai une comparaison osée qui pourrait faire bondir des puristes. Mais les universitaires étant généralement des amateurs de sports, contrairement à ce que les démagogues anti-intellectuels laissent croire, les risques sont limités.
Il ne viendrait à personne l’idée de dire d’une toile de Mark Rothko qu’elle est «trop lente». C’est-à-dire d’affirmer qu’elle déçoit par manque de mouvements et «d’actions» en comparaison avec une toile comme, par exemple, La mort de Sardanapale de Delacroix. Certains le diraient peut-être. Parions que ce ne serait pas des amateurs de football. Car un match de football, comme une toile de Rothko (contrairement au hockey ou au basketball qui plaira davantage aux amateurs de Delacroix), met en scène des blocs qui semblent transiger les uns avec les autres, des masses colorées dont les contours ne sont pas nets, qui donnent l’impression de s’enfoncer les unes dans les autres, à la limite d’un choc, tout en restant à distance par la grâce de la ligne à l’attaque et de la ligne défensive. Chaque jeu est l’absorption d’un choc, le début annonce presque immédiatement la fin (puisqu’il ne dure que quelques secondes). Le football est un sport abstrait, où les visages des joueurs sont masqués, ne laissant pas de place à leurs émotions et aux sentiments. Ce qui compte d’abord ce sont des lignes, des tracés, qui croisent horizontalité — les joueurs de la ligne défensive qui tentent de frapper le demi à l’attaque ou le quart — et verticalité — le ballon qui parcourt une distance étonnante dans les airs, le receveur éloigné qui saute pour l’attraper et les joueurs de la tertiaire qui tente de l’en empêcher, tout s’abolissant, même la gravité, pour une seconde ou deux.
Cette importance de l’abstraction propre au football, aussi bien dans le langage que dans les formes que le jeu prend sur le terrain, ainsi que le rôle accordé au groupe au détriment des individus, me conduit à ma troisième remarque, dénotant la nature sociale profondément ambiguë de ce sport.
La violence du football — dont ne sont pourtant pas exempts des sports comme le hockey et le soccer, mais qui se signale sans doute là de manière moins explicite — a souvent mené à un parallèle avec la guerre. Si le baseball s’apparente à une pastorale, terme fréquemment utilisé pour le décrire, le football a été perçu comme un déplacement de la Guerre de sécession, puisque c’est au cours de cette période historique que son développement commence. Au début des années 1970, on constatait que «the five leading states in the per capita production of professional football players are all southern: Mississippi, Louisiana, Texas, Alabama and Georgia, in that order» (Oriard:7), ce qui a encouragé, même après un siècle, cette métaphorisation: le Sud se venge sur un autre terrain. La fin du XIXe siècle voit la décennie qui, de l’avis des commentateurs, est la plus violente de l’histoire du football. «The football game of the 1890s was so rough that no higher praise for soldiers could be imagined in that decade than comparison with the teamwork of a football squad»; «indeed, by 1890 the vocabularies of war and football were already impossible to separate.» (Messenger: 144 et 146)
Le premier roman connu qui décrit un match de football s’intitule Hammersmith: His Harvard Days et date de 1878 (l’auteur se nomme Mark Severance), moins de quinze ans après la victoire des Nordistes. Or, si les «romans de football» vont devenir rapidement très nombreux, un ouvrage qui déborde largement de ces frontières génériques va avoir un impact important sur la conception du sport dans l’imaginaire et se déroule justement au cours de la Guerre civile. Dans The Red Badge of Courage, Stephen Crane décrit de manière saisissante des scènes de bataille, en s’intéressant particulièrement à un groupe de jeunes volontaires. Devant la surprise de certains commentateurs face à son aisance à décrire une guerre qu’il n’avait pas connue personnellement, l’auteur répondit ainsi par la voix des journaux: «I have never been in a battle of course, and I believe that I got my sense of the rage of conflict on the football field. The psychology is the same. The opposing team is an enemy tribe.» (Messenger: 143). Le rapprochement s’éclaire lors de certaines scènes clés:
The suggestion of a football scrimmage as a Civil War skirmish is at its strongest in The Red Badge in chapter 19. Upon orders to charge, the regiment moves out from its position into a ‘‘cleared space’’, which corresponds to an open field of play. The line becomes a ‘‘wedge-shaped mass’’ resembling the powerful charge of the flying edge. The opposition is supplied by ‘‘bushes, trees, and uneven places on the ground’’ which split the command and scattered it into detached clusters, much as a football wedge was broken up by opposing players hurling themselves at it to reach the ball carrier. Finally, ‘‘the opposing infantry’s lines were defined by the gray wall.’’ (Messenger: 145)
Ce rapprochement entre football et guerre, médiatisé par la violence, traverse le temps et de nombreuses manifestations culturelles en rendent compte. On en trouve des traces notamment dans la littérature. Pour prendre un exemple spectaculaire, le roman North Dallas Forty de Peter Gent, publié en 1974, qui raconte huit jours dans la vie d’une équipe de football, exacerbe cette violence: celle, psychologique, que provoquent des entraîneurs dans le but de détruire la personnalité des joueurs pour mieux les modeler à leur guise; celle, physique, que provoque le jeu lui-même. Certaines scènes descriptives pourraient laisser croire au lecteur qu’il lit une scène de torture dans American Psycho:
The blow forced the bones the wrong way; ligaments and muscles stretched and tore. The two primary bones rode grinding over each other. For an instant the elbow dislocated, leaving a huge hole where the elbow point used to be. Somehow the remnants of the muscles and ligaments held and the bones popped back into place with a resouding snap. (cité par Oriard: 193)
Un joueur est victime d’une crise cardiaque dans Joiner en 1971, un quart-arrière meurt sur le terrain dans The Last Superbowl en 1976 et un demi à l’attaque est tué lors d’un entraînement dans That Prosser Kid (1977). Killerbowl, en 1976, plonge le lecteur dans un univers de science-fiction où les matchs ont lieux dans les rues désertes des villes et où tous les coups sont permis (voir Happe: 1995). On ne s’étonnera pas que Gary Cartwright ait intitulé un texte The Hundred Yard War à propos d’un sport qui multiplie dans son vocabulaire des termes ou des expressions comme «blitz», «shotgun», «Doomsday Defense» qui n’ont rien d’élégiaques. La guerre est partout et l’idée d’une fin apocalyptique, la mort au bout du tunnel, traverse davantage l’imaginaire des spectateurs que dans tout autre sport.
Outre la littérature, on notera qu’une bonne partie de la publicité use de cette violence. Alors qu’il y a quelques années, sur une musique de ballet, on voyait alterner au ralenti des danseurs des Ballets russes et des joueurs de basketball, exprimant explicitement la beauté et l’élégance des basketteurs, la publicité du football est souvent associée au rock le plus primaire, appuyant sur l’animalité du sport. Il faut ajouter également, parmi bien d’autres traits qu’ils seraient trop long d’énumérer, l’insistance à tabler sur la hiérarchisation de la structure d’une équipe de football pour en démontrer la dimension militaire (sans compter les matchs entre «army» et «navy», considérés comme des classiques).
La sémiotisation du jeu a ainsi une contrepartie sociale: un balisage des valeurs qui permet de voir apparaître en palimpseste des notions de discipline et de virilité dont l’armée se fait le chantre, contrebalancées par la douceur ostensible d’une vie familiale conservatrice sereine (dans quel autre sport voit-on aussi souvent des joueurs faire de la publicité, au nom de la ligue, en famille?). Tout cela finit par provoquer des effets pervers. D’une part, comme dans tous les sports, on demande aux joueurs d’être des modèles pour les jeunes. Ce qui signifie, pour le dire crûment, apprendre à se taire et à ne pas poser de jugements trop personnels laissant croire à l’ombre d’une position critique, ce qui déplaît toujours aux pouvoirs en place. Mais, d’autre part, l’incitation à souligner la dimension guerrière du jeu ne peut qu’engendrer des débordements similaires à l’extérieur des limites du terrain. L’armée fonctionne selon des rites et des codes stricts, mais souvent moins articulés aux codes sociaux que parallèles à ceux-ci. On notera à ce propos que depuis quelques années le nombre de joueurs collégiaux ayant eu des problèmes avec la justice suit une courbe ascendante (on a avancé un pourcentage aussi impressionnant que 15% à 20% des joueurs). Associé au groupe, et à cause de cela sans doute, bien des joueurs semblent croire à leur invincibilité à l’extérieur du terrain, ce qui tend paradoxalement, au bout du compte, à les isoler. Ce caractère solitaire du joueur de football, la littérature l’a également souligné. Pensons à Fitzgerald (avec le personnage de Tom Buchanan dans The Great Gatsby) ou à Faulkner (Labove dans Hamlet). «There is a major breakdown between the nominal heroism of the School Sports Hero and his embodiement of society’s values. […] They portray the hero as limited, his victories as hollow. His heroism does not allow him to gain other victories beyond the frame of sport.» (Messenger: 180)
On pourrait à partir de là s’attarder à une lecture sociologique du phénomène sportif et au statut particulier du jeune adulte dans ce contexte, qui déborderait mon propos. Les liens tissés entre football et guerre, entre équipe et communauté, me conduisent plutôt, à l’intérieur du paysage américain, à souligner dans le cadre des valeurs sociales implicites représentées, la dimension apocalyptique du jeu. Dans la Bible Belt en particulier, mais pas uniquement, l’emprise de la religion sur le football impressionne. Non seulement sont nombreuses les scènes où, au football collégial, on peut voir les joueurs prier avec les entraîneurs avant un match, mais les effets religieux contaminent le public. Il y a peu de temps, le gouvernement fédéral a dû intervenir au Texas dans une ville où, avant chaque match, la foule entière se levait en bloc pour prier1Sur le plan anecdotique, soulignons un cas bien particulier: «En 1981, un vieux monsieur distribue dans les rues de New York un bulletin intitulé The New World. On y lit que le monsieur en question se nomme Norman Bloom, et qu’il n’est autre que le messie fils de David. Norman Bloom prouve sa messianité d’une façon très particulière. Spécialiste de football américain, il entrecoupe ses longs textes kabbalistiques de prophéties concernant les futurs matchs de la saison. Si, par hasard, ses pronostics se réalisent, il y voit une nouvelle preuve de l’arrivée du messie.» (Bourseiller: 258-259). Là encore, on peut peut-être y voir un signe de l’histoire du Sud: «The emphasis on teamwork makes football perhaps the most middle class of sports; but it also has a reckless, desperate quality, and a certain grandeur, which perhaps accounts for it’s great popularity in the south now deprived of it’s blood sports.» (Oriard: 7) Si, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la brèche entre le Nord et le Sud a été comblée, la ferveur religieuse tend à cimenter davantage une communauté autour d’un sport lui-même fondé sur le groupe, dans un esprit où la hiérarchisation militaire n’est pas absente2Il faut préciser que ces remarques concernent particulièrement le football collégial. D’autant plus que plusieurs grandes équipes universitaires sont représentées dans des états très conservateurs où le match du samedi est un événement particulièrement rassembleur..
Le sport se prête admirablement à un imaginaire de la fin. Un match conduit à une fin, certes, inévitablement, mais celle-ci peut aussi se réduire à n’être qu’un point dans le temps, une seconde charnière — au football un attrapé clé, un mouvement des hanches du demi qui lui permet de se dégager et de filer vers la zone des buts — à l’intérieur d’une stratégie développée depuis plusieurs jeux qui prend soudain tout son sens, permettant de comprendre une séquence entière (les derniers éléments d’une situation, un Endtime).
Sémiotisation très forte d’un sport aux codes très marqués, nette prédominance du groupe sur l’individu3Un personnage dans End Zone ne dit-il pas: «When men vomit together, they feel joined in body and spirit. Women have no such luck.» (173). Peut-on pousser l’absurdité de cette homogénéité sociale plus loin? (ce qui n’évacue pas l’héroïsme individuel), violence associée à la guerre: cela conduit à une dramatisation d’autant plus forte que le football s’inscrit dans un contexte culturel où les tenants d’une pensée eschatologique pullulent (inutile d’insister sur le nombre des représentants de sectes millénaristes, messianistes, adventistes, survivalistes, etc., qu’on retrouve aux États-Unis bien souvent dans les stades) et où la religion est indissociable des grandes manifestations de la culture populaire. Quand on embrasse l’ensemble de ces phénomènes, la fin n’est pas seulement la fin du match, mais un signe complexe, un système de représentation, où peut intervenir une logique de l’apocalypse.
C’est ainsi que Don DeLillo et Robert Coover, selon l’interprétation que je voudrais développer maintenant, utilisent le football comme mode de narrativisation. Au lieu d’en faire un théâtre de la violence cependant, ils le transforment en symptôme social, signe d’une société au cœur d’une crise grave qui peut conduire à la logique de l’apocalypse, selon la double acception du terme: à la fois dévoilement (du grec tardif apokalusis) et catastrophe. Pour ce faire, ils déplacent l’apocalypse de l’atemporel au temporel, du religieux à l’Histoire. Du texte de l’Apocalypse de Saint-Jean, le lecteur est plutôt amené dans ces deux romans au texte social du XXe siècle, «devenu en vérité, ainsi que l’avait prévu Lénine, un siècle de guerres et de révolutions, donc un siècle fait de cette violence que l’on considère habituellement comme leur dénominateur commun.» (Arendt: 105)
Dans End Zone de Don deLillo, le football surgit, littéralement, dans un monde à part. Non seulement est-ce un univers extrêmement codé, mais il prend place dans un espace du bout du monde, un paysage qui est presque celui d’un après-monde. Gary Harkness, le narrateur, joueur talentueux, a pourtant toujours abandonné les équipes collégiales qui l’engageaient, pour des raisons diverses ayant généralement à voir avec de graves crises existentielles. Il accepte finalement de venir étudier et jouer dans un collège situé dans le désert, à l’ouest du Texas: «We were in the middle of the middle of nowhere, that terrain so flat and bare, suggestive of the end of recorded time, a splendid sense of remoteness firing my soul. It was easy to feel that back up there, where men spoke the name civilization in wistful tones, I was wanted for some terrible crime.» (30-31) Ce n’est pas le football en soi qui pousse au crime (quel que soit le sens qu’il faut ici attacher à ce mot), mais bien l’idée d’une fin, d’un aboutissement dans un décor de fin du monde, dans lequel le sport vient jouer son rôle. Ne dira-t-il pas «I liked the idea of losing myself in an obscure part of the world»? (22) À un joueur qui affirme «I wanted to disappear», un autre rétorque: «But you’re here […] We’re all here.» (26) La disparition, pourrait-on croire, a déjà eu lieu. Le lecteur se trouve dans un lieu qui a tout du purgatoire et ne doit pas se surprendre que les références à la religion et à la Bible soient si nombreuses.
De plus, on ne s’étonnera qu’à moitié que le lieu se nomme Logos College, tant ce roman se désigne, ironiquement (?), à travers le football, comme celui d’une crise du sens et même, d’une crise du signe. Dans ce contexte, on constatera sans surprise que l’instructeur en chef se nomme Creed. Dans son sens premier, le credo («creed») réfère au symbole des Apôtres, qui contient les articles fondamentaux de la foi catholique. Symbole de la foi (nécessaire pour gagner), Creed «became famous for creating order out of chaos» (10). Cet homme de la Genèse est pourtant un ange déchu, congédié du paradis footballesque après avoir brisé la mâchoire d’un joueur à la suite d’une remarque qu’il n’avait pas appréciée. Sorti de l’ombre pour diriger l’équipe du Logos College, Creed reste souvent enfermé, silencieux, son mutisme l’apparentant à un «landlocked Ahab who paced and raged, who was unfolding his life toward a single moment.» (54) Comme Achab, il semble attendre son heure, une victoire ultime où tout sera révélé. Toute proportion gardée, la dimension mystique de End Zone a une importance comparable à celle qu’on retrouve dans Moby Dick.
Ce moment déterminant, ce choc difficile à décrire et qui ne relève pas de la simple psychologie, outre Creed, chacun des principaux personnages du roman se sent concerné par lui. C’est le cas de Harkness, du joueur noir Taft Robinson, joueur exceptionnel, aussi taciturne et monomaniaque que Creed qui a réussi à l’attirer dans ce nowhere alors que toutes les grandes universités se l’arrachaient, ainsi que du joueur de ligne offensive juif Anatole Bloomberg, énorme individu que les autres ne savent comment aborder. De ces quatre hommes, on pourrait reprendre les propos de Harkness à propos de Bloomberg: «He wasn’t a Texan. One of the outcasts, I thought. Or a voluntary exile of the philosophic type.» (14)
Dès le troisième paragraphe le lecteur apprend, par antiphrase, de quoi il sera question dans ce roman, alors que Harkness médite sur le rôle du joueur de football: «His thoughts are wholesomely commonplace, his actions uncomplicated by history, enigma, holocaust or dream.» (4) Histoire, énigme, holocauste, rêve: voilà sans doute, justement, les quatre mots clés avec lesquels Harkness va se débattre. Une Histoire impossible, puisque telle qu’il la conçoit elle conduit à une fin immédiate, dans la mesure où elle ne s’imagine qu’à travers le prisme de l’explosion nucléaire; holocauste et rêve se voient liés, l’imaginaire de Harkness (comme celui de Taft) s’associant toujours à des images horribles de mort et de torture. Quant à l’énigme, elle tient justement à tous les signes qui semblent annoncer un désastre qui ne vient jamais, si ce n’est, au bout du compte un désastre intime, une «petite apocalypse» pour reprendre l’expression de Tadeusz Konwicki4C’est le titre donné en français à un de ses romans: La petite apocalypse, Paris, Robert Laffont, «Presses Pocket», 1981[1979]., lorsque dans une fausse finale, abrupte et inattendue, Harkness s’écroule physiquement et psychiquement: «In my room at five o’clock the next morning I drank half a cup of lukewarm water. It was the last food or drink I would take for many days. High fevers burned a thin straight channel through my brain. In the end they had to carry me to the infirmary and feed me through plastic tubes.» (241-242) Tout se délite et cette déshydratation de Harkness correspond à sa volonté constante d’ascétisme qui concerne aussi bien les paysages, la routine de sa vie quotidienne et, finalement, son corps (sur l’ascétisme, voir Osteen: 1990).
Dans ce roman où les symboles et les signes se multiplient, on apprend sans surprise que l’ancien recteur de l’université, figure par excellence du père et homme de raison, était muet: «He believed in reason. He was a man of reason. He cherished the very word. Unfortunately he was mute.» (7). Que la raison soit muette dans ce lieu désolé où tout semble au bord de basculer, il ne faut pas s’en étonner. Entre le Dieu suprême, entraîneur qui se tait et laisse ses assistants faire part aux joueurs de ses désirs et un recteur dominé par la raison mais muet («all he could do was grunt. He made disgusting sounds», 7), que reste-t-il du Logos? Il faut réinventer le langage, oublier ce qui a été pour espérer découvrir un nouveau paradis dans ce désert texan.
Repartir à zéro, faire table rase, a des conséquences énormes dans End Zone, où le football occupe une place centrale. Le football possède déjà un langage extrêmement codé et, dans le monde contemporain, celui de la révolution technologique, l’expression faire table rase est largement associée à l’explosion d’un champignon atomique. Le roman va se jouer entre le langage originel du football, langage de l’avant-monde, et l’explosion atomique qui conduit à un après-monde.
Lors de leur première rencontre, Bloomberg demande à Harkness qui, selon lui, doit être considéré comme le plus grand homme: Gibbon ou Archimède? La bonne réponse est Archimède. Entre l’historien qui nous explique le passé et le «scientifique» qui prépare l’humanité aux développements technologiques, entre l’homme du lien et celui de l’expérience, le choix ne se discute pas. «You have to balance history with science fiction» affirme péremptoirement à Harkness une de ses amies, «It’s the only way to keep sane.» (67-68) Bloomberg ira plus loin en affirmant à Harkness que «history is guilt» et pour cela il faut la passer à la trappe. Il veut oublier l’histoire parce qu’il est juif.
En effet: la disparition de l’histoire ne se dissocie pas du langage, qui lui aussi s’évapore: subject, predicate, object. Il faut recommencer ailleurs, autrement, sans l’histoire, avec un autre langage. «I’ve never seen a good football player who wanted to learn a foreign language» (199), affirme Creed. On le comprend: pour lui, le langage du football s’apparente à un esperanto, une langue absolue. Il y a bien un joueur qui apprend les poèmes de Rilke par cœur, mais sans comprendre un seul mot d’allemand («Billy was in the process of memorizing Rilke’s ninth Duino Elegy in German, a language he did not understand. It was for a course he was taking in the untellable», 64). Il s’agit d’un pur psitacisme et l’honneur est sauf.
Gary Harkness, lui, apprend un nouveau mot chaque jour. Il réapprend également ceux qu’il connaît, les utilise comme de véritables mantras: désert, soleil, ciel, pierre. Mais cette fascination pour les mots, qui suppose de repenser et de revoir autrement le monde, a des implications radicales chez quelqu’un attiré par le gouffre. Comme le suggérait Nietzsche, «quand on lutte contre des monstres, il faut prendre garde de ne pas devenir monstre soi-même. Si tu plonges longuement ton regard dans l’abîme, l’abîme finit par ancrer son regard en toi.» (Nietzsche: 129) Cet abîme catastrophique, Harkness n’y échappe pas, totalement absorbé par l’idée de la guerre nucléaire, qui pour lui est d’abord une guerre du langage:
It started with a book, an immense volume about that possibilities of nuclear war — assigned reading for a course I was taking in modes of disaster technology. The problem was simple and terrible: I enjoyed the book. I liked reading about the deaths of tens of millions of people. I liked dwelling on the destruction of great cities. Five to twenty million dead. Fifty to a hundred million dead. Ninety percent population loss. Seattle wiped out by mistake. Moscow demolished. […] Carbon 14 and strontium 90. Titan, Spartan, Poseidon. […] I became fascinated by words and phrases like thermal hurricane, overkill, circular error probability, post-attack environment, stark deterrence, dose-rate contours, kill-ratio, spasm war. Pleasure in these words. They were extremely effective, I thought, whispering shyly of cycles of destruction so great that the language of past world wars became laughable, the wars themselves somewhat naive. (20-21)
La fascination provoquée par la guerre implique des mots. Des mots d’autant plus surprenants qu’ils semblent sans commune mesure avec ce qu’ils peuvent faire subir. Taft Robinson vit la même expérience en lisant des livres sur des horreurs infligées à des enfants. À Harkness qui lui affirme ne pouvoir supporter l’idée d’enfants torturés ou tués, Robinson ne peut qu’acquiescer: «It’s the worst thing there is. I can’t bear it. But I’ve read maybe eight books on it so far. […] It’s horrible. I don’t know why I keep reading that stuff.» (241) Impossible de ne pas regarder l’abîme, de ne pas s’abîmer dans ces mots inconcevables. L’autodestruction d’Harkness à la fin du roman est une conséquence normale du pouvoir des mots destructeurs qui l’obsèdent. Dans sa correspondance, Wittgenstein écrivait: «Tout ce à quoi je tendais […] c’était d’affronter les bornes du langage. Cet assaut contre les murs de notre cage est parfaitement, absolument sans espoir.» (cité par Chauviré: 253) Harkness doit faire face lui aussi aux limites du langage, mais dans un monde technologique où l’idée de la destruction totale lui rende ces mots insoutenables. Imaginer leur possibilité concrète, c’est justement imaginer leur disparition. S’ils «agissent», ils ne pourront plus exister. Utiliser l’armement atomique constitue la meilleure manière d’être certain qu’il ne servira plus.
La partie d’échecs «apocalyptique» qui s’est engagée entre les superpuissances, c’est-à-dire entre celles qui évoluent au niveau le plus élevé de notre civilisation, respecte la règle selon laquelle «si l’un ou l’autre ‘‘gagne’’, c’est la fin des deux»; il s’agit là d’un jeu qui est totalement différent des jeux guerriers des précédentes périodes. […] Comment pourrons-nous échapper en fin de compte à l’évidente absurdité de cette situation, voilà une question à laquelle il est impossible de répondre. (Arendt: 105-106)
Rien d’étonnant à ce que le major Staley, de qui Harkness suit un cours, affirme que les idéologies, contrairement à ce que les gens croient, n’ont plus aucune importance. Ce militaire de l’armée américaine va même jusqu’à dire que la haine des Soviétiques est la démonstration de «the grotesque sense of patriotism at work in this country. Today we can say that war is a test of opposing technologies.» (84) Les gens ont inventé les idéologies, selon Staley, pour oublier que la mort, grâce à la technologie, n’a pas de frontières. «War brings out the best in technology.» (85)
En toute logique, dans cet esprit, «The bombs are a kind of god» (80), puisqu’elles sont début et fin de toute chose. N’est-ce pas le toujours sagace Bloomberg qui affirme que religion et histoire ne peuvent conduire qu’à la guerre? «They result in war and insanity, war and insanity, war and insanity» (77): la guerre et la démence, la destruction et la perte de sens. C’est au cœur de ces mots que se débat Harkness, personnage trop complexe pour le major Staley. Ce dernier lui suggère d’entrer dans l’armée, son intelligence, selon lui, y trouvant naturellement sa place. Mais l’étudiant doit laborieusement lui expliquer que seule la théorie l’intéresse. Ce sont les mots qui comptent: «Major, there’s no way to express thirty million dead. No words. So certain men are recruited to reinvented the language.» (85) Ils se contenteront de se retrouver autour d’un jeu de société qui simule la guerre. Mais même là, Gary Harkness ne se sent pas à l’aise: «I was hardly a competent enemy. I had no experience in this sort of thing. I had been plagued by joyous visions of apocalypse but I was not at all familiar with the professional manipulations, both diplomatic and military, which might normally precede any kind of large-scale destruction.» (223) Il s’agit d’un langage intermédiaire qui lui est inconnu, langage de l’argumentation, de la dialectique, du développement discursif. Harkness ne connaît que la parataxe. Son vocabulaire se limite aux mots d’une souffrance trop profonde pour se traduire et se définir ou encore aux mots tellement fondamentaux qu’ils se vivent plus qu’ils ne se disent. Les mots qui naissent du début ou de la fin.
Pour Harkness, l’histoire s’arrête, comme le temps: suspendu à quelque chose d’impalpable, d’indicible, un moment de révélation, une crise, une chute, une fin. L’originalité du roman de DeLillo est de situer ce passage clé non pas à la fin de End Zone, mais plutôt en plein centre.
À la surprise de tous, l’équipe de Logos College, menée par Taft Robinson, commence sa saison en lion et ne subit aucune défaite pendant plusieurs semaines. Mais jouant dans une ligue assez faible, sa renommée ne pourra s’étendre que si elle parvient à vaincre la seule équipe de haut niveau de la ligue, Centrex. La deuxième partie du roman est entièrement consacrée à la description minutieuse du match contre ces rivaux, que Logos College finira par perdre.
Tout commence par l’énoncé d’une affirmation d’un instructeur qui pourrait ressembler, encore une fois, à une antiphrase: «I reject the notion of football as warfare. Warfare is warfare. We don’t need substitutes because we’ve got the real thing.» (111) La tautologie est le signe que le langage se suffit à lui-même: warfare is warfare. Le sport est l’exact contraire du désordre de la guerre: «The exemplary spectator is the person who understands that sport is a benign illusion, the illusion is order is possible.» (111-112). L’ordre apparaît ici dans un épouvantable chaos, d’où le sens ne se manifeste jamais clairement. Le lecteur a droit à une description détaillée du match, mais à travers un langage qui lui échappe largement. Le code extrêmement crypté du play-by-play s’amalgame aux éructations des joueurs, aux insultes, véritables cris de guerre adressés à l’adversaire qui semblent presque aussi codés.
Since we are not players, the play signals become an impenetrable language comparable to the jargon of nuclear strategy. In giving his play-by-play account, the narrator vows to ‘‘unbox the lexicon’’ of football for all eyes to see […] This implies that […] words themselves are the primary weapons in both nuclear strategy and football; football jargon, like that of nuclear strategy, is a destructive implement that ‘‘cleanses’’ the landscape of complexity and choice. (Osteen: 156).
Ce rapport s’impose d’autant plus, comme le remarque Osteen, que le match oppose théologie (Logos) et technologie (Centrex). Nous sommes, littéralement, en pleine Apocalypse, aux deux sens du terme (catastrophe, mais aussi dévoilement). Les deux acceptions se répondent et se rejoignent dans l’idée d’une épreuve qu’il faut traverser. Comme l’Apocalypse de Saint Jean, le texte offre ici, à travers le langage du football, un ensemble de signes codés et chiffrés dont il faut interpréter le sens.
Ce qui anime l’apocalypse, c’est l’idée de perfection des commencements, le souvenir imaginaire d’un paradis perdu. En assurant le renouvellement cosmique, l’apocalypse apporte l’espoir d’une récupération de la béatitude des commencements, nouant la fin et le début, rejoignant l’idée d’infini. Or, comme l’indique Thomas Leclair:
The player’s response to the message should be automatic; there is no debate, no communication loop in the signal language. There are, of course, errors, the opposition’s counter signals, and interfering noise; but the play name has a univocal meaning and authoritarian effect, the qualities of logos, The Word before the Tower of Babel. This is why, for Creed in his new tower, football is ‘‘the only game.’’ (Leclair: 115)
Ce match symbolise la chute, la fin de la pureté (la fin du rêve d’une saison parfaite) et le passage de l’autre côté du miroir, en enfer, où il faut payer pour ses péchés. Rien d’étonnant à ce que la seconde partie se termine par une formule sibylline: «Hauptfuhrer was standing over us. ‘‘Shut up and pray,’’ he said.» (142) Hauptfuhrer est l’entraîneur responsable de la ligne défensive. Cette figure du chef, du père, associée à un terme allemand qui renvoie le football du côté de la guerre, de la plus impitoyable, celle de l’Holocauste, signale assez bien le début d’un séjour en enfer. À travers Hauptführer, c’est Creed, pourrait-on croire, qui s’exprime. Creed chassant ses joueurs du Paradis ou encore une figure tutélaire, au-dessus de lui, abandonnant ses ouailles et le chassant en même temps que ses joueurs. Si le football n’était pas le warfare, voilà que les joueurs y sont renvoyés, du côté de l’autre Apocalypse, atomique celle-là, l’enfer possible sur Terre. «They found bodies naked except for shoes. That was heat that did that, not fire. Heat disintegrated the clothes. They found bodies shrunken, dry as paper. That was intense heat.» (81) C’est de ce côté du miroir que Harkness se sent dorénavant.
Si on veut bien considérer la Deuxième Guerre mondiale comme une rupture épistémologique fondamentale au XXe siècle, notamment à cause de l’explosion des deux bombes atomiques, on pourrait dire que le roman de DeLillo se situe dans l’après-histoire, dans un univers postmoderne, où tout est en attente, l’Histoire arrêtée, au sens où l’exprime Hannah Arendt dans le passage que je citais plus haut. Au contraire, Robert Coover, avec Whatever Happened to Gloomy Gus of the Chicago Bears?, se situe avant la chute, alors que tous les espoirs sont permis.
Le roman se déroule dans les années trente, un mois après le massacre de Guernica, au milieu d’une guerre d’Espagne dont il sera beaucoup question. Le narrateur Meyer et ses amis, marxistes et syndicalistes, sont sans cesse en butte aux policiers, le groupe infiltré par des indicateurs. Au milieu de ces «rouges» va atterrir un jour Gloomy Gus qui finira assassiné dans une manifestation après s’être précipité vers un policier sans qu’on ne sache pourquoi («Poor old Gus was the eleventh fatality from Sunday’s confrontation down at Republic Steel», 11). Meyer racontera la vie de cet homme qui pouvait tout faire sauf deux choses: jouer au football décemment et draguer avec un minimum de réussite. Il décidera donc de se consacrer entièrement à ces deux activités, avec une constance et une volonté confinant à la bêtise. Puisque l’Histoire est présente tout au long de ce roman, il faut préciser qu’en filigrane une époque plus récente se superpose aux années trente. En effet, Gloomy Gus, qui au football universitaire massacre à lui seul les équipes de Washington et Jefferson, est une caricature acide de Richard Nixon, celui-là même qui affirma jadis qu’avec suffisamment de temps il pourrait devenir le meilleur dans n’importe quelle discipline (voir Chassay: 76).
Obsessif, Gloomy Gus se transforme en aliéné absolu, «a mirror image of the insane nation that created him.» (83) Il devient le meilleur (aussi bien au football que pour draguer les filles), mais la multiplication continuelle de nouveaux codes, d’appel de jeux de plus en plus complexes et de nuances fines de l’amour finissent par faire craquer cette mécanique bien huilée.
He learned how — each in separate drills — to tackle and block, swear vehemently, break out of a huddle, cradle a ball, throw it and catch it and inflate it, how to squeeze hands, caress them, gaze deeply, joke casually, wink, blow loose wisps of hair back, ask for a phone number, stand tall, and even foxtrot a bit. Not without paying a price, of course. Something had to go to make room for all of this. (107)
La sémiotisation du monde est telle que Gloomy Gus ne peut plus rien contrôler à force de devoir trop en contrôler. Entre les signes et le réel, la connivence est rompue. Dès lors, dans le meilleur des cas, il court les mauvais tracés ou provoque sans cesse des hors-jeux. Dans les pires cas, il plaque les filles au sol et se sauve avec leur porte-feuille dans une zone des buts imaginaires — quand il entend le chiffre «29», qui lui rappelle un jeu, il s’empresse de jeter au sol la personne la plus près de lui5Mais «29» est aussi, bien sûr, l’année où éclate la crise économique qui précipite le chaos politique des années trente qui va conduire à la Deuxième Guerre. —, jouit lorsqu’il est arrêté sur le terrain en hurlant des mots d’amour, etc. Son langage se détraque également, devient incohérent «and like with Humpty-Dumpty, there’s no way to put it back together again.» (142-143). Les signes sont confus, perdus, et le langage en morceaux. Sans conscience et sans mémoire, Gloomy Gus devient le modèle de l’Américain sans substance, porté par des discours propagandistes et des règles auxquelles il adhère sans s’interroger sur leur bien-fondé. «Gus not only lacked political awareness, he lacked awareness of any kind. He had no core at all. Unless pure willpower has some kind of substance, amounts to some kind of character.» (43) Gloomy Gus est l’antithèse de Gary Harkness. End Zone s’énonce à la première personne, comme le roman de Coover, mais dans ce dernier cas la parole n’est pas donnée au joueur lui-même. Le personnage sur lequel le récit repose est un vide qui sans cesse se refait. Gus est une éponge qui absorbe tous les discours et veut les traduire en rôle (Gus, comme Nixon, a fait du théâtre). La machine déraille quand ce Zelig se met à jouer tous les rôles en même temps.
«He was a walking parody of Marx’s definition of consciousness, a cartoon image of the Social Product» (83) affirme un personnage. Cette vivante parodie de Marx n’est-elle pas un personnage terriblement hégélien, en vérité? Fascinante caricature de la fin de l’Histoire, Gloomy Gus s’impose comme la machine footballistique absolue, l’atteinte de la perfection, l’aboli bibelot de divertissements sonores tel qu’en lui-même l’éternité de la renommée sportive le change. Mais voilà, la fin de l’Histoire s’avère une erreur, nous sommes plutôt plongés dans un éternel retour comme affirmait un philosophe qui n’avait vraiment rien d’hégélien. Le mouvement est partout, irrépressible, mais chaotique. La machine capitaliste devient totalement irrationnelle et se déglingue, comme le joueur de football. La comparaison est d’autant plus ironique lorsqu’on voit en palimpseste de Gloomy Gus la figure de Nixon, icône du rêve américain dans la plus pure tradition républicaine. «“I believe in the American dream’’ [Gus] once said, ‘‘because I have seen it come true in my own life’’» (27), reprenant telle quelle une affirmation déjà énoncée par Nixon lui-même.
Le narrateur Meyer, de son côté, est sculpteur. Pendant que Gloomy Gus s’agite de toutes les manières possibles et imaginables, il prépare une œuvre monumentale en hommage à Gorki qu’il admire. Il épure, crée des formes en utilisant la soudure qui lui permet de faire tenir ensemble un monde, alors qu’autour de lui tout s’écroule, que le chaos s’installe et que les nouvelles des événements en Espagne laissent croire que le pire est à venir. Avec l’art, Meyer invite ses amis, qui trouvent souvent qu’il s’agit d’une activité inutile, à prendre le temps d’admirer et de réfléchir.
Meyer s’oppose à Gus d’une foule de manière: l’un épure, l’autre accumule (les différents jeux, les stratégies, aussi bien que les positions en amour). Mais l’un et l’autre sont malgré tout complémentaires, comme l’affirme Meyer lui-même, revenant sur leurs jeunesses respectives.
Both of us were ranging far from home, fulfilling myths about ourselves, his the rags-to-riches drama of the industrious American boy, mine the curse of the Wandering Jew. And we were both — captives of alienating systems — divided within ourselves. ‘‘To subdivide a man,’’ Marx has said, ‘‘is to execute him if he deserves the sentence, to assassinate him if he does not.’’ 6Dans The Public Burning, autre roman de Robert Coover qui porte sur l’affaire Rosenberg, Nixon est encore une fois — dans ce cas, sans masque — un personnage central et évoque les rapprochements possibles entre lui et Julius Rosenberg, soulignant que leurs vies auraient pu à une certaine époque s’interchanger. Chez Coover, Nixon apparaît bel et bien comme le versant négatif du rêve américain. (122-123)
Cette division, Meyer la sent et Gus la vit, dans la mesure où pour eux l’histoire américaine est coercitive. Le premier se sent coincé, véritable être problématique (pour reprendre l’expression de Lukàcs), pris dans un système qu’il rejette, mais dans un pays où se trouve l’essentiel de ses attaches. À cette double-contrainte répond l’auto-destruction du second pour qui seule la victoire compte et, pour cette raison, s’enfonce dans ce système jusqu’au bout, jusqu’à la démence et à la mort, incapable de remettre en question les principes qu’on lui a inculqués et qu’il ne sait adapter aux circonstances.
Meyer, bien qu’obsédé par le combat en faveur du socialisme, aime le sport. Il sculpte d’ailleurs souvent des athlètes, ce que lui reprochent parfois ses amis. Selon eux, le sport convoque le pire des travers de la politique américaine, et particulièrement le football:
The exploitation of players, manipulation of followers, the brutality and competitiveness of the game, the record-keeping mania and personality cults, even the hokum reenactment and reinforcement of the rags-to-riches mythology. Bigtime football especially enrages them. They hate the raw, naked agression, the implicit imperialism in the battle for yardage, the dehumanizing uniforms and training schedules, the lionization of the bully, and the celebration of violence as a way of discovering the self. (89-90)
Autant de critiques qui pourraient convenir à Gloomy Gus, signifiant vide du rêve américain, fanatique et sans conscience. Mais ce n’est pas ainsi que Meyer voit la chose, lui qui rapproche pourtant explicitement son travail artistique de la mécanique de Gus, soulignant un autre point de convergence: «Now I let what I’ve just seen pass again in slow motion before my inner eye (the one I do all my sculpting with — everything goes in there, but not everything stays, and reason has nothing to do with it; it’s a lot like Gus’s gearbox, now that I think about it)» (86) Malgré ses intérêts politiques, il pense le sport d’un point de vue artistique, ce qui le conduit à porter sur celui-ci un regard plus subtil:
Oddly, nobody ever complains about the jugglers and dancers, which belong to the same set of images: bodies in motion, for me the central thing about life.[…] I feel that athletes, less likely to rigidify into archetypal positions than, say, workers or warriors, leave me more room to swing. […] I prefer the greater dynamism of the ballplayers, the outflung limbs, the twisted torsos, the seeming defiance of gravity and the collision of forces: they all seem actually to move, because without the logic of motion they make no sense. And football is not about violence or atavistic impulses, like Harry says, it’s about balance. The line of scrimmage is a fulcrum, not a frontier, the important elements of football being speed and weight. The struggle is not for property, it’ for a sudden burst of freedom. And the beauty of that. In football, as in politics, the goal, ultimately, is not ethical but aesthetic. (91-92)
Le jeu révèle une double-contrainte fondamentale de l’existence. Il n’existe pas sans règles, généralement très strictes, qui sont l’envers même de la liberté. Et pourtant, plus on suit avec une précision maniaque ces règles, plus on a de chances d’aspirer à la liberté du jeu. L’éclatement de la liberté dont parle l’artiste Meyer est lié à l’esthétique du sport. Cette esthétique, il la retrouve dans la politique, puisqu’elle se mesure à l’Histoire et que cette dernière est une narration dont on invente en partie les modalités. De Paul Veyne à Hayden White, de Michel Foucault à Dominick LaCapra, la pensée des dernières décennies en sciences humaines a insisté sur la part de fiction de l’Histoire, qui n’existe pas sans relecture et sans une interprétation qui relève pour une part de la subjectivité. Comment accepter que l’Histoire soit fiction quand, comme chez Gloomy Gus/Richard Nixon, on considère que le rêve américain est bien ancré dans une réalité américaine qui est celle d’un progrès invincible? Comment accepter sa part de fiction quand le matérialisme dialectique nous indique la voie, au point d’affirmer, comme c’est le cas d’un ami de Meyer, «All that’s just fiction, brother, and fiction is the worst enemy we got!» (20) «Personne ne songe à ‘‘refuser l’histoire’’. La seule question est de savoir si on parviendra à s’en faire une conception dégrisée, après le crépuscule de l’idole hégélienne.» (Descombes: 131) Mais voilà, le crépuscule des dieux n’est pas encore à l’ordre du jour dans les années trente, sauf peut-être pour les artistes amateurs de sports, peut-être davantage conscient que d’autres de la fragilité de l’Histoire: «can history be erased? Yes, yes, it always is, in fact that’s the first thing that happens to it…» (93) Les stratégies politiques sont plus biscornue que les stratégies footballistiques, et les populations l’apprendront lors du pacte germano-soviétique; quant à l’Histoire elle est fragile, le monde l’apprendra avec le début de la Deuxième Guerre, qui conduira à l’Apocalypse que représente la Shoah et la bombe. Meyer sera peut-être moins surpris que bon nombre de ses amis et de ses ennemis.
Le match se termine et, aussi serré qu’il ait été, les perdants ont toujours torts, croit-on généralement. C’est pourtant ce point de vue unique des vainqueurs que la Nouvelle Histoire a remis en question au cours du dernier quart de siècle. Dans la fiction, les vaincus sont les vrais gagnants, dans la mesure où sur eux se concentrent toutes les tensions du récit. Harkness est écrasé par le poids de l’Histoire et Gloomy Gus détruit par celle-ci, en toute inconscience. La guerre a eu lieu, a lieu, aura lieu. Mais pas toujours sur le terrain qu’on croit. Celui du football est maintenant évacué et l’Histoire continue, même si ce n’est pas en ligne droite. Comme disait un philosophe qui n’avait sans doute lu ni Hegel ni Nietzsche, it’s not over until it’s over.
*
Cet article a d’abord été publié en tant que chapitre dans l’ouvrage Dérives de la fin: sciences, corps & villes de Jean-François Chassay (Le Quartanier), en 2008.
Bibliographie
Arendt, Hannah. 1972. Du mensonge à la violence. Paris: Calmann-Lévy, «Presses Pocket».
Bourseiller, Christophe. 1993. Les faux Messies. Paris: Fayard.
Chassay, Jean-François. 1996. Robert Coover. L’écriture contre les mythes. Paris: Belin.
Chauviré, Christiane. 1989. Ludwig Wittgenstein. Paris: Seuil, «Les contemporains».
Coover, Robert. 1987. Whatever Happened to Gloomy Gus of the Chicago Bears?. New York: Collier Fiction.
DeLillo, Don. 1972. End Zone. New York: Penguin Books.
Descombes, Vincent. 1984. Le Même et l’Autre. Paris: Minuit.
Happe, François. 1995. «Fiction vs Power: the Postmodern American Sports Novel», dans Theo D’haen (dir.), Narrative Turns and Minor Genres in Postmodernism. Amsterdam: Rodopi.
Leclair, Tom. 1987. «Deconstructing the Logos: Don DeLillo’s “End Zone”». Modern Fiction Studies, vol. 33, 1.
Messenger, Christian. 1981. Sport and Spirit of Play in American Fiction: Hawthorne to Faulkner. New York: Columbia University Press.
Nietzsche, Friedrich. 1973. Par-delà le bien et le mal. Paris: UGE, «10/18».
Oriard, Michael. 1982. Dreaming Heroes: American Sports Fiction 1868-1980. Chicago: Nelson-Hall.
Osteen, Mark. 1990. «Against the End: Ascetism and Apocalypse in Don DeLillo’s “End Zone”». Papers on Language and Literature, vol. 26.
- 1Sur le plan anecdotique, soulignons un cas bien particulier: «En 1981, un vieux monsieur distribue dans les rues de New York un bulletin intitulé The New World. On y lit que le monsieur en question se nomme Norman Bloom, et qu’il n’est autre que le messie fils de David. Norman Bloom prouve sa messianité d’une façon très particulière. Spécialiste de football américain, il entrecoupe ses longs textes kabbalistiques de prophéties concernant les futurs matchs de la saison. Si, par hasard, ses pronostics se réalisent, il y voit une nouvelle preuve de l’arrivée du messie.» (Bourseiller: 258-259)
- 2Il faut préciser que ces remarques concernent particulièrement le football collégial. D’autant plus que plusieurs grandes équipes universitaires sont représentées dans des états très conservateurs où le match du samedi est un événement particulièrement rassembleur.
- 3Un personnage dans End Zone ne dit-il pas: «When men vomit together, they feel joined in body and spirit. Women have no such luck.» (173). Peut-on pousser l’absurdité de cette homogénéité sociale plus loin?
- 4C’est le titre donné en français à un de ses romans: La petite apocalypse, Paris, Robert Laffont, «Presses Pocket», 1981[1979].
- 5Mais «29» est aussi, bien sûr, l’année où éclate la crise économique qui précipite le chaos politique des années trente qui va conduire à la Deuxième Guerre.
- 6Dans The Public Burning, autre roman de Robert Coover qui porte sur l’affaire Rosenberg, Nixon est encore une fois — dans ce cas, sans masque — un personnage central et évoque les rapprochements possibles entre lui et Julius Rosenberg, soulignant que leurs vies auraient pu à une certaine époque s’interchanger. Chez Coover, Nixon apparaît bel et bien comme le versant négatif du rêve américain.
