Entrée de carnet
Entretien avec Daniel Grenier. Malgré tout on rit à Salon Double
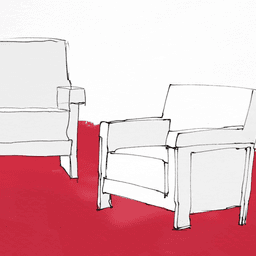
Daniel Grenier est né à Brossard en 1980. Après avoir vécu quelques années dans Villeray, il s’installe à Saint-Henri, qu’il explore depuis dans ses textes. Doctorant à l’UQAM, il prépare une thèse en études littéraires sur les figures du romancier dans la fiction américaine du XIXe et du XXe siècles. Malgré tout on rit à Saint-Henri est son premier livre. Il passe aujourd’hui au salon pour en discuter avec Simon Brousseau.
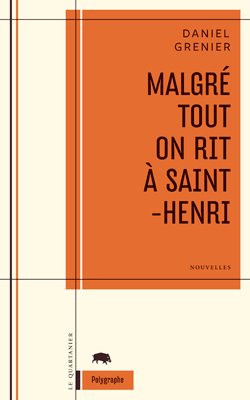
Simon Brousseau [SB] — En ouvrant ton livre, on est évidemment en droit de s’attendre à des histoires qui révèlent un lieu avec ses teintes propres, ses ambiances, ses habitants. Et pourtant, ce qu’on découvre, c’est peut-être davantage un rapport bien particulier au réel et à l’écriture, Saint-Henri et les gens qui y vivent devenant le contexte permettant un discours sur le monde. Il y a une circulation entre l’intérieur et l’extérieur, entre le local et l’universel, entre le microévénement et la marche du monde dans ce livre, et la citation de Jacques Godbout qui se trouve en exergue invite à le lire en scrutant ces relations: «Saint-Henri des tanneries ressemble plus à d’autres quartiers qu’à lui-même.» Avant de discuter du recueil, pourrais-tu nous dire quelques mots sur Saint-Henri? Pourquoi ce quartier en particulier?
Daniel Grenier [DG] — La citation de Jacques Godbout que j’ai choisie pour ouvrir le livre est en effet très révélatrice de ce que j’ai essayé de faire (ou plutôt de ne pas faire). Elle provient du film de l’ONF À Saint-Henri le cinq septembre, qui a été tourné en 1962. Dans ce très beau film, le quartier apparaît à la fois comme quelque chose que l’on tente de saisir, de résumer d’une manière «sociologique» ou «anthropologique», et quelque chose d’insaisissable, justement, qui nous échappe, qui résiste à la définition. À la fin, Godbout, qui signe la narration, prononce cette phrase qui m’a beaucoup marqué et qui m’a accompagné lors de l’écriture du recueil. N’étant ni historien, ni sociologue, je n’avais pas la prétention de mettre en scène un Saint-Henri réaliste, bien délimité, dans lequel on aurait retrouvé, par exemple, un personnage typique des différentes classes sociales du quartier, ou encore une série de récits bien informés par l’histoire architecturale des lieux. Ceux qui ont essayé de faire ça se sont souvent frappés à un mur: quand on essaie d’être trop «vrai», de dire la «vérité» sur un lieu ou sur une communauté, on tombe dans le piège de la caractérisation et du discours réducteur. Saint-Henri agit ici, comme tu dis, plus comme un prétexte et un contexte afin de stimuler mon imagination de conteur. Le quartier devient un espace assez flou à l’intérieur duquel j’invite le lecteur à se promener. On y rencontre plein de gens, certes, mais qui pourraient vivre n’importe où, au fond. Le livre fonctionne un peu sur le mode de l’incursion et de l’excursion: à partir d’un endroit précis qui existe dans le réel, on s’infiltre dans la tête de personnages qui y habitent, mais on se permet aussi d’en sortir pour aller ailleurs.
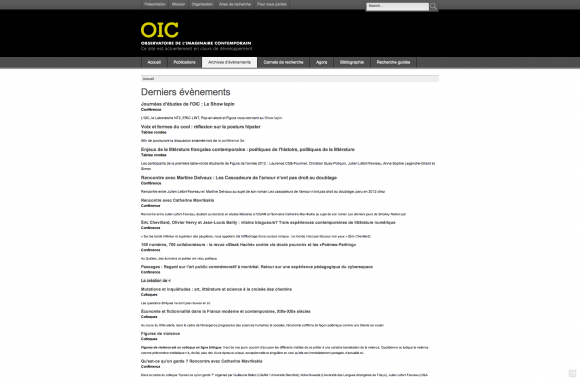
J’ai toujours ressenti le besoin d’ancrer mes histoires dans des endroits précis, plus par réflexe que par réflexion profonde. Je crois que j’aime créer des effets de réel, donner des indications qui donnent une ambiance au récit. Ça ne leur enlève pas leur «universalité», mais ça me donne l’impression qu’ils sont plus «terre-à-terre», et ça me rassure, d’une certaine façon. Le quartier Saint-Henri, c’est d’abord l’endroit où j’habite, l’endroit où j’ai choisi de rester, l’endroit où je construis mon identité depuis quelques années, et par le fait même il a une influence très grande sur mon écriture, car c’est à travers ce lieu que je vis mon expérience montréalaise. Quand on est un enfant de la rive sud comme moi, la ville représente souvent un fantasme, une sorte de lieu magique où on pourra enfin s’épanouir, un lieu sans limites. Et c’est quand on y emménage qu’on s’aperçoit que la ville est bien trop grande, justement, qu’elle ne se laisse pas apprivoiser si facilement. Ainsi, d’une certaine manière, le quartier où on s’installe, c’est une porte d’entrée à échelle humaine. Personnellement, j’aime mon quartier pour les mêmes raisons que tout le monde, ses commerces, son ambiance générale, ses habitants, sa diversité, etc. Si je ressens le besoin d’en parler, c’est parce qu’il m’inspire des histoires, bien sûr, mais c’est aussi parce que c’est l’endroit où j’invente ces histoires. Et on s’entend aussi pour dire que Saint-Henri c’est quand même le meilleur quartier à Montréal.
[SB] — Je trouve intéressant de te lire à propos de la tentation du réalisme sociologique, de ce piège qui consisterait à affirmer la nature d’un lieu de façon figée, parce que j’ai cru apercevoir dans ton livre, en sous-texte, une discussion, ou plutôt une prise de position face au réalisme littéraire. Je résumerais cette impression comme suit: dans Malgré tout on rit à Saint-Henri, il y a une volonté de rendre indistincte la frontière entre le prosaïque et le poétique. C’est-à-dire que tout en manifestant une attention soutenue aux détails les plus anodins, ce qui représente normalement une technique efficace pour parvenir à ces effets de réel dont tu parles, ton traitement de ceux-ci est si exacerbé, il occupe une place si importante dans le mouvement du récit qu’on a plutôt affaire à une forme de réalisme paranoïaque où tout, absolument tout peut être interprété comme un signe. Il me semble qu’il s’agit d’une tension fondamentale dans ton écriture, ce point de rupture où l’attention portée au réel fait basculer celui-ci dans l’écriture, dans les mots, dans la texture des mots. Dans Le danseur, le personnage interprète la goutte de sueur qui lui tombe dans l’œil comme étant un présage, l’un des rouages de la «mécanique de la réalité». De la même façon, les portes qui refusent de fermer font pressentir, dans Peine perdue, la fin d’une relation amoureuse. Dans Quatre et demie sur du Couvent, le personnage principal se perd dans ses délires spéculatifs lorsqu’il se retrouve devant la bibliothèque de Bédard, l’ancien locataire. Au final, on a l’impression que dans l’univers de tes personnages, la réalité cède le pas à l’imagination, celle-ci structurant celle-là. D’où te vient cette fascination pour les détails? Pourquoi leur accordes-tu tant d’importance?
[DG] — Je n’irais peut-être pas jusqu’à parler d’une «prise de position» par rapport au réalisme, mais je trouve ta lecture tout à fait intéressante. C’est vrai que dans le recueil, il y a une obsession des mots, chez les personnages et aussi dans la narration, qui rend poreuse la frontière entre le réel et le langage qu’on possède pour le décrire. Plus souvent qu’autrement, ils ont une influence directe l’un sur l’autre à l’intérieur des textes et les mots, leur poids, leur force, peuvent effectivement faire basculer le cours d’un récit. J’aime l’idée que, d’une certaine façon, il reste une ambiguïté fondamentale sur ce qui se passe dans une nouvelle à cause de la façon dont elle est racontée. Je travaille sans aucun doute mes textes dans cette optique. Ça peut aller, comme tu le mentionnes dans le cas du signe, d’une goutte de sueur interprétée comme le centre d’une cible par un danseur qui devient ensuite le centre d’un cercle, jusqu’à une série de phrases qu’il est impossible d’attribuer correctement à un personnage ou à un autre. Évidemment, ce qui est fascinant avec l’écriture, c’est qu’à partir d’un point impossible à discerner, les réseaux de sens se construisent d’eux-mêmes, et l’auteur ne contrôle plus totalement ce qu’il fait. Encore une fois, quand on veut trop contrôler, on se perd et ça devient lourd, surchargé. Je suis persuadé que tu vois plein de choses que je n’ai pas consciemment désirées ainsi, mais qui y sont, d’une manière indéniable: le langage métaphorique, les échos structurels, les canalisations sémiotiques, tout ça se place et, comment dire, s’autogénère d’une manière qui ne cesse de m’étonner. L’attention portée aux détails fonctionne peut-être un peu de la même façon, dans la mesure où à partir d’un certain moment, mon simple jugement conscient ne suffit plus: quelque chose survient qui est d’un autre ordre. J’observe ce qui m’entoure, et bien sûr je me targue d’avoir une certaine capacité à bien saisir les petites choses qui pourraient sembler négligeables, voire impertinentes, une sorte de sensibilité drolatique qui viendrait définir mon écriture et lui donner une touche personnelle, mais j’insiste sur le fait qu’il y a un moment où ça m’échappe, où les détails existent sans nécessairement avoir été pensés. Ceci dit, pour éviter de tomber dans l’ésotérique, il reste que je m’efforce souvent d’atteindre non pas la précision du détail, mais plutôt un angle inédit, pour susciter l’intérêt du lecteur, ou le déstabiliser.
[SB] — En effet, ce n’est pas tout que de souligner ton intérêt pour les détails et les hasards. Il y a aussi dans ton livre un penchant assumé pour l’oralité, et tu débusques souvent des usages courants qui sont hilarants, tant le ton est juste. Il y a des passages où tu malmènes franchement la syntaxe, et plus généralement le bon usage de la langue: «J’avais rien à faire l’autre soir, j’étais tanné de checker des petits clips pornos comme trop hardcore sur YouPorn, faque je me suis ramassé au Black Jack. J’ai passé la soirée dans un coin, à convaincre un gars que j’avais un Rhodes à lui vendre, 1971, en parfait état, mille sept cents piasses, qu’y fallait que je m’en débarrasse parce que j’avais genre hérité du truc […]» (p. 235) La série «Entendu à Saint-Henri» regorge de personnages au langage coloré. Cette façon que tu as de passer du langage écrit au langage parlé me semble être d’un grand intérêt, peut-être parce qu’elle est si rare dans le paysage littéraire québécois. Pourrais-tu nous parler de ton intérêt pour le vernaculaire?
[DG] — L’oralité est un des aspects de la littérature qui est le plus intéressant à travailler, parce que ça semble aller de soi, mais en fait c’est d’une complexité inouïe. Est-ce que c’est une question de dialogue? Est-ce que ça doit s’infiltrer dans le texte entier? Est-ce que c’est de l’oralité d’intituler un livre Anna braillé ène shot? Parfois on a l’impression qu’il ne s’agit que de tendre l’oreille et ensuite coucher ce qu’on entend sur le papier, alors qu’en réalité, en transposant l’oral d’une certaine manière, en le travaillant, en le tordant, en le déformant, on le rend éminemment littéraire: il devient écrit, presque plus écrit qu’un style plus classique. Si l’oralité est trop marquée, on le sait, elle peut même ralentir la lecture et créer un effet de distanciation inverse à ce qui est souhaité. Certains livres ont souffert de ce genre de problème et ils sont difficiles à lire aujourd’hui.
D’un côté, j’essaie d’être le plus fidèle possible à une certaine «voix» québécoise que j’aime exploiter, parce qu’elle est la mienne et celle des gens qui m’entourent, et de l’autre je ne cesse de la triturer pour lui faire dire des choses qui ne se disent pas exactement comme ça, pour lui donner une sorte de plus-value. Ce que j’apprécie aussi, avec cet usage de l’oralité, c’est qu’elle me permet de mettre en scène des personnages à l’âge et au background imprécis; des gens qui s’expriment comme des adolescents puérils, mais qui ont des connaissances littéraires étendues, par exemple. Ça revient à cette idée de déstabiliser le lecteur et d’être son complice en même temps.
L’oralité, le vernaculaire, ce sont des sujets qui reviennent beaucoup quand je discute avec mes amis écrivains. Tout le monde a sa petite idée là-dessus, sur l’importance ou l’inutilité de changer la graphie des mots, sur la place à laisser au lecteur pour imaginer un dialogue au lieu de le reproduire pour lui, sur la différence entre une langue orale qui va bien vieillir sur papier et une espèce de slang montréalais qui sera bientôt dépassé et incompréhensible. Ce sont des questions que je me pose sans cesse en écrivant et pour lesquelles je n’ai pas de réponses claires. Tout ce que je sais, c’est que je ne pourrais pas écrire autrement que dans une langue qui, au minimum, essaie d’être de son temps et de son lieu d’émergence. Pour moi, la langue n’existe pas en dehors du fait de la parler.
[SB] — Une langue de son temps et de son lieu d’émergence, la formule est forte et mérite d’être retenue. On remarque toutefois que cela ne signifie pas pour toi l’expression d’un nationalisme à la ceinture fléchée. Bien au contraire. Parmi les moments forts du livre, je retiens ces passages où tu réfléchis à ta langue et à ta culture depuis un point de vue externe, par exemple celui d’une immigrante brésilienne qui se questionne à propos des québécois: «Elle voudrait mettre un gigantesque accent tonique sur certains mots en français qui ont l’air morts. Comment ça se fait qu’il n’y a pas d’accent tonique sur le mot magnifique ou sur le mot sublime? Comment ça se fait qu’ils parlent avec les mains dans les poches? Il paraît que dans le nord du Québec, quelqu’un lui a dit ça, il paraît que le taux de suicide est encore plus élevé. Le plus élevé du monde.» (p. 85) Tu sembles fasciné par la positivité des rencontres culturelles. Dans Les mines générales, la plus longue nouvelle du recueil, tu évoques avec beaucoup de nuances et de subtilités une rencontre authentique, humaine, entre un québécois et une famille brésilienne. Pourquoi était-ce si important pour toi de signer un long texte qui traite de l’immigration au Québec?
[DG] — C’est une très bonne question, ça. Le Brésil est une autre de mes grandes passions. Ça a été une découverte importante dans ma vie et elle a eu lieu alors que je donnais des ateliers d’histoire et de culture québécoise à de nouveaux arrivants dans le cadre du programme des cours de français du ministère de l’immigration. J’ai fait des rencontres inoubliables durant ces quelques années, qui ont nourri mon imagination et qui ont changé ma façon de voir les choses. À cette époque-là, je me suis mis à me questionner sur ce que j’entendais autour, sur les clichés qui circulaient à propos des immigrants, sur notre rapport à l’étranger. Je tenais à en parler, mais d’un point de vue très personnel. L’immigration est aussi un sujet extrêmement complexe et j’avais envie d’en traiter d’une manière qui ne serait ni condescendante, ni superficielle, et ma passion pour la culture brésilienne et la langue portugaise était pour moi un angle d’approche intéressant et stimulant. Il me permettait entre autres de mettre en lumière les échanges et les rencontres dans leur complexité, et de traiter sur un pied d’égalité de grandes angoisses existentielles très universelles et des préjugés très locaux, en leur permettant de se croiser dans un même univers. Ainsi, la nouvelle Sur le bout de la langue est-elle narrée entièrement du point de vue de l’«autre», qui nous regarde agir, ici, et qui se questionne sur les raisons pour lesquelles elle est partie de son pays. Elle sait que c’était pour les bonnes raisons, mais ça ne l’empêche pas de réinterpréter ce qu’elle y a vécu à la lueur d’une certaine nostalgie inévitable. De l’autre côté, Les mines générales raconte l’histoire d’un jeune homme épris de la culture de l’«autre» au point de développer une véritable obsession, ce qui non seulement a une influence sur sa vie intime et ses relations avec ses proches, mais qui finit par le métamorphoser littéralement en une sorte d’hybride culturel fantasmatique.
Dans le livre, il y a aussi des narrateurs qui sont à la fois des «pure laine» et des exilés, ou des expatriés, qui s’expriment dans une langue extrêmement vernaculaire tout en ayant un passé argentin, polonais, japonais, etc. Ils ne questionnent pas leur propre identité (ils ont d’autres chats à fouetter), mais ils obligent le lecteur à se questionner sur son identité et son rapport à l’autre, jusqu’à un certain point. Pour moi, c’était très important de construire un monde (un quartier) bigarré et hétéroclite, qui soit non pas un simple reflet de notre réalité quotidienne, mais un point de vue personnel sur ce même reflet.
[SB] — Parlant d’identité et d’altérité, un détail m’a frappé en lisant ton livre. Tu prépares une thèse sur les différentes représentations du romancier dans l’histoire de la littérature américaine. Malgré tout on rit à Saint-Henri est peuplé de narrateurs écrivains. Il est assez amusant de constater que ces écrivains ne correspondent pas à l’image qu’on pourrait se faire de l’auteur implicite. En fait, ils s’en éloignent radicalement: il y a un auteur de récits pornographiques, un auteur qui travaille à son troisième livre de contes maltais, un auteur qui tente d’écrire un recueil de haïkus, et j’en passe. L’effet de lecture est assez déstabilisant, puisque ce jeu produit un décalage entre le récit qu’on lit et le type de textes mentionnés par ces narrateurs. Si tu avais à écrire un de ces livres inventés, ce serait lequel?
[DG] — C’est vrai qu’il y a beaucoup d’écrivains dans le recueil. Je crois que c’est un peu un réflexe de jeune auteur de vouloir parler de littérature dans les livres. Ceci dit, malgré la thèse, et toutes les questions intéressantes que je suis amené à me poser en interrogeant cette figure dans les fictions américaines, ce n’est pas quelque chose que j’aurai envie d’explorer dans le futur. Et pour répondre à ta question, il me semble que j’aurais du plaisir à essayer chacun de ces genres très différents, ils ont tous un petit quelque chose d’affriolant, ne trouves-tu pas? Mais celui qui me stimulerait le plus, à bien y penser, ce serait l’hagiographie de Christopher Hitchens en deux tomes. Il me semble que c’est un défi qu’il ne faudrait pas prendre à la légère. Mais tout est possible, à partir du moment où l’Indien de Radio-Canada peut apparaître en image subliminale entre deux plans du Persona de Bergman.
