Entrée de carnet
L’arbre de la «raison graphique» dans «Bouvard et Pécuchet» de Flaubert
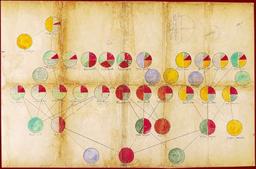
L’anthropologue Jack Goody nomme raison graphique l’influence de l’écriture sur les dispositions cognitives et les modes de pensée. Critique parodique de l’usage de l’écrit au XIXe siècle, Bouvard et Pécuchet, de Gustave Flaubert, illustre tout à fait les différents enjeux de la «raison graphique».
Cet article a été rédigé dans le cadre d’un séminaire dirigé par Véronique Cnockaert intitulé «La raison graphique dans quelques romans du XIXe siècle» (UQAM, automne 2012).
L’analyse proposée ici montre que l’ensemble du propos de Flaubert est condensé dans le traitement qu’il réserve à la figure de l’arbre -l’arbre comme une figure épistémique qui est à la fois emblème de la connaissance, de la généalogie et de l’organisme vivant.
Ce qui caractérise l’homme, ce n’est pas tant le fait de faire des plans, de recourir à la pensée symbolique, que d’extérioriser, de communiquer ces plans, d’opérer des transactions portant sur ces produits de la pensée symbolique. Et c’est précisément ce genre d’activité qu’encourage, que transforme et même transfigure l’écriture. (Goody, 1979: 263)
Les deux personnages éponymes de Bouvard et Pécuchet sont deux citadins parisiens, approchant la cinquantaine, copistes de métier, qui, lassés de leur vie et grâce à un héritage, décident de s’acheter une maison et une terre agricole à la campagne. Ils succombent au rêve idyllique du retour à l’âge d’or, au paradis perdu de l’homme vivant en harmonie avec la nature; rêve idyllique qui se résume en réalité à une tentative de l’homme de dominer la nature par la culture. Pour ce faire, ils lisent les livres les plus éminents de chaque discipline afin de tout connaître et tout savoir dans le but faire fructifier leur terre, mais vont cependant d’échec en échec. Avec ce roman, Gustave Flaubert, amoureux du langage, des lettres et du savoir, fait, sous forme parodique, une sévère critique contemporaine de l’usage de l’écrit au XIXe siècle. De fait, l’écriture a une influence sur les dispositions cognitives et les modes de pensée: «on ne pense plus de la même manière dans une langue écrite» (Goody, 1979: 12). L’anthropologue Jack Goody nomme cette disposition de l’esprit la raison graphique.
L’écriture donne à la parole une forme permanente. Les mots ne sont plus des signaux auditifs évanescents mais des objets durables. Ce qui veut dire que les communications, dans le temps et dans l’espace, connaissent des modifications considérables. Et en même temps les énoncés, parce qu’ils sont matérialisés sous forme écrite, peuvent désormais être examinés, manipulés et réordonnés de façon très diverse (12).
Pour Goody, l’écriture est «la condition du progrès des connaissances» (188). Elle permet une forme de totalisation et un classement des savoirs par «un dispositif spatial de triage de l’information» dont la première forme est la liste. En plus de faciliter la gestion de l’information et de son organisation, l’écriture transforme les représentations du monde. Tous ces enjeux de la raison graphique sont mis en scène dans Bouvard et Pécuchet et s’y manifestent de maintes façons. Suivant l’idée de François Dagognet, philosophe et médecin, selon laquelle le langage des sciences devrait être pictural, les iconographies permettant de «vaincre à la fois l’espace et le temps» (Dagognet, 1973) mieux que ne saurait le faire l’écriture discursive et linéaire, il s’agira de voir comment Flaubert use de l’image contre l’écriture; ou plutôt de la métaphore construite à partir de l’écriture contre l’écriture. L’analyse proposée ici montre que l’ensemble du propos de Flaubert est condensé dans le traitement qu’il réserve à la figure de l’arbre -l’arbre comme une figure épistémique qui est à la fois emblème de la connaissance, de la généalogie et de l’organisme vivant.
La raison graphique
Bien que de nombreuses personnes à travers les époques aient remarqué et évoqué comment l’écriture influence le mode de pensée et d’appréhension du monde -comme Nietzsche, par exemple, qui écrit en 1882: «Vous avez raison -nos outils d’écriture participent à former nos pensées.» (Haberl, 2010: 363) on doit à Jack Goody le concept de raison graphique ainsi que son appréhension théorique et le recensement des répercussions, bonnes et moins bonnes, de l’appareillage littératien dans la culture, la civilisation, et nos vies. Il est important de spécifier que pour Goody l’écriture n’est qu’une forme de civilisation parmi d’autres et ne saurait être un critère de qualification entre civilisé et non-civilisé. Il utilise aussi le terme de «technologies de l’intellect» (Goody, 2007: 193-216), car il voit dans le langage une forme de technologie intériorisée. Grâce à sa capacité d’autonomie, «l’écriture est la possibilité de jeu de l’intellect sur la langue» (Goody, 1979: 9) . De plus, elle permet de se penser soi-même et «vous donne une sorte de liberté d’expression par rapport à vos propres pensées» (263). L’opération de translation qui fait passer de l’oral à l’écrit permet une forme de réflexion sur le propos énoncé: «transcrire c’est transformer» (262). Il s’agit plus que d’une simple copie du langage:
l’écriture nous donne justement l’occasion de nous livrer à ce genre de monologue que la conversation si souvent empêche. Elle permet à l’individu d’exprimer ses pensées en long et en large, sans interruption, d’y apporter corrections et ratures, de rechercher la formule adéquate. (264)
Par ailleurs, la lecture permet de voir les failles logiques d’un système d’idées, d’une idéologie. Comme l’écriture permet de fabriquer des idéologies, elle est aussi un instrument de domination. Cependant, l’écriture peut toujours se retourner contre l’écriture, et devenir une espace de liberté et de création.
Après les Lumières et la Révolution française, le XIXe siècle est une période où la littératie a pris beaucoup d’ampleur avec la naissance de nombreuses institutions littératiennes comme la justice et la loi écrite, l’éducation, la politique, les sciences, le journalisme, etc. Pour cette raison, elle est prégnante dans la littérature et particulièrement déterminante dans le foisonnement du genre romanesque. Dans Bouvard et Pécuchet, rédigé sur une période s’étirant sur près d’une décennie et paru de façon posthume en 1881, et pour lequel Flaubert s’est documenté pendant une vingtaine d’années, la raison graphique est le moteur narratif du récit. D’abord avec les deux personnages principaux, Bouvard et Pécuchet, qui sont deux personnages dont l’habitus est trop littératien. Habitus au sens où l’entend Jean-Marie Privat1Jean-Marie Privat, «Un habitus littératien?», La littératie autour de Jack Goody dans Pratiques, décembre 2000, n° 131-132., qui distingue trois formes de capital littératien: objectivé, institutionnalisé et incorporé. Capital littératien objectivé, car les deux personnages, copistes de métiers, manient quotidiennement les différents outils de transcriptions: «La monotonie du bureau leur devenait odieuse. Continuellement le grattoir et la sandaraque, le même encrier, les mêmes plumes et les mêmes compagnons! (Faubert, 1881: 55-56)». Capital littératien institutionnalisé, car l’organisation de leur vie passe par l’écrit, par les livres auxquels ils se réfèrent en toutes occasions tandis que l’organisation de leur avoir est régie par des lois juridiques. Capital littératien incorporé, car leur identité et leur mode de pensée sont forgés par leurs lectures qui médiatisent leur rapport au monde. Pour Privat, «l’état incorporé se réalise exemplairement dans la figure de l’homo litteratiens que Nietzsche diabolise comme “encyclopédie ambulante” et que Flaubert (sinon le professeur de lettres…) chérit comme idéale et fusionnelle bio-graphie» (Privat: 126). De fait, dans une lettre, Flaubert se décrit comme un «homme-plume»: «Je sens par elle, à cause d’elle, par rapport à elle et beaucoup plus avec elle.» (Privat: 126)
Ces deux hommes se rencontrent par hasard un dimanche après-midi où ils s’assoient en même temps sur le même banc.
Pour s’essuyer le front, ils retirèrent leurs coiffures, que chacun posa près de soi. Et le petit homme aperçut écrit dans le chapeau de son voisin: « Bouvard »; pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot: « Pécuchet ».
—«Tiens!» dit-il «nous avons eu la même idée, celle d’inscrire notre nom dans nos couvre-chefs.»
—«Mon Dieu, oui! on pourrait prendre le mien à mon bureau!»
—«C’est comme moi, je suis employé.»
Alors ils se considérèrent. (Flaubert: 45-46)
Ainsi, c’est la raison graphique qui leur donne envie de lier une conversation, qui débouchera sur une amitié de longue durée et une vie commune à la campagne, qu’ils décideront de partager suite à l’héritage que reçoit Bouvard. Par voie de testament, il apprend que son oncle est en réalité son père et lui lègue tout son avoir au détriment de ses deux fils légitimes. Sans l’institution littératienne juridique de l’État de droit, cet héritage, qui déshérite les fils légitimes, aurait été impossible. Rêvant depuis quelques temps de quitter la ville et de s’installer à la campagne, Bouvard et Pécuchet décident de réaliser leurs ambitions grâce à cet héritage.
Une fois installés dans leur nouvelle maison, à partir de livres théoriques et de quelques conseils glanés à droite et à gauche chez les paysans du coin, ils s’improvisent fermiers et agriculteurs, mais rien ne leur réussit et ils vont de désastres en catastrophes. Ils se lancent ensuite dans l’arboriculture, dans l’architecture de paysage, la fabrication de vin et de conserves sans plus de résultats. Pensant pallier leur incompétence dans la confection de nourriture, ils enchaînent avec l’apprentissage de la chimie. Ce domaine étant trop compliqué et infini, ils bifurquent vers la médecine et la biologie, la pharmaceutique, la nutrition, mais finissent par se rendre malade. Ils s’investissent ainsi d’un champ de connaissance à l’autre, se lassant chaque fois devant leurs fiascos, l’ampleur des connaissances et leur incapacité à les assimiler. Ils étudient et expérimentent, dans cet ordre, les sciences naturelles, le croisement des animaux, la paléontologie, l’origine du monde, l’astronomie, la théorie de l’évolution, l’archéologie, le Moyen-Âge, l’histoire, la littérature, le théâtre, l’écriture, la grammaire, la philosophie esthétique, la politique, l’utopie, l’économie, l’amour, la gymnastique, la politique, le magnétisme, la guérison, le spiritisme, la philosophie, l’éthique, la psychologie, l’origine des idées, les facultés de l’âme, la logique, Pécuchet l’idéalisme, Bouvard le matérialisme, le libre arbitre, le déterminisme, le suicide, la théologie, la Bible, le mysticisme, la mythologie, l’histoire des martyrs, l’éducation, la morale, l’écriture. Pour finalement, après s’être mis à dos leur entourage et avoir dilapidé leur fortune, se remettre à copier des textes. Néanmoins, malgré le retour à la case de départ, il y a une forme d’évolution : leur expérience leur a appris à connaître et reconnaître la bêtise et dorénavant ils choisissent par eux-mêmes ce qu’ils vont recopier et constituent un dictionnaire des idées reçues. Ils reconstituent à leur tour une organisation et un classement des savoirs. Le font-ils pour prévenir les gens contre les sottises qui circulent ou au contraire pour leur indiquer quoi répéter pour bien paraître en société? Chaque lecteur est libre de répondre à cette question, la fin est ouverte.
Le savoir encyclopédique
Flaubert fait de leur soif de connaissances et de leur incapacité à les maîtriser une parodie de son époque où règnent les sciences positives et la prétention de pouvoir parvenir à un savoir totalisant et à maîtriser le destin de l’humanité vers un progrès sans fin. Comme de nombreux critiques l’ont indiqué, Bouvard et Pécuchet est une «encyclopédie en farce», où le classement des savoirs et la transition entre ceux-ci parodie le découpage des disciplines de l’époque. Ce classement est réitéré avec le dictionnaire des idées reçues que constituent Bouvard et Pécuchet à la fin du roman.
Pour Jack Goody, l’écriture et la raison graphique ont permis de classer et d’accumuler les connaissances, ce qui a conduit à la constitution de savoirs et de disciplines propres à chacun de ces savoirs. Selon lui, la première forme de classement qui est apparue est la liste: «en permettant d’ordonner, d’assembler, de reconstruire après coup ce qui dans la pratique est disparate et fragmentaire, l’analyse graphique a pour effet d’engendrer l’illusion d’une cohérence formelle parfaite» (Goody: 15). Mais en même temps, le rassemblement d’informations de diverses provenances temporelles, culturelles ou géographiques, permet d’en faire ressortir les contradictions. «En outre, l’écriture contribue à accentuer la dimension hiérarchique du système classificatoire. En même temps, par le fait même qu’elle les assemble, elle conduit à s’interroger sur la nature de ces classes.» (182) Par ailleurs, la classification des éléments dans des ensembles conduit aussi à des «processus d’hyper-généralisation»: «le seul fait d’avoir à insérer cet élément dans une liste tout à fait détachée du contexte parlé ordinaire confère au choix retenu une généralité qu’il n’aurait pas autrement.» (187)
Comme l’indique Hildegard Haberl à la suite de Michel Serres, dans sa thèse Écriture encyclopédique – écriture romanesque. Représentations et critique du savoir dans le roman allemand et français de Goethe à Flaubert, le XIXᵉ siècle est «l’âge hégélien ou l’âge positif», où l’on tente de «symétriser l’universalité de l’ordre encyclopédique et la totalité du progrès temporel2Michel Serres cité par Haberl, op. cit., p. 127.». Auguste Comte, à la suite de Hegel, a éliminé les arts et la littérature dans la classification des sciences :
Cette conception des connaissances a pour but le Progrès et, dans cette perspective, Comte met en avant les connaissances objectives, les seules à pouvoir asseoir ce dernier. Ainsi l’art est-il absent de son «Tableau synthétique de l´ordre universel» paru dans le Catéchisme positiviste, 1852. La littérature et les sciences semblent s’éloigner. La division des savoirs en disciplines distinctes finira ainsi par produire «deux cultures» qui ne se comprennent plus: littérature d’un côté et sciences de l’autre. (Haberl, 2010: 128)
Flaubert, en tant que «très fin analyste de la langue» et fervent lecteur d’œuvres savantes, est très critique à l’égard des dictionnaires et des encyclopédies, des sciences dites positives, et en fait ressortir les contradictions.
Il voit la bêtise qui se manifeste un peu partout dans le monde de l’écrit. Son dernier roman prend ainsi une forme polymorphe en proposant un montage de roman (forme du récit), de dictionnaire (la forme alphabétique) et de liste de sottises (liste de citations). (Haberl, 2010: 154)
De plus, avec une structure semblable à celle de la liste, Flaubert fait «éclater la narration dans le sens de l’énumération3U. Sprenger, cité par Haberl, op. cit., p. 134.». Selon Yvan Leclerc, dans Bouvard et Pécuchet, l’ordre général des savoirs suit un ordre alphabétique: agriculture, arboriculture, chimie, diététique, géologie, histoire, littérature, magnétisme, métaphysique, philosophie, religion, et le livre est divisé en deux sections : sciences dures et sciences molles; physique et métaphysique (Haberl: 134) -on pourrait ajouter que même les noms des personnages apparaissent en ordre alphabétique dans le titre4Il est vrai que dire Pécuchet et Bouvard pourrait sembler moins naturel. Serait-ce dû aux effets de la raison graphique?. Par ailleurs, pour s’opposer à l’évincement de la littérature des sciences écrites:
Le roman de Flaubert, surchargé de savoirs, que l’on a qualifié d’«encyclopédie artistique» ou d’«encyclopédie littéraire», est ainsi d’une certaine manière et encore une fois un contremodèle pour l’encyclopédie philosophicoscientifique «institutionnelle». (Haberl: 130)
Ainsi que le mentionne Hildegard Haberl, les métaphores de l’arbre, du labyrinthe, du voyage, de la carte, du panorama et de la chaîne sont souvent utilisées pour illustrer le savoir encyclopédique, mais l’arbre en est la représentation la plus courante. Cette tradition remonte au franciscain Raymond Lulle et à Francis Bacon. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert associe «l´émiettement de l’ordre alphabétique à un tableau systématique des connaissances» (Haberl: 95) pour donner un système qui a la forme d’un arbre. Comme le souligne Haberl, la métaphore de l’arbre est beaucoup plus signifiante que les autres, car elle ajoute une dimension de continuité et de renouvellement, c’est
une image énergétique et dynamique qui permet de représenter des processus évolutionnaires tels que la régénération permanente du fruit, de la semence et de la racine -c’est-à-dire des processus cycliques. Parce qu’il permet de penser des ramifications et des réseaux complexes, ce modèle dynamique se prête facilement à la représentation du développement de la connaissance, du savoir et des modèles scientifiques. (96)
L’arbre de la connaissance
a) L’arboriculture
La figure épistémique de l’arbre comme emblème de la connaissance et du savoir encyclopédique ponctue le récit de Bouvard et Pécuchet. Après leur lamentable échec en agriculture, Bouvard et Pécuchet se mettent à l’arboriculture avec l’espoir de faire de l’argent. Toutes les tailles et opérations qu’ils tentent sur les arbres sont analogues aux manifestations de la raison graphique dans le travail que font les écrivains et les encyclopédistes qui écrivent, transcrivent et classent les savoirs. Par exemple, ils utilisent des tuteurs, des raidisseurs et des supports, car les formes que doivent prendre les arbres sont dessinées à l’avance. Ainsi, du point de vue de la littératie, on tente de faire entrer les connaissances dans des compartiments et des formes préétablies.
Le printemps venu, Pécuchet se mit à la taille des poiriers. Il n’abattit pas les flèches, respecta les lambourdes; -et s’obstinant à vouloir coucher d’équerre les duchesses qui devaient former les cordons unilatéraux, il les cassait ou les arrachait, invariablement. Quant aux pêchers, il s’embrouilla dans les sur-mères, les sous-mères, et les deuxièmes sous-mères. Des vides et des pleins se présentaient toujours où il n’en fallait pas; -et impossible d’obtenir sur l’espalier un rectangle parfait, avec six branches à droite et six à gauche, -non compris les deux principales, le tout formant une belle arête de poisson. Bouvard tâcha de conduire les abricotiers. Ils se révoltèrent. Il abattit leurs troncs à ras du sol; aucun ne repoussa. (Flaubert, 1881: 87-88)
Les tailles effectuées sont analogues au classement des savoirs et à la façon dont on rejette parfois certaines des connaissances ou détails. Ou bien, comment parfois on occulte ce qui est à l’origine d’un champ de connaissance, comme dans cet exemple où ils taillent les racines, qui par analogie sont les fondements d’une connaissance.
Les trous étant creusés, ils coupèrent l’extrémité de toutes les racines, bonnes ou mauvaises, et les enfouirent dans un compost. Six mois après, les plants étaient morts. Nouvelles commandes au pépiniériste, et plantations nouvelles, dans des trous encore plus profonds! Mais la pluie détrempant le sol, les greffes d’elles-mêmes s’enterrèrent et les arbres s’affranchirent. (Flaubert: 87)
Dans la dernière partie de la citation, il est question de greffe. Le geste de greffer peut être vu comme l’ultime figure épistémique de la volonté de l’Homme de maîtriser, dominer, diriger et contraindre la nature en créant des espèces hybrides. Comme de nombreux critiques littéraires l’ont mentionné, la figure de la greffe est analogue à la citation et à l’intertextualité. Tout le récit de Bouvard et Pécuchet est greffé de connaissances, de citations et de références multiples. Il est aussi un produit hybride, qui allie notamment science et littérature ainsi que la forme du roman à celle de la liste encyclopédique.
Les deux amis sont beaucoup trop littératiens pour réussir leur entreprise. Ils n’ont pas un rapport direct avec ce qu’ils font, leur rapport à la nature est toujours médiatisé par le livre.
Quelquefois Pécuchet tirait de sa poche son manuel; et il en étudiait un paragraphe, debout, avec sa bêche auprès de lui, dans la pose du jardinier qui décorait le frontispice du livre. Cette ressemblance le flatta même beaucoup. Il en conçut plus d’estime pour l’auteur. (Flaubert: 88)
La liste des opérations d’arboriculture littératienne est trop longue pour en faire ici un recensement exhaustif. Elles s’avèrent néanmoins pratiquement toutes infructueuses et désastreuses. Ensuite la nature se charge de détruire le peu d’arbres et de fruits qu’ils ont réussi à réchapper de l’échec. Comme quoi les manifestations de la nature finissent toujours par contredire le savoir scientifique et il est vain de croire pouvoir la maîtriser et la dominer une fois pour toutes.
[T]out à coup le tonnerre retentit et la pluie tomba, -une pluie lourde et violente. Le vent, par intervalles, secouait toute la surface de l’espalier. Les tuteurs s’abattaient l’un après l’autre- et les malheureuses quenouilles en se balançant entrechoquaient leurs poires. Pécuchet surpris par l’averse s’était réfugié dans la cahute. Bouvard se tenait dans la cuisine. Ils voyaient tourbillonner devant eux, des éclats de bois, des branches, des ardoises; […] Puis tout à coup, les supports et les barres des contre-espaliers avec le treillage, s’abattirent sur les plates-bandes. (Flaubert: 89)
b) Le jardin décoratif
Leurs tentatives de mettre de l’ordre par le savoir littératien créent toujours du désordre. Comme la culture du jardin est un désastre, Bouvard et Pécuchet se lancent dans l’architecture de paysage: tentative ultime pour se donner l’illusion de savoir imiter la nature à défaut de pouvoir la maîtriser. L’élément le plus significatif de leur aménagement est l’arbre qu’ils abattent au sol pour compléter le décor.
Quelque chose manquait au-delà pour compléter l’harmonie. Ils abattirent le plus gros tilleul de la charmille (aux trois quarts mort, du reste) et le couchèrent dans toute la longueur du jardin, de telle sorte qu’on pouvait le croire apporté par un torrent, ou renversé par la foudre. (Flaubert: 93)
Ainsi, Flaubert abat l’arbre de la connaissance et le jette par terre. Après que Bouvard et Pécuchet ont détruit leur plantation par leurs opérations littératiennes, aidés ensuite par la tempête de Dame Nature, le dernier coup fatal est porté avec ce gros arbre abattu en travers du jardin. Or, quelque temps plus tard, Bouvard et Pécuchet aggravent de nouveau la situation: «Un mois se passa dans le désœuvrement. Puis ils songèrent à leur jardin. L’arbre mort étalé dans le milieu était gênant. Ils l’équarrirent» (Flaubert: 118). Si cet arbre équarri couché au sol cristallise le propos de Flaubert, qui, en plus d’abattre l’arbre de la connaissance, le dépouille de ses branches et le transforme en poutre bien droite, on pourrait même ajouter en marchandise; l’ébranchement et l’équarrissage réservés à la figure épistémique de l’arbre pourraient alors être vus comme une opposition au classement et aux cloisonnements des disciplines.
Un peu plus tard, le même arbre est encore convoqué dans un épisode où ils se mettent à la gymnastique:
Un cheval de voltige en bois avec le rembourrage eût été dispendieux, ils y renoncèrent; le tilleul abattu dans le jardin leur servit de mât horizontal; et quand ils furent habiles à le parcourir d’un bout à l’autre, pour en avoir un vertical, ils replantèrent une poutrelle des contre-espaliers. Pécuchet gravit jusqu’en haut. Bouvard glissait, retombait toujours, finalement, y renonça. (Flaubert: 261)
Seul Pécuchet est capable de se déplacer à la verticale. On peut mettre ceci en parallèle avec l’épisode philosophique où Pécuchet défend l’idéalisme et Bouvard le matérialisme. Ce qui peut amener à postuler que chez Flaubert la verticalité serait associée à la transcendance métaphysique et à l’idéalisme -association somme toute assez courante; et l’horizontalité au matérialisme. Par ailleurs, un arbre contient à la fois des lignes verticales et horizontales. Ainsi, suivant cette analogie, au XIXe siècle, l’arbre de la connaissance serait un mélange synchronique et contradictoire d’idéalisme et de matérialisme, mais Flaubert l’abat au sol et le dépouille de ses branches. Il récuse ainsi l’un comme l’autre, ce qui induit qu’il conteste toute notion d’essence, et ce, peu importe qu’elle soit transcendante ou immanente, peu importe qu’elle existe avant ou après la matière. Selon cette analyse, Flaubert contesterait toute essentialisation, d’ordre physique ou métaphysique, de la matière et de la vie. Et de fait, Bouvard et Pécuchet renonceront à l’idéalisme comme au matérialisme après en avoir relevé toutes les contradictions. Par ailleurs, étrangement, dans leur épisode philosophique, ils paraissent plus intelligents qu’à l’habitude et raisonnent davantage en confrontant et comparant les fruits de leurs lectures. On pourrait objecter que l’arbre n’est pas complètement supprimé et existe toujours à l’horizontale, équarri sous forme de poutre, et supposer que Flaubert opte pour le matérialisme. D’autant plus que l’arbre étant souvent associé à la transcendance, c’est pour cette raison que Deleuze et Guattari lui ont préféré la figure du rhizome, qui est une arborescence à l’horizontale sous la terre, dont l’essence est immanente, pour représenter le livre et la littératie.
Nous sommes fatigués de l’arbre. Nous ne devons plus croire aux arbres, aux racines ni aux radicelles, nous en avons trop souffert. Toute la culture arborescente est fondée sur eux, de la biologie à la linguistique. Au contraire, rien n’est beau, rien n’est amoureux, rien n’est politique, sauf les tiges souterraines et les racines aériennes, l’adventice et le rhizome. (Deleuze, Guattari, 1980: 24)
Mais l’arbre de Flaubert n’a même plus de branches, ni de racines, pour «faire rhizome» (Deleuze, Guattari: 18) avec quoi que ce soit, il est réduit à l’état de poutre, de marchandise –qui aurait au moins dû normalement servir à construire quelque chose, mais reste au contraire comme un corps mort au milieu du jardin. Ainsi, la première hypothèse semble plus plausible, et, de surcroît, Flaubert, en choisissant une forme circulaire pour structurer son récit, renonce à l’arborescence et aux lignes droites, qu’elles soient verticales ou horizontales -peut-être que l’idéalisme et le matérialisme ne peuvent cohabiter que dans une perpétuelle circularité.
c) Le cycle et la spirale
Par opposition à la vision linéaire et horizontale du progrès héritée de Hegel, Flaubert propose une vision cyclique du monde, à l’image de celle de la nature et des saisons. La circularité se manifeste de trois façons dans la structure du récit, ce qui accentue le mouvement circulaire en créant un effet de spirale. L’enchaînement et la transition d’un champ de connaissance à l’autre sont cycliques et ce sont toujours les mêmes étapes qui reviennent à chaque fois : intérêt et curiosité, achats de matériel et de livres théoriques, lectures, recherches et expérimentations, résultats peu concluants ou désastreux, problèmes financiers, déception, découragement face à l’immensité de la tâche, abandon du champ de connaissance étudié, nouvel intérêt envers une autre discipline en croyant qu’elle pourra pallier les insuffisances de la précédente, et ainsi de suite. Ou plus simplement, pour reprendre la structure d’Alfonso de Toro, un cycle qui fonctionne sur le modèle «début–réalisation–abandon» doublé de la série «enthousiasme–identification–désillusion5Cité par Haberl, op. cit., p. 134.», qui s’y superpose. L’effet circulaire est redoublé par la dernière science abordée qui est celle de l’éducation: ils se sont donnés pour tâche d’élever deux enfants abandonnés. Il y a donc une répétition de tous les savoirs explorés précédemment. De plus, la fin du récit ramène au commencement quand ils redeviennent copistes et réinjectent tous leurs savoirs dans le dictionnaire des idées reçues. Un effet de spirale est crée par une roue, ou cycle, qui tourne dans une roue qui tourne elle aussi dans une autre roue qui tourne. Spirale qui est également présente dans le jardin sous la forme d’un «vigneau», terme normand qui désigne un tertre au sommet duquel on accède par «une allée en spirale aboutissant à un cabinet de verdure» (Flaubert: 66). Les deux amis y prennent souvent un café ou un digestif pour y réfléchir et discuter de leurs expériences en regardant au loin seuls ou avec des invités. Ainsi le texte détruit les lignes horizontale et verticale du savoir représentées par l’arbre et instaure à la place la figure cyclique de la spirale. Cette structure circulaire permet en quelque sorte d’échapper à la linéarité habituelle du discours.
L’arbre de la liberté
Avec la nouvelle République de 1848, on plante partout en France des arbres de la liberté. Le conseil municipal décide d’en faire de même à Chavignolles. Bouvard et Pécuchet, qui sont dans une phase où ils étudient la politique, offrent un arbre à la commune.
Gorgu, leur obéissant avec zèle, déplanta un des peupliers qui bordaient la prairie au-dessous de la Butte, et le transporta jusqu’au «Pas de la Vaque», à l’entrée du bourg, endroit désigné. (Flaubert: 217)
Une cérémonie officielle a lieu.
L’allocution du curé fut comme celle des autres prêtres dans la même circonstance. Après avoir tonné contre les rois, il glorifia la République. Ne dit-on pas la république des lettres, la république chrétienne? Quoi de plus innocent que l’une, de plus beau que l’autre? Jésus-Christ formula notre sublime devise; l’arbre du peuple c’était l’arbre de la croix. Pour que la Religion donne ses fruits, elle a besoin de la charité. (Flaubert: 218)
Quelques années plus tard, la République est remplacée par le Second Empire.
Les arbres de la liberté furent abattus généralement. Chavignolles obéit à la consigne. Bouvard vit de ses yeux les morceaux de son peuplier sur une brouette. Ils servirent à chauffer les gendarmes; -et on offrit la souche à M. le curé- qui l’avait béni, pourtant! Quelle dérision! (Flaubert: 234)
Encore une fois, l’arbre est abattu et débité, cette fois, en petits morceaux. Les abstractions conceptuelles de liberté, égalité et fraternité produites par les institutions politiques littératiennes ne résistent pas à l’épreuve de la réalité et sont réduites en bois de chauffage, en marchandise. L’arbre comme figure épistémique et politique est également abattu et débité par Flaubert.
L’arbre généalogique
Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, à l’Orient, et il y mit l’homme qu’il avait modelé. Yahvé Dieu fit pousser du sol toutes espèces d’arbres séduisants à voir et bons à manger, et de l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.6Genèse 2, 8-9
L’arbre n’est pas seulement une figure épistémique qui représente le savoir encyclopédique et un système de classification. Il est depuis longtemps associé à la généalogie et à la vie. La ramification des branches est analogue à la multiplication des organismes vivants, au système sanguin et au système nerveux. Dans la Genèse, au début du premier testament de la Bible, le péché originel d’Adam et Ève est d’avoir goûté le fruit défendu de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, leur vision s’est modifiée et ils ont pris conscience qu’ils étaient nus, cela les a intimidés et ils se sont fabriqué de quoi couvrir leur nudité. Peut-être que c’est peut-être à ce moment-là qu’est né le désir, car auparavant ils étaient nus et ça ne les dérangeait pas. Dès la genèse, récit de tradition orale, qui, selon la plupart des hypothèses, aurait été mis à l’écrit vers le VIIe siècle ou quelque part entre le VIIIe et le Ve siècle avant notre ère, la connaissance et la généalogie sont inscrites simultanément dans la figure de l’arbre.
Outre les occurrences vues précédemment, l’arbre n’est présent dans le récit de Bouvard et Pécuchet que dans deux autres types de circonstances: lorsqu’il est question de désir et lors de leur épisode sur le magnétisme. La connaissance ne fonctionne pas chez Bouvard et Pécuchet, et il en est de même avec la généalogie. En effet, ils ont chacun un épisode amoureux qui finit par avorter.
Bouvard, veuf et sans enfant, a une intrigue amoureuse avec madame Bordin, qui est veuve aussi. Plusieurs étapes de leur petite idylle sont ponctuées par la présence de l’arbre. Au début du récit, peu après leur installation à Chavignolles, Bouvard et Pécuchet invitent les gens du coin pour faire plus ample connaissance, mais surtout pour leur montrer l’aménagement paysager qu’ils ont conçu pour leur jardin.
Mme Bordin recommença le détail de ses cornichons, promit une seconde recette pour les prunes à l’eau-de-vie -et fit encore trois tours dans la grande allée. En passant près du tilleul le bas de sa robe s’accrocha; et ils l’entendirent qui murmurait: -«Mon Dieu! quelle bêtise que cet arbre!» (Flaubert: 100)
Il s’agit du même arbre abattu, vu plus tôt, mais qui n’a pas encore été équarri. Quelque temps plus tard, pendant leur période archéologique, Bouvard et Pécuchet font visiter le musée qu’ils ont installé dans leur salon. Bouvard complimente madame Bordin pendant que le notaire regarde l’arbre généalogique de la famille Croixmare.
Ensuite, elle blâma, vu l’inconvenance, le décolletage de la dame en perruque poudrée.
-«Où est le mal?» reprit Bouvard. «Quand on possède quelque chose de beau?» et il ajouta plus bas: «Comme vous, je suis sûr?»
Le notaire leur tournait le dos, étudiant les branches de la famille Croixmare. Elle ne répondit rien, mais se mit à jouer avec sa longue chaîne de montre. Ses seins bombaient le taffetas noir de son corsage; et les cils un peu rapprochés, elle baissait le menton, comme une tourterelle qui se rengorge. (Flaubert: 161)
Néanmoins, ce qui a vraiment éveillé leur désir, c’est la littérature. Dans un épisode où Bouvard et Pécuchet se mettent à la tragédie et au théâtre, Bouvard déclame des vers de Victor Hugo et cela fait beaucoup d’effet à Mme Bordin. Il la raccompagne ensuite chez elle.
Le soleil avait reparu, faisait luire les feuilles, jetait des taches lumineuses dans les fourrés, çà et là. Trois moineaux avec de petits cris sautillaient sur le tronc d’un vieux tilleul abattu. Une épine en fleurs étalait sa gerbe rose, des lilas alourdis se penchaient. (Flaubert: 202)
Il y a encore la présence d’un arbre abattu. Puis, quelques lignes plus loin,
[Bouvard] ayant jeté un regard autour d’eux, il la prit à la ceinture, par derrière, et la baisa sur la nuque, fortement. Elle devint très pâle comme si elle allait s’évanouir -et s’appuya d’une main contre un arbre; puis, ouvrit les paupières, et secoua la tête. (Flaubert: 203)
Bien qu’elle s’appuie d’une main contre un arbre, leur histoire ne va finalement pas très loin, car ce qui intéresse réellement Mme Bordin, c’est d’acheter à bas prix une de leur terre. Il est même question de mariage entre eux, mais lorsque Bouvard découvre ses intentions dans le contrat de mariage, il annule tout. La littératie fait, pour ainsi dire, avorter la généalogie.
Pécuchet, pour sa part, n’a jamais été marié et n’a jamais connu l’amour. Le désir se révèle à lui graduellement.
Mélie dans la cour, tirait de l’eau. La pompe en bois avait un long levier7Nous soulignons. Pour le faire descendre, elle courbait les reins -et on voyait alors ses bas bleus jusqu’à la hauteur de son mollet. Puis, d’un geste rapide, elle levait son bras droit, tandis qu’elle tournait un peu la tête. Et Pécuchet en la regardant, sentait quelque chose de tout nouveau, un charme, un plaisir infini. (Flaubert: 249)
Encore une fois, un morceau d’arbre, transformé, dans une image assez suggestive, en long levier de bois que Mélie manie d’un geste rapide en levant son bras, accompagne la scène. Cependant, le désir se révèle plus brutalement à Pécuchet lorsque, marchant «dans un chemin, couvert par des ormes touffus», il surprend derrière «la rangée d’arbres les séparant de lui» (Flaubert: 251) deux amoureux qui se déclarent passionnément leur amour. Il s’agit de Gorgu, le menuisier, et de Mme Castillon, la fermière. En réveillant les pulsions du désir, cet évènement révolutionne son esprit. Il devient amoureux de Mélie, la jeune bonne qui travaille chez lui, et tente de la séduire avec de petites attentions.
Pour lui éviter du mal, il se levait de bonne heure, cassait le bois, allumait le feu, poussait l’attention jusqu’à nettoyer les chaussures de Bouvard. (Flaubert: 256)
Encore des morceaux d’arbre découpé, avec lesquels il allume le feu dans le but d’allumer le feu de la passion reproductrice. Il finit par la conquérir et découvre avec elle les plaisirs de la chair dans la cave sur un tas de petit bois.
Un tas de fagots se trouvait derrière. Elle s’y laissa tomber, les seins hors de la chemise, la tête renversée; -puis se cacha la figure sous un bras- et un autre eût compris qu’elle ne manquait pas d’expérience. (Flaubert: 258)
L’idylle entre Pécuchet et Mélie ne va pourtant pas bien loin et ne porte pas ses fruits, car Pécuchet attrape une maladie sexuelle assez douloureuse. D’où l’analogie avec l’arbre généalogique découpé en morceaux, réduit à l’état de tas de fagots et de bois d’allumage. En effet, au moment où il rencontre Mélie la première fois, avant de l’embaucher, lui et Bouvard sont chez Gorgu de qui ils achètent un bahut de style renaissance décrit ainsi:
Un valet d’écurie vint prendre de l’avoine dans un vieux coffre, et laissa retomber le couvercle si brutalement qu’un éclat de bois8Nous soulignons en jaillit. Gorgu s’emporta contre la lourdeur de tous «ces gars de la campagne»; puis, à genoux devant le meuble, il cherchait la place du morceau. Pécuchet en voulant l’aider, distingua sous la poussière, des figures de personnages. C’était un bahut de la Renaissance, avec une torsade en bas, des pampres dans les coins, et des colonnettes divisaient sa devanture en cinq compartiments. On voyait au milieu, Vénus-Anadyomène debout sur une coquille, puis Hercule et Omphale, Samson et Dalila, Circé et ses pourceaux, les filles de Loth enivrant leur père; tout cela délabré, rongé de mites, et même le panneau de droite manquait. Gorgu prit une chandelle pour mieux faire voir à Pécuchet celui de gauche qui présentait sous l’arbre du Paradis, Adam et Ève dans une posture fort indécente. (Flaubert: 151-152)
Gorgu est décidément celui par qui le désir et les pulsions organiques se révèlent à Pécuchet. À l’aide la sa chandelle, il lui montre, restée dans l’ombre, la scène d’Adam et Ève dans une posture fort indécente à côté de l’arbre du Paradis. Il est intéressant de remarquer comment diverses scènes mythologiques et bibliques sont compartimentées, par exemple, celle du premier testament où, suite à la destruction de Sodome, les filles de Loth enivrent leur père pour s’assurer une descendance. La matière première de l’arbre est cette fois-ci transformée en meuble, mais même celui-ci, délabré, rongé de mites, le panneau de droite manquant, ne résiste pas et vole en éclats. Il sera de fait brisé et réparé à plusieurs reprises durant le récit, comme cette fois où Bouvard et Pécuchet le retrouvent ainsi:
Ses morceaux épars jonchaient le fournil; les sculptures étaient endommagées, les battants rompus. À ce spectacle, devant cette déception nouvelle, Bouvard retint ses pleurs et Pécuchet en avait un tremblement. Gorgu se montrant presque aussitôt, exposa le fait. Il venait de mettre le bahut dehors pour le vernir quand une vache errante l’avait jeté par terre. (Flaubert: 188)
Dans l’épisode amoureux de Pécuchet, l’arbre généalogique, plutôt que de pousser et produire des fruits, est découpé en morceaux, réduit à du bois d’allumage, à un levier de pompe ou à un meuble qui, illustrant des scènes généalogiques, est rongé par les mites et tombe en morceaux. Le bois et le désir étant partie prenante dans ce roman, il n’y a rien d’étonnant à ce que les deux amis retiennent leurs pleurs devant le meuble brisé, figure de leurs amours.
Par ailleurs, entre le moment de l’achat du bahut et celui où Pécuchet découvre ses pulsions libidinales, dans une phase où ils font de l’archéologie celtique, les deux amis s’intéressent à la figure du phallus qui est souvent représenté par un arbre:
où il y a des menhirs, un culte obscène a persisté, témoin ce qui se faisait à Guérande, à Chichebouche, au Croisic, à Livarot. Anciennement, les tours, les pyramides, les cierges, les bornes des routes et même les arbres9Nous soulignons avaient la signification de phallus -et pour Bouvard et Pécuchet tout devint phallus. (Flaubert: 169)
Ils font même, dans un compartiment spécial, une collection de phallus dans leur musée maison.
Ils recueillirent des palonniers de voiture, des jambes de fauteuil, des verrous de cave, des pilons de pharmacien. Quand on venait les voir, ils demandaient: «À qui trouvez-vous que cela ressemble » puis, confiaient le mystère. (Flaubert: 169)
Le chapitre qui porte sur l’épisode amoureux de Bouvard et Pécuchet semble assez important dans la construction du récit, car il est très court et ne contient que ce sujet d’apprentissage contrairement aux autres chapitres qui sont beaucoup plus longs et portent sur plusieurs champs de savoir. Il est situé à peu près au centre du récit et semble marquer un tournant dans le cheminement de Bouvard et Pécuchet. De fait, après cette révélation pulsionnelle, ils semblent moins idiots et raisonnent beaucoup mieux, comme c’est le cas dans l’épisode philosophique vu plus tôt. De plus, cet épisode amoureux précède de peu le seul champ de connaissance, le magnétisme, où les deux compères obtiennent un certain succès. Comme si le fait de prendre conscience de leur corps et de ses pulsions a équilibré leur côté littératien trop dominant. De fait, la littératie et la pensée conceptuelle, qui en est issue, fragmentent la réalité et ne tiennent pas compte de la réalité du corps et de ses pulsions organiques. Bref, comme la figure de l’arbre associe simultanément connaissance et généalogie, il est possible de postuler que, chez Bouvard et Pécuchet, c’est la littératie qui fait avorter la généalogie.
L’arbre de vie
L’arbre comme figure de l’organisme vivant et de la vie est lié avec l’épisode où Bouvard et Pécuchet se lancent dans le magnétisme et la guérison. Ils font asseoir les gens sur un banc sous un poirier qu’ils ont préalablement embrassé.
Tous tenaient à la main une ficelle descendant de l’arbre […] Pécuchet se rappela un excellent moyen de magnétisation. Il mit dans sa bouche tous les nez des malades et aspira leur haleine pour tirer à lui l’électricité -et en même temps, Bouvard étreignait l’arbre, dans le but d’accroître le fluide. (Flaubert: 273-274)
Étrangement, sans avoir un succès complet, ils réussissent à guérir de nombreux incurables. Les résultats obtenus, pourtant inexplicables d’un point de vue scientifique ou médical, dépassent largement les frasques rencontrées dans toutes les autres disciplines étudiées. Ainsi, cette science occulte serait la moins décriée par Flaubert. L’arbre de vie, c’est-à-dire comme image de l’énergie qui constitue la matière et la vie, est la seule figure de l’arbre qui survit au massacre de la plume de Flaubert. Ceci confirme l’hypothèse selon laquelle Flaubert, en abattant et en ébranchant l’arbre de la connaissance, rejette l’idéalisme et le matérialisme, donc toutes notions d’essences et d’essentialisation; il donnerait plutôt la place à celles d’énergie vitale et de pulsions organiques.
L’image et la métaphore
Suivant l’idée de François Dagognet, philosophe et médecin, selon laquelle le langage des sciences devrait être pictural, les iconographies permettant de vaincre l’espace et le temps mieux que ne sauraient le faire l’écriture discursive et linéaire, cette analyse a permis de mettre en évidence comment un propos peut être condensé dans une image ou une figure. Dans l’introduction de son essai, Écriture et iconographie, Dagognet rappelle «la conduite “dite du panier”» (1973: 8), que Pierre Janet tient pour la première manifestation, sinon l’origine, de l’intelligence. Le panier serait le premier média. Cet instrument sert à transporter d’un seul coup plusieurs objets d’un endroit à un autre. Ce déplacement implique un classement, car on doit bien placer et aligner les objets pour optimiser le stockage à l’intérieur du panier. Pour Dagognet, «la conduite du panier ou du transfert -premier médium- ouvre la voie au psychisme: nous sommes déjà sur la pente du récit, qui véhicule à sa manière la scène vue, qui la transmet, mais dans le temps» (9). Contrairement à la fugacité de la parole, la matérialité du panier, comme celle de l’écriture, permet de vaincre l’espace et le temps, de franchir les distances et de franchir le temps. Cependant, selon lui, l’iconographie est encore plus adaptée que l’écriture pour le faire, car elle permet de tout saisir d’un seul coup contrairement à un long discours linéaire dont le début et la fin sont séparés par un long intervalle de temps. L’image ou l’iconographie permet d’échapper à la linéarité du discours et introduit une dimension supplémentaire, c’est-à-dire une spatialité. Par opposition au texte descriptif, il revendique une «iconicité géométrale et abréviative» comme source d’avancement de la science et des connaissances. Par son travail de condensation et de traduction des multiples informations, la représentation iconographique révèle les liens qui les unissent et met de l’ordre en résumant le désordre de la multiplicité du monde. L’image emmagasine davantage d’information que l’écriture linéaire et la livre rapidement d’un seul coup. Ce qui est le propre de la métaphore. D’ailleurs, à cet effet, pour décrire sa conception de l’iconographie, Dagognet recourt à plusieurs analogies entre celle-ci et les processus littéraires. Avec certaines formes de littérature, et plus particulièrement certaines formes de poésie,
l’écriture enfin se libère de ses fonctions et de ses limites, tente surtout, en dépit d’une servitude séculaire et d’une linéarité qui l’écrase, de dessiner des «figures», donc, de transmettre un message plus «volumineux» que le sens mono-directionnel, charrié par une kyrielle de prédicats. (Dagognet: 81)
Ce que fait Flaubert avec la figure de l’arbre en est une bonne illustration. Évidemment, comparé à l’iconographie, le récit de Bouvard et Pécuchet est linéaire et son appréhension prend une certaine durée. De plus, le sens des images décrites dans cette analyse ne se donne pas à voir dans une immédiateté instantanée. Néanmoins, elles ajoutent du volume et une dimension supplémentaire au texte: «le spatial dans le temporel du successif» (Dagognet: 12); une spatialité signifiante. Comme Flaubert, François Dagognet vise à «confondre “art et science”» et à « approcher tous ces travailleurs du “multi-axial”» (12). Le multi-axial faisant référence aux axes vertical et horizontal du schéma de Jakobson, à «l’insertion du métaphorique dans le positionnel» (12).
Le propos de François Dagognet rejoint celui que tient Nietzsche à propos du langage, qui, parce qu’il n’est qu’une convention arbitraire, n’a qu’un rapport indirect avec la réalité. Pour Nietzsche, l’erreur des hommes serait de vouloir fonder une vérité à partir du langage. Les vérités ne seraient qu’«une multitude mouvante de métaphores» et «des illusions dont on a oublié qu’elles le sont» (Nietzsche, 1873: 212).
La «chose en soi» (qui serait précisément la vérité pure et sans conséquences) reste totalement insaisissable et absolument indigne des efforts dont elle serait l’objet pour celui qui créer un langage. Il désigne seulement les rapports des hommes aux choses, et pour les exprimer il s’aide des métaphores les plus audacieuses. Transposer une excitation nerveuse en une image! Première métaphore. L’image à son tour transformée en un son! Deuxième métaphore. Et chaque fois, saut complet d’une sphère à une autre, tout à fait différente et nouvelle. (Nietzsche, 1873: 210)
Ainsi, l’image, première métaphore, serait plus proche de la vérité et de la réalité que le langage. Il est à se demander si une image créée par le langage, telle que celles que fait Flaubert, éloigne de la vérité d’une sphère supplémentaire ou si au contraire, elle permet de rétrograder vers la première transposition de l’excitation nerveuse. Nietzsche stipule que la vérité se trouve du côté des fictions, car elles montrent ce qu’est réellement le langage: feinte, mensonge, dissimulation et anthropomorphisme, et que la littérature exploite le plein potentiel de cette caractéristique du langage. Il est par conséquent possible de croire, qu’aux yeux de Nietzsche, le travail que fait Flaubert avec le langage se rapproche beaucoup plus de la vérité que le travail littératien des scientifiques.
L’arbre comme marchandise
Pour terminer, il s’agira de voir comment le propos que Flaubert a condensé dans les différentes images de l’arbre tout au long du récit est condensé à nouveau et synthétisé dans l’image concise produite par les deux premières phrases de l’incipit.
Comme il faisait une chaleur de trente-trois degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses étalait en ligne droite son eau couleur d’encre. Il y avait au milieu, un bateau plein de bois, et sur la berge deux rangs de barriques. (Flaubert: 45)
On peut rapidement remarquer qu’il est plus important pour Flaubert d’indiquer la température de trente-trois degrés que la date -que le lecteur connaîtra tardivement dans le récit. La chaleur, qui est une énergie nécessaire à la vie, serait plus importante que le découpage historique. Le boulevard Bourdon relie la place de la Bastille et le jardin des plantes, deux grandes institutions littératiennes: l’une représentant les sciences de l’histoire et l’autre les sciences naturelles. Il est bordé tout au long par le canal Saint-Martin. Un canal est construit dans le but de permettre, malgré les différents niveaux d’eau, le passage de bateaux transportant des marchandises. Ici la circulation est arrêtée, car les écluses sont fermées, le bateau est enfermé et immobile. L’image décrite par Flaubert (où il n’y a aucun mouvement, où tout est immobile, le boulevard est par ailleurs désert) montre un bateau de marchandises, soit l’équivalent du panier de Dagognet, de l’écriture. Il est immobilisé par les écluses et repose sur une eau couleur d’encre. L’encre apparaît ainsi comme une force ou énergie, potentielle et en attente, qui peut transporter le bateau, qui est le médium, le livre écrit. Et que contient ce bateau-livre immobilisé entre les institutions littératiennes? Du bois, des morceaux de l’arbre de la connaissance et de l’arbre généalogique transformés en marchandises; des fragments de réalité, de savoir et de vie. En remplaçant l’eau du canal par de l’encre dans sa métaphore, Flaubert utilise l’écriture contre l’écriture. On voit une longue ligne droite et noire, vierge de potentialité, et qui peut donc servir à plusieurs choses. Elle n’est pas, contrairement au bateau-livre, un médium, mais elle est de l’énergie brute en dormance. Avec de l’encre, Flaubert dessine une image, une métaphore, qui montre que, bien qu’elles aient l’ambition de développer un savoir totalisant, les institutions littératiennes du savoir, fragmentent la réalité, le vivant, les découpe en morceaux, en marchandises, et créent une forme de stagnation, voire de régression. Comme cela a été vu avec le désastre en arboriculture, et avec la rupture de la filiation de l’arbre généalogique de Bouvard et Pécuchet, les institutions issues de la raison graphique portent atteinte à la vie même, à sa multiplication; elles transforment le vivant en marchandises, il est même possible d’ajouter qu’elles le tuent.
Conclusion
Au XIXe siècle, l’arbre de la connaissance et de la généalogie étant un mélange synchronique et contradictoire d’idéalisme, lignes verticales, et de matérialisme, lignes horizontales, le récit de Bouvard et Pécuchet, en plus de l’abattre, le dépouille de ses branches et le transforme en poutre bien droite. Il récuse ainsi l’un comme l’autre, ce qui induit qu’il conteste toute notion d’essence, et ce, peu importe qu’elle soit transcendante ou immanente, peu importe qu’elle existe avant ou après la matière. L’arbre de la liberté, qui représente les abstractions conceptuelles de liberté, égalité et fraternité produites par les institutions politiques littératiennes ne résiste pas à l’épreuve de la réalité et est également abattu, mais réduit de surcroît en morceaux de bois de chauffage, en marchandise. Il en est de même dans l’épisode amoureux, où l’arbre généalogique, plutôt que de pousser et produire des fruits, est aussi abattu ou bien découpé en morceaux, réduit à du bois d’allumage, à un levier de pompe ou à un meuble qui, illustrant des scènes généalogiques, est rongé par les mites et tombe en morceaux.
L’abattage, l’équarrissage, l’ébranchement et la transformation en marchandise -il est important d’ajouter que le papier, sur lequel on écrit, est, à partir de cette époque, fabriqué à partir d’une pâte faite d’infimes particules de bois- réservés à la figure épistémique de l’arbre peuvent être vus comme une opposition au classement et aux cloisonnements des disciplines, mais également comme une opposition à toute notion d’essence. Selon cette analyse, Flaubert contesterait toute essentialisation, d’ordre physique ou métaphysique, de la matière et de la vie. Bref, il conteste la façon dont on use de l’écriture. L’arbre de vie, c’est-à-dire comme image de l’énergie qui constitue la matière et la vie, étant le seul à survivre au récit, dans l’épisode de guérison magnétique, donne à croire que ce qui importe, ce sont les pulsions organiques et l’énergie vitale. Par ailleurs, après avoir pris connaissance de leurs pulsions libidinales, Bouvard et Pécuchet semblent plus intelligents et indépendants d’esprit, ont un contact plus direct avec la réalité et moins médiatisé par le livre, comme si le fait de prendre conscience de leur corps, de ses sensations et de ses pulsions a équilibré leur côté littératien, trop dominant. De fait, la raison graphique ainsi que les listes, les sous-ensembles et la pensée conceptuelle, qui en sont issus, fragmentent la réalité et ne tiennent pas compte de la réalité du corps et de ses pulsions organiques, d’où la figure épistémique de l’arbre fragmenté.
En mariant la littérature et les sciences, à la fois dans la forme et dans le contenu, Flaubert réussi son pari: le savoir globalisant qui en résulte ne fragmente pas la réalité et est ainsi beaucoup plus signifiant que celui du discours scientifique.
Bibliographie
- 1Jean-Marie Privat, «Un habitus littératien?», La littératie autour de Jack Goody dans Pratiques, décembre 2000, n° 131-132.
- 2Michel Serres cité par Haberl, op. cit., p. 127.
- 3U. Sprenger, cité par Haberl, op. cit., p. 134.
- 4Il est vrai que dire Pécuchet et Bouvard pourrait sembler moins naturel. Serait-ce dû aux effets de la raison graphique?
- 5Cité par Haberl, op. cit., p. 134.
- 6Genèse 2, 8-9
- 7Nous soulignons
- 8Nous soulignons
- 9Nous soulignons
