Entrée de carnet
La porosité des frontières dans «La Terre» d’Émile Zola
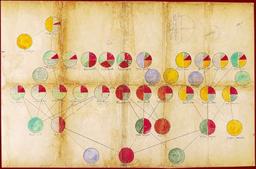
L’anthropologue Jack Goody a remis en question la séparation nette entre sociétés orales et sociétés écrites en affirmant que les partages dichotomiques sont propres à la pensée écrite, et qu’il ne convient pas toujours d’appréhender le monde par le biais de catégories déterminées et opposées.
Cet article a été rédigé dans le cadre d’un séminaire dirigé par Véronique Cnockaert intitulé «La raison graphique dans quelques romans du XIXe siècle» (UQAM, automne 2012).
Dans La Terre d’Émile Zola, la transmission intergénérationnelle des terres agricoles peut être envisagée comme le théâtre où évoluent les personnages en fonction de plusieurs pôles traditionnellement opposés: le besoin d’unité et les droits individuels, les rôles masculins et féminins, et la loi et la coutume. La transgression des limites entre catégories est analysée ici à la lumière de quatre enjeux fondamentaux qui nous parviennent depuis la préhistoire: la transmission du savoir, la menace du meurtre et l’angoisse devant la mort, la nécessité de la loi, et la beauté de l’art. Invention qui marque la fin de la préhistoire, l’écriture nous permet de réfléchir à notre passé et de prévoir notre futur grâce à l’accumulation d’un savoir inaltéré et à la mise en place d’une pensée autonome et permanente; cependant, par la création littéraire, elle parvient aussi à ébranler les frontières dressées entre ce que les humains, précisément à cause de la pensée écrite dominante, considèrent comme des contradictions irréconciliables.
De la culture agricole à la culture écrite
L’ère néolithique débute avec l’invention de l’agriculture, qui entraîne comme conséquence première la sédentarisation de l’humain. Les paysans, contrairement aux chasseurs, doivent organiser leur protection, autant à l’interne que face à l’étranger. L’ordre et la paix, pour être maintenus, demandent l’établissement d’une administration collective, afin que soient gérés les impôts soutenant l’infrastructure policière ou militaire. L’État est ainsi créé, et avec lui, comme outil de gestion nécessaire, advient l’écriture. C’est ce qui permet aux auteurs Jean-Claude Barreau et Guillaume Bigot d’affirmer que «la révolution agricole entraîne donc l’invention de l’écriture» (Barreau, Bigot, 2005: 30). D’ailleurs, cette correspondance s’illustre bien par le fait que le terme «culture» renvoie autant à l’agriculture qu’à la production écrite.
Si la sédentarisation marque le début de l’ère néolithique, l’invention de l’écriture indique, pour la plupart des historiens, la fin de la préhistoire. Cette distinction est toutefois problématique. Premièrement, tracer une ligne claire délimitant d’un côté la préhistoire et l’oralité, et de l’autre l’histoire et l’écriture, revient à dire que les peuples sans écriture font partie de la préhistoire, ou encore, que l’oralité n’est que le stade évolutif qui précède l’écriture. Deuxièmement, cela suppose que les peuples oraux ne possèdent ni histoire ni intellectualisme, alors que nous savons depuis les travaux de Jack Goody qu’«il y a une activité intellectuelle dans les sociétés sans écriture» (Goody, 1979: 62).
En réalité, l’attitude intellectuelle qui consiste à tracer une ligne définie entre une époque et une autre est mise à l’épreuve par Goody, qui doute «que le recours aux partages dichotomiques ait quelque pertinence quand on se propose d’étudier le développement des formes de connaissance». (245) En effet, Goody postule que les modes de production de la pensée influencent le contenu de la pensée; autrement dit, les catégorisations auxquelles les sociétés écrites (historiques/civilisées) soumettent les sociétés orales (préhistoriques/primitives) sont un produit de la pensée écrite. L’écriture, parce qu’elle constitue un moyen particulier d’enregistrement et d’analyse de l’information, mène les sociétés qui la possèdent à tirer des conclusions parfois inadéquates sur les sociétés qui ne la possèdent pas, et à envisager ces dernières en fonction d’une «typologie qui scinde en deux l’ensemble des sociétés au lieu de les situer relativement à deux pôles». (246)
Le roman La Terre d’Émile Zola, publié en 1887, dresse un portrait du monde rural du XIXe siècle. L’action se situe dans un village agricole de la Beauce, et se déroule vers les années 1860. Depuis la Révolution, les changements de régime ont été nombreux, et l’industrialisation chamboule le mode de vie relativement stable des siècles précédents, basé principalement sur une pratique artisanale de l’agriculture. Les mœurs et les coutumes ne correspondent pas aux comportements que tente d’imposer la récente infrastructure légale française: oralité et littératie créent de fortes tensions à travers lesquelles la communauté tente de redéfinir les rôles et possibilités de chacun. Dans cette analyse, plutôt que de chercher à déterminer ce qui appartient aux pratiques orales ou aux pratiques écrites, il conviendra d’étudier dans quelles mesures ces différents aspects se marient dans le texte et comment les personnages se positionnent par rapport à certains pôles que les anthropologues pourraient qualifier de «primitifs» ou d’«évolués».
Comme le soulignent Barreau et Bigot: «Ainsi la préhistoire n’est-elle pas un univers étranger. De grandes questions toujours actuelles y sont déjà posées: la menace du meurtre, la nécessité de la loi, la beauté de l’art, l’importance vitale de la transmission du savoir» (Barreau, Bigot, 2005: 25). Ces quatre questions constituent en quelque sorte un schéma des attributs propres à l’humanité. Combinées à une approche de lecture inspirée des études sur la raison graphique, elles permettront ici de vérifier l’hypothèse suivante: La Terre d’Émile Zola nous rappelle que malgré les efforts de catégorisation des sociétés dites «civilisées», il y aura toujours du «primitif» dans l’homme, et que c’est précisément la porosité des catégories (sexuelles, politiques, historiques, jurales, etc.) qui fait la spécificité du genre humain.
L’importance vitale de la transmission du savoir
Jack Goody propose de définir la culture comme une série d’actes de communication, et souligne l’importance des modes de production de ces communications. Selon lui, le progrès de la connaissance consiste non seulement en un changement de contenu, mais aussi en un processus lié aux «modes de communication grâce auxquels les hommes sont en interaction mutuelle et plus particulièrement se transmettent de génération en génération leur culture et leurs modèles de comportement» (Goody, 1979: 86). Dans La Terre, la culture se transmet par la culture: avec la terre partagée et transmise se passe tout un système de codes et de comportements, c’est-à-dire, une culture au sens plus large.
Signe culturel par excellence, la ligne droite, qui n’existe pas dans la nature, s’impose dans les sociétés écrites, où la conception linéaire du temps porte à adopter les termes de «lignée», «descendance» et «ascendance» pour parler d’hérédité et d’héritage. Il semblera donc évident que la transmission des savoirs et de la culture s’effectue sur un axe vertical, très clairement défini dès les premières pages du roman. L’incipit met en scène le personnage principal, Jean Macquart, ouvrier agricole et ancien soldat, alors qu’il est occupé à semer une petite parcelle de terrain appartenant à M. Hourdequin, son patron. À travers l’omniprésence de l’horizontalité (de nombreux termes en témoignent, parmi lesquels «plaine», «s’étendait», «ciel vaste», «étalaient», «terres nues», «sans un coteau», «à perte de vue», «la ligne d’horizon», «terrains plats», etc.) (Zola, 1887: 27-29), quelques lignes verticales discrètes s’élèvent. Par exemple, les poteaux du télégraphe, toutefois soumis à l’horizontalité de la route droite qui en «déroule le défilé géométrique» (28). Les «trois ou quatre moulins de bois, sur leur pied de charpente, les ailes immobiles» (28) n’impressionnent pas, et leur immobilité témoigne d’une désuétude pressentie. Il y a bien aussi un clocher qui émerge au loin, grâce à un «pli de terrain»; mais cette église dont on ne voit que le bout qui dépasse, ces moulins immobiles, et la veste d’ordonnance que Jean «achève d’user» (28) renvoient à des institutions d’une époque qui touche à sa fin. Cette parcelle trop petite pour que le maître y envoie le semoir mécanique préfigure un monde replié sur lui-même, en voie de disparition. Les grands peupliers, quant à eux, poussent dans le vallon et on n’en voit que les cimes : la nature, ici, ne promet pas d’être plus forte que la culture. Le mouvement de Jean, qui se déplace du Nord au midi et du midi au Nord, pourrait représenter un mouvement vertical, si on le plaçait sur une carte géographique. Mais Zola a situé l’action de son roman dans la Beauce, une région naturelle de la France, et non dans un département délimité par des frontières culturelles. Rien, ici, n’appelle à considérer le territoire comme une carte géographique, les points cardinaux n’étant utilisés qu’à des fins descriptives.
Pourtant, l’église du village fictif de Rognes dresse haut «son clocher de pierres grises, habité par des familles de corbeaux très vieilles» (28). La ligne verticale sur laquelle s’effectuera la transmission s’impose soudainement dans cet univers baigné d’horizontalité; il ne s’agit pas de l’institution religieuse, mais plutôt de ces «familles de corbeaux très vieilles» qui évoquent bien évidemment les familles paysannes. La véritable verticalité, celle qui déploie sa force dans le roman et sur laquelle les personnages se déplaceront, c’est la ligne généalogique, l’hérédité, la filiation.
La solitude de Jean, présentée au premier paragraphe, se trouve brisée juste avant qu’il n’aperçoive Françoise: «de toutes parts, on semait.» (29) Cependant, les semeurs qui se multiplient autour de lui «s’enfoncent» (29) dans la terre horizontale, annonçant que pour Jean, l’étranger, s’inscrire sur l’axe vertical de la famille paysanne ne s’effectuera pas comme il l’aurait désiré.
On pourrait être tenté d’imaginer que la transmission se fait, sur l’axe vertical, du haut vers le bas. Mais la terre, symbolisant la transmission de la culture et représentée par la ligne horizontale, est immobile. Ce sont les humains qui tendent vers elle, dans un mouvement vers le haut, une génération devant «dévorer» la précédente pour accéder au savoir qui se prend plus qu’il ne se reçoit. Lors du partage difficile de sa terre entre ses trois enfants, le vieux Louis Fouan ressent une colère grandissante «devant l’enragement de cette chair, qui était la sienne, à s’engraisser de sa chair, à lui sucer le sang, vivant encore. Il oubliait qu’il avait mangé son père ainsi.» (53) Les nombreuses occurrences dans le roman des verbes «manger» et «dévorer» sont frappantes : «Ces deux-là se mangeaient…» (229), «Ça n’en finit jamais, ça nous mange la peau du corps!» (401), «Et elle n’avait de la sorte pas de plus gros amusement que de voir la famille se manger» (407), «Dévorons-nous les uns les autres!» (172), «il y en avait toujours deux qui se mangeaient, (…) quand les trois n’étaient pas à se dévorer ensemble» (328), etc.
«Avalements», écrit René Lapierre dans L’atelier vide. «Il s’agit donc de manger. La recette ordonne la chose en deux temps: dévoration, puis assimilation.» (Lapierre, 2003: 15) L’acte de manger comprend bel et bien le morcellement de ce que l’on mange, puis son intégration dans un nouveau tout constitué de soi et de l’autre. Il y a donc une quête d’unité dans cette ascension vers la terre, une unité qui, paradoxalement, doit passer par le fractionnement. Lapierre, dans Renversements cette fois, rappelle que «c’est une chose qui déborde la logique, une chose qui dit que pour être avec je dois à tout moment être séparé, que je ne peux pas être avec dans le plein» (Lapierre, 2011: 65).
Être avec/être sans: il s’agit d’une forme d’opposition binaire, caractéristique selon Goody des sociétés littératiennes. Goody l’explique bien quand il fait état de l’opposition «Nous/Eux, qui est à la fois binaire et ethnocentrique» (Goody, 1979: 35): sans «eux», il ne peut y avoir de «nous». Si la classification est inhérente au langage, l’écrit lui confère une rigidité, et même une essentialité, qu’on ne retrouve pas dans l’oralité. Si le «plein» ne peut exister sans le «vide», le «complet» ne peut pas non plus exister sans le «divisé». Le rêve d’une terre complète et entière, dans une société littératienne, ne peut exister que s’il est opposé à l’idée d’une terre partagée; car chaque terre «complète» convoitée n’est, après tout, que la terre divisée de la génération précédente.
Le rituel de dévoration qui a lieu dans La Terre fait office de coutume maintenant en place une utopie d’unité qui se superpose aux modèles sociaux révolus, soit la monarchie et la religion. Auguste Dezalay, dans l’article «Noblesse(s) du naturalisme», remarque d’ailleurs très justement que dans La Terre, «le problème du remplacement d’une noblesse par une autre est une fois de plus très clairement posé» (Dezalay, 1994: 100) . En effet, avant que les paysans ne se dévorent entre eux, ils devaient subir «trois carnassiers dévorants sur le même corps: le roi avait le cens et la taille, l’évêque avait la dîme, le seigneur imposait tout, battait monnaie avec tout.» (Zola: 100) Alors qu’avant, l’aîné héritait du domaine et que les autres enfants se mettaient au service du Roi, de l’Église, ou de l’armée, la terre est désormais coupée, partagée, puisque les individus, fils comme filles, nobles comme paysans, sont réputés égaux depuis la Révolution.
Malgré l’institution de ce nouveau code légal qui modifie une coutume ancestrale, la tâche demeure difficile: «Ça aurait encore pu marcher, si l’on s’était entendu avec les enfants…» (Zola: 46), regrette Fouan. Il faut donc avoir recours à un personnage littératien, le notaire, pour s’assurer que la dévoration se fasse selon les normes admises, ce qui vaut tout de même mieux que d’être «mangé» par l’étranger : «Mais, quoi? voulez-vous que je prenne du monde, des étrangers qui pilleront chez nous? Non, les serviteurs, ça coûte trop cher, ça mange le gain…» (46). Selon les principes égalitaires de la Révolution, un étranger au clan devrait équivaloir à un fils ou une fille; pourtant, les mœurs ordonnent de privilégier la dévoration par les siens à la saisie de la culture par l’étranger.
La famille, symbole par excellence d’une unité qui doit se briser pour que se créent d’autres unités, se retrouve «au grand complet» (87) au rendez-vous chez les parents, afin de procéder au tirage des lots. L’arpenteur Grosbois a fait son travail de mesure du terrain; les lignes droites ont été tracées, comme autant de coups de couteau, sur la grande terre familiale. Les trois parties du terrain sont définies par comparaison et opposition, et un rituel est nécessaire pour que ces parcelles, de morceau d’un tout éclaté, deviennent à leur tour unité de la famille qui les possèdera. Les objets de ce rituel: une feuille de papier blanc, un encrier et une plume, «choses rares dans cette pièce enfumée» (87), ainsi que le chapeau de l’expert arpenteur, chapeau ici comparé à une urne. On est en droit de se demander quelles cendres contiendra cette urne, si ce n’est celles du corps commun familial, représenté par ce papier qui sera tranché en trois morceaux numérotés, mis dans le chapeau pour effectuer le tirage au sort.
Buteau, quand il constate qu’il est pris avec le lot qu’il ne voulait pas, s’en plaint ainsi: «À vous tous, vous me mangeriez…» (89). Comme il refuse de tirer son numéro, l’arpenteur suggère au père de le tirer à la place du fils. Le rituel achoppe : le fils accuse les autres de le manger alors qu’en fait, c’est le père qui doit être mangé, et le père tire le numéro alors que ce devrait être au fils de le faire. Avec cette inversion des rôles, le mouvement normal sur la ligne verticale est entravé.
La méfiance des paysans devant l’arpenteur (le savant), qu’on compare à un «faiseur de tours» et qu’on soupçonne de «tricherie», illustre une tension qui rappelle la catégorisation des sociétés orales et écrites, la première associée à la pensée magique, la seconde à la connaissance scientifique (Goody, 1979: 48). Mais plutôt que de conclure à une opposition structurelle et conflictuelle entre ces éléments, il conviendrait ici de dénoter la très riche hybridité littératienne de cette scène. Jean-Marie Privat propose de délaisser «la querelle idéologique et spéculative de l’opposition massive entre cultures orales et écrites (…) en prenant en compte le fait qu’il y a des degrés dans la littératie (et par conséquent dans l’oralité)» (Privat, 2006: 126). L’arpenteur, le papier, la plume, et les lignes droites qui partagent la terre et l’acte du notaire qui n’attend que les numéros et les signatures sont des éléments qui présentent un «très fort taux de littératie» (126); mais la présence nécessaire des corps, le numéro énoncé à voix haute après chaque pige (et ce, même pour le troisième et dernier lot, dont on connaît pourtant le nombre), les silences nombreux qui ponctuent le rituel, ainsi que l’ambiguïté du résultat et sa réinterprétation par Buteau sont des preuves d’un degré élevé d’oralité. Ces éléments ne s’opposent pas; plutôt, ils créent ensemble la culture nécessaire pour que la loi et la coutume puissent être toutes deux respectées dans la transmission du savoir et de la pratique.
Seule transmission qui échappe aux normes paysannes, celle de l’héritage d’Élodie, la petite-fille des Charles, propose une ouverture dans la société paysanne fermée sur elle-même. Laure, la sœur cadette de Louis Fouan, a épousé Charles Badeuil, un petit commerçant avec qui elle a fondé une maison close qui a fait leur richesse. Malgré qu’ils aient tenté de maintenir leur fille Estelle, puis leur petite-fille Élodie, dans l’ignorance de la véritable mission de leur commerce, toutes deux finissent par reprendre l’établissement et le faire fructifier. À la fin du roman, le cousin Nénesse vient demander la main d’Élodie à M. Charles, ce qui trouble profondément la jeune fille. Sa grand-mère la console: «On ne te mange pas, parce qu’on te demande en mariage…» (Zola: 521). Après avoir accepté la proposition, c’est Élodie qui insiste pour que la maison close constitue sa dot. En affirmant «Je veux être comme maman» (524), elle crée une grande émotion chez ses grands-parents, qui vibrent à l’idée que «leur œuvre, leur chair, allait être sauvé de la ruine. Élodie et Nénesse, avec la belle flamme de la jeunesse, y continueraient leur race.» (525) L’unité est préservée: «Ils ne firent plus qu’un groupe, leurs pleurs se confondirent.» (525)
Élodie, comme les deux générations de femmes qui l’ont précédée, échappe à la terre et à la nécessité de morceler avant d’unir. Le savoir dont on l’a préservée, qu’on a tenté de ne pas lui transmettre, lui parvient toutefois, sans que ses parents ou grands-parents ne soient dévorés, car cette famille a compris que «l’éducation ne signifiait rien, c’était l’intelligence qui décidait de tout» (524), l’intelligence de savoir quand transcender les catégories. Cette filiation, matrilinéaire de surcroît, sera la seule du récit à se solder en succès.
La menace du meurtre et l’indifférenciation des genres
À l’opposé de cette filiation réussie se trouve celle de la Grande, la sœur aînée de Louis, Michel et Laure Fouan. Matriarche à la poigne de fer, elle représente une version féminine de l’autorité despote que la Révolution a tenté d’éradiquer avec la chute du roi. «Très droite, très haute, maigre et dure, avec de gros os, (…) la tête décharnée d’un oiseau de proie, sur un long cou flétri, couleur de sang», la Grande apparaît en effet comme une caricature des races royales, comme le remarque Auguste Dezalay quand il fait état du trait physionomique caractéristique des Fouan, le «gros nez des Bourbon» recourbé chez la Grande en un «bec terrible» (1996: 100). La Grande est aussi celle qui comprend les codes, qui les manie dans le but avoué de créer du désordre, par exemple lorsqu’elle met à profit son intelligence littératienne pour exacerber le conflit entre ses nièces Lise et Françoise. Son corps «de bâton séché, où seule demeurait la carcasse fendue de la femelle» (Zola: 451), droit et dur comme une ligne, apparaît clairement comme un corps asexué, littératien.
La Grande tourne le dos à la coutume, elle refuse de se faire dévorer: «On m’aurait saignée, moi, que j’aurais dit non sous le couteau…» (58) Elle n’a aucun scrupule à renier les mœurs, à refuser que sa descendance lui survive, allant jusqu’à assassiner son petit-fils. De plus, elle ne s’émeut pas de sa propre finitude: «Elle ne se préoccupait de sa mort que pour laisser à ses héritiers le tracas de procès sans fin: une complication de testament ordinaire, embrouillée par plaisir, où sous le prétexte de ne faire du tort à personne, elle les forçait à se dévorer tous.» (407)
Or, «qu’est-ce que l’homme? Un être qui sait qu’il va mourir et qui a besoin de se raconter des histoires.» (Barreau, Bigot: 18) Si le langage trace une ligne qui sépare l’humain de l’animal, c’est parce que le symbolisme que permet la communication langagière libère l’homme de la suprématie du temps présent. En effet, le langage, et à plus forte raison l’écriture, permettent de comprendre le passé et modifient notre façon d’envisager l’avenir. Avec cette prise de conscience, l’angoisse de la mort ne coïncide plus nécessairement avec l’instinct de survie. Un animal ne craint la mort que lorsqu’il la sent venir; l’homme comprend qu’elle peut surgir quand il ne l’attend pas, et il comprend aussi qu’il peut la causer.
Si l’homme a besoin de se raconter des histoires pour «supporter cette idée insupportable de la finitude» (19), la Grande, quant à elle, ne ressent nullement ce besoin. Ni passé, ni avenir: autant sa descendance, qui pourrait témoigner de son existence, que sa propre mort, ne lui sont d’aucun intérêt. Zola, avant de ne plus désigner ce personnage presque inhumain que par son surnom, lui a attribué le prénom de Marianne: elle est donc le symbole double de la monarchie et de la République, ce qui apparaît chargé de sens dans le contexte du Second Empire où les conséquences de la Révolution et des instabilités politiques qui l’ont suivie ne mènent pas à la liberté, à l’égalité et à la fraternité promises, particulièrement en ce qui concerne la place de la femme dans la société publique. Plutôt que le partage, ce que Marianne offre, c’est un despotisme digne de l’aristocratie, qui mène hommes comme femmes à s’entredévorer comme des bêtes.
Si l’homme invente des récits pour conjurer l’angoisse de la mort, il cherche aussi à répondre à la question de l’origine. Dans Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci, Freud avance que cette question vouée à demeurer sans réponse alimente la capacité du sujet à conserver son désir de savoir et à explorer (Freud: 1910). Or, l’énigme de l’origine correspond à celle de la féminité. Naomi Schor affirme que «le mystère de la féminité ramène fatalement au mystère, voire au mythe des origines» (Schor, 1976: 184), mystère qu’elle lie ensuite à celui de la différentiation sexuelle dans l’œuvre de Zola, tel que l’écrivain l’annonce dans la préface du Roman d’un Inverti. Dans son analyse du roman Une page d’amour, Schor souligne la substitution par Zola du triangle mère-amant-fils, très présent dans la littérature du XIXe siècle, par un rapport oedipien où la fille prend la place du fils. Ce triangle mère-amant-fille peut se superposer au triangle formé par Françoise, Lise et Buteau dans La Terre. Après la mort de leur père, les sœurs connaîtront leur première querelle «sous ce coup de fouet du tien et du mien» (Zola: 154) qui les positionne l’une et l’autre à différents niveaux de l’axe familial vertical, Lise traitant sa soeur de gamine et assumant une posture autoritaire qui siérait mieux à une mère qu’à une soeur. Puis, après le mariage de Lise, le couple qu’elle forme avec Buteau jouera un rôle parental, puisqu’ils considèrent que la part de Françoise leur revient, c’est-à-dire que les terres qui devraient constituer deux entités n’en forment qu’une à leurs yeux. Aborder cette relation triangulaire d’un point de vue psychanalytique permet d’émettre l’hypothèse d’un refus de séparation éprouvé par Françoise. En effet, Schor soutient que l’énigme de la féminité se logerait dans la phase pré-oedipienne, que Freud appelle aussi «préhistoire» de la femme, et qui est «marquée par un attachement exclusif à la mère, (…), [n’admettant] aucun partage» (Schor, 190). Jeanne, le personnage d’Une page d’amour, meurt «de ne pas avoir pu garder l’exclusivité de sa mère»; Françoise, quant à elle, ne meurt pas d’avoir assisté à la scène primitive1Aux pages 225 et 226 du roman, Françoise ressent une grande colère à se voir imposer les ébats amoureux de sa sœur et de Buteau., mais bien d’y avoir pris la place de sa sœur lorsque son beau-frère la viole– et d’en avoir éprouvé du plaisir.
Schor déplore que l’on n’ait pas «suffisamment insisté sur l’indifférenciation sexuelle qui envahit l’univers zolien» fortement teinté par un «siècle de remise en question des rôles sexuels» (Schor: 184). Elle remarque que «tout se passe comme si, dans un premier temps, la femme chez Zola se voulait homme (…), ou plus exactement, comme si Zola ne voulait pas reconnaître la différence» (185). Ce siècle de remise en question débute avec la Révolution française, qui précède la parution de La Terre de presque exactement cent ans. Bien que les femmes aient pris part de façon active et politique à ce grand renversement, elles se sont rapidement trouvées confinées au monde privé. En effet, la Déclaration des droits de l’homme visait à affaiblir le rôle du père (dans la sphère familiale comme politique), et l’émancipation que le principe d’égalité aurait pu fournir aux femmes n’a été dans les faits qu’une conséquence de cette attaque à la figure principale d’autorité. Conséquence vite désavouée, puisque les femmes révolutionnaires comme Olympe de Gouges sont guillotinées sous toutes sortes de prétextes, sans que soit nommée la véritable raison de cette mise à mort: en fait, ce qu’on ne leur pardonne pas, c’est de révéler «les contradictions et les exclusions dissimulées par les affirmations prétendument universalistes de la Déclaration des droits de l’homme» (Martin, 2008: 96). La différence entre les genres servira à remplacer la différence entre les classes sociales. Or, maintenir à tout prix une différence, quelle qu’elle soit, participe à une appréhension littératienne du monde, tel qu’expliqué précédemment par le principe de catégorisation. Dans La Terre, on assiste effectivement à un brouillage de cette catégorisation genrée. Schor avance que Zola, malgré avoir affirmé en 1869 qu’il ne fait «qu’un des hommes et des femmes»2Émile Zola, Différences entre Balzac et moi, cité par Schor, op. cit., p. 185., finit par «enfermer» la femme dans la maternité, dans «une tentative désespérée d’instaurer la différence là où elle manque, où elle fait défaut» (Schor: 185); pourtant, l’absence presque totale de sentiments maternels dans La Terre impose une autre lecture du féminin. En effet, outre la féminité extrêmement problématique de la Grande et sa symbolique double, l’inventaire des mères de ce roman dresse un portrait troublant de la maternité: Rose, la femme de Louis Fouan, est une mère effacée, craintive devant son mari dont elle n’est que l’ «écho» (Zola: 163), ayant élevé ses enfants avec rudesse et froideur; de la mère de Françoise et Lise, on ne sait rien sinon que c’était une «amoureuse» peu fortunée; la Grande abandonne sa fille et ses petits-enfants à une misère atroce avant de tuer son petit-fils Hilarion lorsqu’il tente de se venger des mauvais traitements qu’elle lui inflige; Françoise porte «un de ces enfants faits sans plaisir, qui ne donnent que du mal à leur mère» (Zola: 464); Lise est, à chacune de ses grossesses, embêtée par celle-ci (Jules est un bâtard, sa deuxième grossesse lui vaut les insultes de Buteau, et sa troisième finit par un avortement chez une sorcière d’un village voisin); la mère de la Trouille était une femme de passage qui a disparu sans demander son reste; les mères du village ne semblent éprouver un sentiment maternel que lorsque leur réputation est en jeu; et finalement, la venue d’un enfant ne correspond à peu près toujours qu’à une source de problèmes, car plus d’enfants il y aura, plus il faudra couper la terre. Bref, le nouveau contrat familial mis en place après la Révolution, s’il relègue l’honneur familial et la puissance paternelle au rang des archaïsmes, ne réussit pas pour autant à assurer le bonheur individuel et collectif. «La définition de la paternité n’est plus seulement biologique, elle passe par la volonté d’être père» (Martin: 89), ce qui ouvre par contre la porte à tout un lot d’ambiguïtés et d’incertitudes, et distingue grandement le statut du père de celui de la mère, qui ne peut, elle, être mère seulement si elle le veut bien. En effet, on aura beau idéaliser cette idée nouvelle du couple lié par l’amour, ayant accès au divorce, à la légitimation des enfants bâtards, le résultat est peu concluant: l’indéfinition des rôles qui en découle crée son lot de chaos et contrebalance l’ordre qui devait être créé.
Si Marianne Fouan, dite la Grande, est dépeinte comme un corps inhumain, asexué, qui possède le code littératien, le patriarche, quant à lui, perd tous ses moyens et finit sa vie dans une déchéance animale. Fouan, devenu «une vieille bête souffrant, dans son abandon, la misère d’avoir vécu une existence d’homme» (Zola: 461), ne marche presque plus, et ne recherche que des stations qui rappellent l’horizontalité de la terre: les poutres, le pont, le banc de pierre. Et avec la coupure du lien filial par le petit Jules, il perd le langage, il tombe dans «l’absolu silence, sa solitude se trouvant élargie et complète. Jamais un mot, sur rien, à personne.» (464) Il ne fait déjà plus partie du monde des vivants; son assassinat ne compte pour ainsi dire pas. Le roman nous apprend que la ligne tracée entre l’homme et la femme ne propose qu’un ordre factice, puisque le résultat est le même: malgré sa promesse de clarté et de précision, la littératie ne peut empêcher le désordre de percer. Qu’il soit contrôlé par la femme qui sait manipuler, ou subi par l’homme qui ne parvient pas à se défendre de la manipulation, le chaos ne peut être endigué, malgré l’ambition de classification des sociétés littératiennes.
Outre le meurtre de Fouan par son fils et celui d’Hilarion par sa grand-mère, le roman nous donne à lire celui de Françoise par sa sœur. Françoise est enceinte lorsque se produit l’attaque de Buteau et de Lise; c’est le fait qu’elle devienne mère qui menace les Buteau. Alors que le meurtre du père Fouan constitue un acte calculé, celui de Françoise est commis sous le coup de la passion. Se débarrasser de l’autorité du père ne suffit pas pour vivre «entre frères»; il y aura toujours la sœur, dont on ne peut savoir que faire, car sa présence à la fois confirme notre unité (nous/elles) et l’infirme, puisqu’elle en est exclue malgré son appartenance au genre humain, un genre trop totalisant pour permettre à l’individu littératien, au raisonnement binaire, de s’y construire une identité. Si la sœur devient mère, l’unité familiale nouvellement créée la libère de son rôle d’antagoniste, et confine l’unité quittée à accepter son état amputé comme nouvelle entité.
La nécessité de la loi : entre droit et mœurs
Dans ce roman, l’analogie fortement soulignée entre le corps de la femme et la terre, ainsi que le consentement silencieux du corps de Françoise, indiquent bien qu’il ne saurait être uniquement question de droit et de principes dans l’administration d’une société tout aussi régie par les pulsions charnelles que par la raison. Françoise, en acceptant non seulement le viol, mais aussi la mort, recrée une unité symbolique (avec sa sœur) et matérielle (entre les lots de terre), et ce, malgré ce que le droit prescrit.
Tout comme les Charles, à la fin, forment une unité par le verbe «confondre», Lise et Françoise, au début du roman, «se confondaient» (111) dans leur attente de la décision de Buteau. Ce dernier, en épousant Lise, agit comme s’il avait aussi épousé Françoise, bien qu’au fond, ce qu’il désire, c’est garder la terre dont elle est l’héritière. Il adopte un statut double face à la jeune fille: père parce qu’elle est à sa charge, mari parce qu’il voudrait la posséder –ainsi que la terre qui est sienne. Cependant, Françoise a un sens de la justice qui va à l’encontre de cet arrangement qui serait peut-être possible dans une société permettant l’ambiguïté: elle se rebelle à cause d’une de ces «idées de justice, qui, enfant, la ravageaient déjà» (408). Jean, qui lui demande de l’épouser lorsqu’elle sera majeure, lui conseille d’attendre patiemment: «Surtout, ne te revenge pas. La justice sera pour nous, quand nous aurons le droit.» (335)
Cette idée de justice qui «ravage» Françoise ne correspond pas au droit coutumier du pays. Barreau et Bigot, quand ils parlent des sociétés préhistoriques, avancent que l’idée de progrès n’y existe pas, que les transformations n’y sont causées que par des chocs extérieurs, et que «la révolte n’existe pas non plus –du moins la révolte individuelle.» (35-36) Même si cette conception du progrès ne correspond pas aux conclusions de Goody, qui répondrait que notre façon de comprendre le progrès est circonscrite par nos moyens de l’envisager (c’est-à-dire, par l’écrit), et qu’il est donc hasardeux de prétendre que les sociétés préhistoriques ne pouvaient le connaître, l’idée du choc extérieur comme facteur de changement met en lumière l’opposition entre loi et mœurs qui se joue dans la révolte de Françoise, en même temps que la naissance d’une conception individuelle de l’identité.
Cette tentative de transformer le monde n’aura cependant pas le succès escompté, car au moment du viol, Françoise «fut emportée à son tour d’un spasme de bonheur si aigu, qu’elle le serra de ses deux bras à l’étouffer, en poussant un long cri.» (477) Malgré qu’elle attribue elle-même cet orgasme inattendu à un amour inavoué qu’elle aurait porté à son agresseur, l’explication psychanalytique proposée précédemment permettrait de comprendre cette jouissance comme celle, pour Françoise, de se retrouver à la place de sa sœur, de ne faire qu’un avec elle à nouveau. L’effacement de Lise au moment de la mort de Françoise, Buteau restant seul, corroborerait le désir d’unité assouvi, comme si Lise disparaissait avec elle, et que Buteau, nouveau patriarche de cette terre, était aimé parce qu’il occupait la place de celui qui serait à son tour dévoré par ses enfants –et par ses enfants seulement: non par un étranger, un homme «qui venait de traverser son existence par hasard» (485). Le partage que Françoise demandait en était un de droit, de justice, qui dans les faits n’enlevait rien à sa sœur. Le désordre est venu de ce que le rôle que s’est donné Lise, passant de sœur à mère symbolique, a créé une fausse unité entre la part de sa sœur et la sienne. Au moment du viol, Françoise comprend qu’elle ne pourra empêcher la coutume de gagner, qu’elle y est elle aussi soumise : comme le remarque Goody chez certaines cultures orales, «les souhaits individuels du testateur (…) tendent à faire l’objet d’une remise en cause par la pratique du groupe, qui voit la “justice” et la “liberté” en termes différents» (Goody, 1986: 151).
Autre conséquence de l’impuissance de la loi, les contrats légaux du roman sont rarement respectés et varient en moralité, selon les circonstances. En effet, si le notaire encourageait la démission de biens comme une pratique raisonnable au sein de la famille, il la qualifie d’immorale quand elle permet à un étranger de prendre possession de la terre ancestrale3Cette comparaison s’opère entre la scène initiale du roman, lors du partage de la terre entre les Fouan (p. 47) et celle où Jésus-Christ, le fils aîné des Fouan, se défait de la dernière parcelle de terrain qu’il lui reste afin de rembourser des dettes d’alcool (pp. 358-359).. Par conséquent, quand la procédure administrative sert à maintenir la coutume, elle peut être considérée comme morale. Que la loi permette à un étranger de briser l’unité familiale ne l’est certainement pas.
Autre nouveauté depuis la Révolution, la signature devient le seul signe d’identité et de validation des contrats. Or, comme tous les signes d’identité, la signature «révèle une certaine conception sociale de l’identité» (Fraenkel, 1992: 22). La signature, contrairement aux sceaux et aux cachets, donne une place d’honneur à l’individualité. En outre, elle témoigne de la présence du corps, de la valeur du geste. Si, de l’époque romaine au XVIe siècle, l’écrit a toujours accompagné le contrat oral, il ne l’a toutefois jamais surpassé en autorité; la validation de la preuve écrite reposait sur le témoin qui pouvait confirmer ou préciser les termes de la négociation. Paradoxalement, puisque la signature représente la présence du témoin, elle permet à l’écrit de se passer de lui: elle «supplée effectivement à la personne réelle» (Goody, 1986: 152). La validité de l’acte ne dépend plus de la durée de vie du témoin, ni de ses possibles réinterprétations du contrat.
En ce qu’elle valorise l’individualité et sépare le corps de ce dont il est supposé témoigner, la signature procède en quelque sorte à une amputation à la fois sociale et littératienne de l’individu. Sociale parce que l’identité qui est mise de l’avant ne se caractérise plus par son appartenance à un groupe; littératienne parce que la validité du contrat ne dépend plus de la présence d’un corps vivant. Dans la même scène où le notaire condamne la démission de biens amorale à laquelle recourt Jésus-Christ pour payer une dette d’alcool, Fouan, dont la signature doit figurer sur l’acte, doit se faire tenir la main pour signer, ce qui montre bien la relativité de la valeur de l’écrit dans une communauté qui tente de conjuguer normes littératiennes et coutume, où la signature n’est pas nécessairement «l’équivalent du serment oral» (152).
La démission de biens de Jésus-Christ est loin d’être la seule signature problématique du roman. En effet, elles sont nombreuses, et presque toujours accompagnées d’un champ lexical faisant référence à la coupure du corps: ici, Fouan vit la signature comme une «amputation»; quand Buteau et Lise doivent signer le partage, ils s’écrient que «cela les coupe en deux»; Françoise a une coupure profonde au ventre quand elle refuse de signer le testament; Lise affirme que Buteau se ferait «hacher» plutôt que de signer l’acte; et le notaire, gardien par excellence des signatures, se nomme Baillehache, ce qui, en vieux français, se traduit par «donner un coup de hache».
La relative impuissance de la loi face à la coutume se trouve résumée par ce cri de Buteau, alors que Jean lui réclame ce qui lui revient de droit: «L’huissier et les gendarmes, on les envoie chier! Il n’y a que les crapules qui ont besoin d’eux. Quand on est honnête, on règle ses comptes soi-même.» (Zola: 512) Pourtant, régler ses comptes soi-même n’a strictement rien à voir avec l’honnêteté, Buteau étant le personnage le plus malhonnête du roman. La réaction de l’ensemble des villageois le prouvera: faire appel à la loi, dans une communauté imprégnée de coutume, n’est une mesure qu’on approuve que lorsque la loi soutient la coutume, ce qui correspond à l’exact envers de la définition de Barton que Goody juge insuffisante : «Le droit coutumier représente le droit populaire en voie d’être admis.» (Goody, 1986: 136)
Jean, l’étranger, ne comprend de la coutume que ce qui cadre dans cette définition. Par exemple, il met fin à son aventure avec la servante de la ferme où il travaille de la minute où la jeune femme, qui est aussi la maîtresse du patron et qui vise à se faire épouser, parvient à coucher dans le lit de celui-ci: Jean la repousse alors car «du moment que ça devenait sérieux, ça n’était plus propre, décidément, et il ne voulait plus». Autrement dit, du moment que la Cognette couche dans le lit du maître, c’est qu’elle est en voie d’être sa femme; aussi bien dire qu’elle l’est déjà, même si ce n’est encore ni écrit, ni signé.
Il est surprenant que Jean, pour qui la loi et la moralité sont importantes, décide de quitter Rognes sans entamer le procès qu’il comptait faire aux Buteau. Lorsqu’il comprend leur culpabilité dans le meurtre de Françoise, il réfléchit à ce qu’il conviendrait de faire: d’un côté, «un honnête homme aurait dû [leur] faire couper la tête», mais d’un autre, «en ne parlant pas, il obéissait à la dernière volonté de Françoise» (Zola: 533) qui ne les a pas dénoncés avant de mourir. Puis, il se décide brusquement: pas de procès, ni pour les meubles qu’on lui doit, ni pour le meurtre. Le silence de Françoise comme son refus de signer le testament peuvent être interprétés comme des actes de paroles dans ce contexte d’hybridité littératienne où l’oral comme l’écrit sont respectés lorsqu’ils soutiennent la coutume; mais le statut d’étranger de Jean ne lui permet pas d’être sensible à ces considérations. C’est surtout qu’en faisant ce choix, Françoise a joint à ses yeux les rangs de ces «bêtes dévorantes» que sont les paysans, tandis que lui est fier «de ne point en être, de ces coquins, d’être l’étranger» (534). Il adopte le réflexe littératien de la classification: puisqu’il ne peut faire partie du «nous», c’est donc qu’ils sont un «eux» pour lui, un «eux» impénétrable qui lui fera payer sa tentative d’inclusion en lui refusant jusqu’à un emploi de jardinier chez les Charles. Il retournera à l’armée, puisqu’on annonce la guerre; après tout, le meurtre n’est plus un acte répréhensible du moment qu’il est cautionné par l’État et la loi.
La beauté de l’art
Dernière question essentielle qui nous parvient depuis la préhistoire, la beauté de l’art est peut-être la plus subtile, la moins facile à cerner. Alors que l’écrit permet de créer une tradition, une accumulation de savoirs, un contenu inaltéré et reproductible et une pensée autonome, les études littéraires offrent la possibilité d’envisager les objets textuels par d’infinies relectures et de multiples réinterprétations, de mettre en lumière la charge d’ambigu et d’implicite qui fonde leur cohérence, et d’intégrer au mécanisme de production du sens des critères habituellement délaissés par la pensée écrite: contextes d’énonciation et de réception, polysémie, brouillage des limites, recréation du sens plutôt que répétition… La réussite de l’oeuvre va de pair avec la possibilité d’en faire des lectures différentes, comme le témoignent plusieurs définitions du classique selon Italo Calvino: «Toute relecture d’un classique est une découverte, comme la première lecture. (…) Un classique est un livre qui n’a jamais fini de dire ce qu’il a à dire. (…) Les classiques sont des livres que la lecture rend d’autant plus neufs, inattendus, inouïs, qu’on a cru les connaître par ouï-dire.» (Calvino, 1993: 9-10)
L’hypothèse de Privat proposant «une sémiotique de la signification qui “lit” dans des lieux dépourvus de toute trace d’écrit l’infrastructure concrète de l’écriture» (Privat: 129) demanderait peut-être, dans le cas de la littérature, à être retournée: l’évidence de la présence de l’écrit dans l’œuvre littéraire forme une tension structurelle fondatrice avec les caractéristiques de la pensée orale présentes dans l’oeuvre. Novarina, Jacob, Ernaux, Meschonnic, Duras: nombreux sont les écrivains ayant décrit leur pratique comme une utilisation du langage visant précisément à mettre en lumière l’incomplétude du langage. La création écrite4Ce terme est librement inspiré d’une traduction du concept anglais de creative writing, qui n’a pas de correspondant exact en français., parce qu’elle défie un à un tous les attributs propres à l’écrit, semble ainsi remplir un rôle «d’écrit contre l’écrit»; s’il fallait lui donner une fonction, peut-être serait-elle celle de révéler l’oralité dans l’écriture.
Ce qui donne sa force à une oeuvre artistique, c’est sa voix. La voix du texte ne correspond pas au style de l’auteur; c’est un organe qui revit à chaque rencontre des deux subjectivités que sont celles du livre et du lecteur. La limite, plutôt qu’une conception à classer comme devant être franchie ou respectée, devient l’endroit exact où l’on doit se trouver pour que s’accomplisse la transmission:
La voix n’est pas un territoire mais une dynamique. Elle ne relève pas d’une logique du plan, ne se constitue pas par démarcations mais par trouées, retours et superpositions. Plutôt que de territoires ou de frontières il faut parler, dans le cas de la voix, de limites au sens de champs. La voix relève d’une théorie des corps.
1. Si la voix cherche à excéder sa limite elle se brise. Cette limite ne lui est pas imposée du dehors; elle est la condition et l’instrument premier de la composition.
2. La limite n’est pas une ligne imaginaire mais un ensemble de rapports; plus spécifiquement, une organisation et une composition des résistances. (Lapierre, 2011: 158)
Conclusion
À plusieurs égards, Rognes paraît être un petit îlot préhistorique, une société «primitive» au cœur d’un État de plus en plus littératien. En pleine révolution industrielle, Zola nous rappelle que, malgré les révolutions successives, une partie de la nature humaine demeure insaisissable, inclassable. Cette oeuvre littéraire ouvre la possibilité d’une réinterprétation des critères par lesquels sont communément déterminés la classe sociale, le genre, le type de droit, ou l’étape évolutive d’une société. De surcroît, elle nous invite à repenser certaines conséquences de la révolution industrielle: l’exploitation environnementale, le libre marché et l’hégémonie économique rappellent trop souvent l’esclavagisme auquel l’humain soumet encore son semblable.
Si c’est avec l’invention du langage que l’humain se distingue du règne animal, c’est avec l’écriture qu’il développe la capacité de réfléchir à ce que cette séparation implique. L’écriture «contribue à transformer nos idées sur les façons d’utiliser le passé (par le précédent) et sur les dispositions à prendre pour l’avenir (par la législation)» (Goody, 1986: 153). Quant aux moyens de communication modernes, réussissent-ils, comme le prévoyait le sociologue Marshall McLuhan, à ébranler la suprématie de l’écrit? McLuhan propose une vision utopique d’un «village planétaire», un monde unifié grâce à un retour «à un type de sensibilité et à un besoin de participation comparables à ceux qui prédominaient dans les petites communautés» (Huyghe, 2011) orales. Comme Goody, McLuhan considère que le mode de production de la communication dans une société détermine la structure de son mode de pensée. Cependant, ce que les travaux de Goody démontrent, c’est qu’il ne suffit pas de changer de mode de communication dominant pour que disparaisse le mode de pensée qui y est lié (Goody, 1979: 252-253). L’imposition d’un mouvement général vers une unification du monde ne fait pas disparaître la structure de pensée binaire fortement ancrée dans nos sociétés; à preuve, le risque d’exacerber les replis identitaires et nationalistes que comporte l’ouverture dérèglementée des frontières. Il ne s’agirait donc ni de viser à transcender complètement les catégories, ni de les voir comme seul mode d’interprétation du monde, mais plutôt de reconnaître que, en autant qu’on ne leur donne pas valeur d’absolu, elles permettent une certaine appréhension de l’univers complexe qui nous entoure.
Bibliographie
- 1Aux pages 225 et 226 du roman, Françoise ressent une grande colère à se voir imposer les ébats amoureux de sa sœur et de Buteau.
- 2Émile Zola, Différences entre Balzac et moi, cité par Schor, op. cit., p. 185.
- 3Cette comparaison s’opère entre la scène initiale du roman, lors du partage de la terre entre les Fouan (p. 47) et celle où Jésus-Christ, le fils aîné des Fouan, se défait de la dernière parcelle de terrain qu’il lui reste afin de rembourser des dettes d’alcool (pp. 358-359).
- 4Ce terme est librement inspiré d’une traduction du concept anglais de creative writing, qui n’a pas de correspondant exact en français.
